Big Fish de Tim Burton
(2003)
J’avais un peu peur de revoir celui-là, j’en gardais le souvenir d’un très bon Burton et la crainte de le revoir à la baisse comme un bon nombre de ses autres films était bien présente. Néanmoins, comme je le disais dans ma critique de Ed Wood, Burton n’est jamais aussi bon que quand il traite des sujets personnels à travers ses films, qu’ils soient des commandes ou non, et pour le coup Big Fish fait clairement partie de ceux-là. Pourtant, à la base, le projet était loin d’être promis au réalisateur, ça a d’ailleurs été longtemps un film promis à Spielberg, qui l’a ensuite mis de côté pour pouvoir faire Catch me if you can, et c’est donc finalement Burton qui le réalise, après avoir été complètement séduit par le script. A mettre en parallèle les thématiques du film et la vie personnelle de Burton, on comprend vite ce qui l’a intéressé : on parle quand même d’une histoire père/fils où ce dernier tente de savoir qui est vraiment son paternel à travers les histoires qu’il a raconté toute sa vie, au moment où Burton vient de perdre son père sans qu’il ait jamais été réellement proche de lui, et qu’il s’apprête à avoir son premier enfant.
Forcément, le film prend alors une tournure personnelle, et Burton semble se retrouver autant dans le personnage du fils (renfermé sur lui-même, qui a envie de savoir qui est réellement son père avant qu’il ne soit trop tard) que de celui d’Edward Bloom (personnage qui raconte sans cesse des histoires fantastiques capable de subjuguer l’assistance, mais qui a énormément de mal à communiquer ses émotions à ses proches), ce qui donne l’impression de voir une fable autobiographique où Burton, tel le père Bloom avec son auditoire, s’amuse à perdre le spectateur sur la notion de ce qui tient du réel et ce qui tient du fantastique. Et puis cette note d’intention permet aussi à Burton de jouer sur ses faiblesses formelles : le réalisateur n’a jamais été doué pour filmer l’action, mais l’humour omniprésent et le côté grandiloquent qui accompagne le film permet de faire passer des passages qui auraient été moqués dans ses autres films (le passage en Chine est un bon exemple, on est clairement dans la dérision et l'exagération). Formellement, c’est aussi le dernier Burton sur lequel il y avait encore un mélange bien dosé entre effets pratiques et numériques, le mélange des deux sert de véritables idées de narration (le temps qui s’arrête au cirque), et c’est donc aussi l’un des films de Burton qui vieillissent le mieux visuellement (les trucages avec le géant, malgré quelques imperfections, ont un véritable charme, alors que désormais Burton ferait probablement tout en CG).
Et puis c’est, à titre personnel, le film de Burton sur lequel l’émotion se ressent le plus, le final dans l’hôpital avec la dernière histoire racontée par le fils c’est facilement une des plus belles scènes de la carrière du réalisateur (grandement épaulé par un Danny Elfman en bonne forme) et qui me met la larme à l’oeil à chaque fois. Côté casting, c’est la grande classe, notamment avec le doublé Ewan McGregor/Albert Finney qui jouent le même personnage à un stade différent de leur vie, on croit complètement à la symbiose des deux acteurs, et McGregor joue un côté charmeur over the top qui prouve qu’il aurait pu faire un superbe James Bond. Côté seconds rôles, c’est comme souvent chez Burton très bien fourni : Crudup, Lange, De Vito, Buscemi, Cotillard, Helena Bonham Carter, y’a clairement de quoi faire. Le dernier grand film de Burton en date, et accessoirement le long-métrage que je préfère du bonhomme avec le temps.
8/10




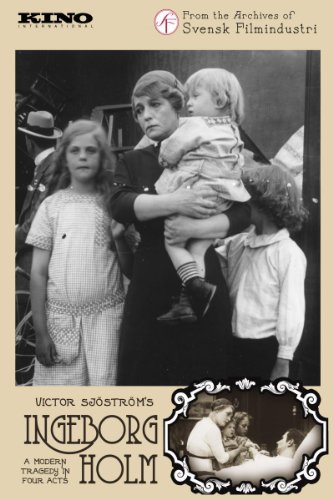


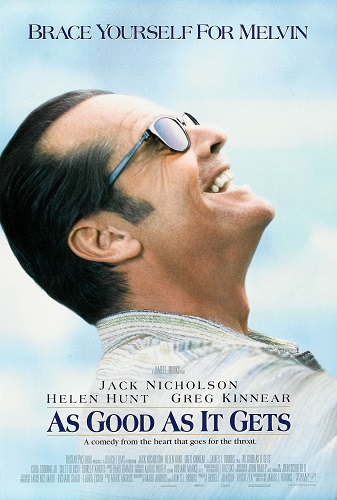


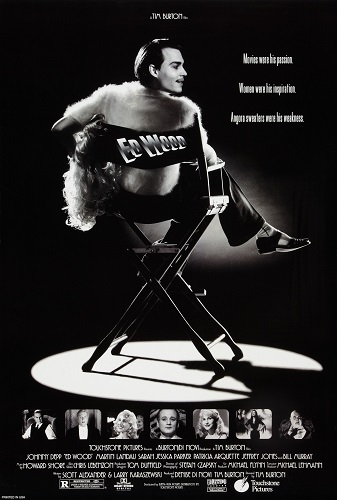






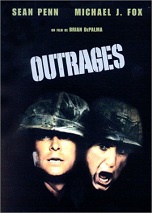






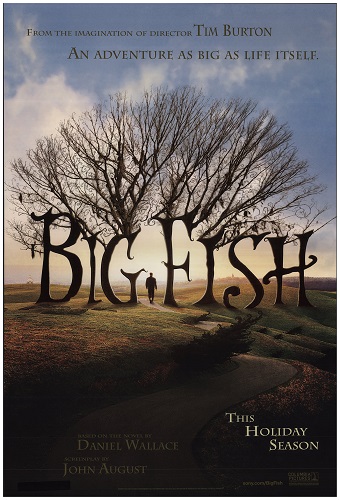









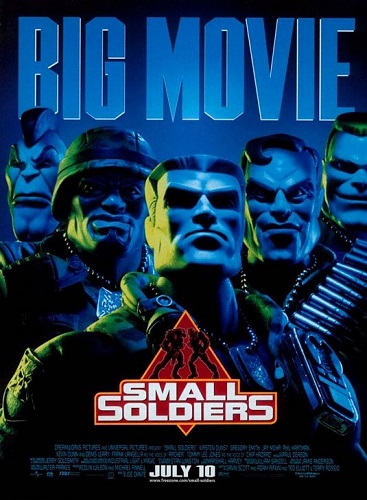
 ).
).



