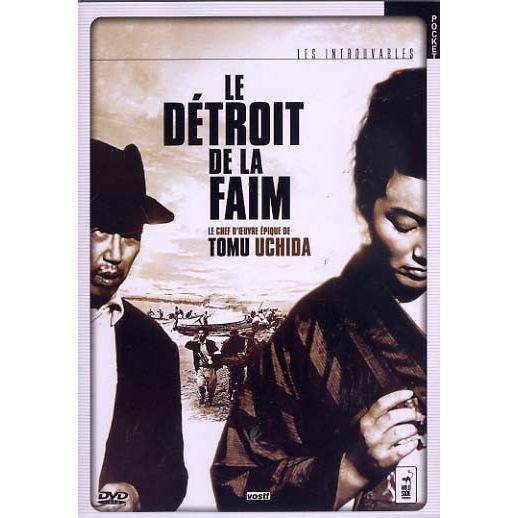Diesel & rust.
Il y a des moyens plus suicidaires que d’autres pour développer une franchise – c’est-à-dire, essorer jusqu’à dessèchement intégrale une poule aux œufs d’or - : les suites à répétition ayant tendance à épuiser le filon assez rapidement, on voit fleurir les prequel et autres spin-off, garantie d’un public acquis à la cause et d’une certaine liberté scénaristique.
J.K Rowling opte ainsi pour une nouvelle saga située quelques générations avant celle d’Harry Potter, et délocalisée aux USA, l’occasion de noter quelques différences avec la sorcellerie made in Europe. Les clins d’œil sont nombreux, et le fan retrouvera (avec plaisir ?) les codes en vigueur dans le cycle originel.
Le New York des années 20 est le prétexte à une photo légèrement sépia et jaunie qui n’est pas dénuée de charme, surtout pour le spectateur gavé jusqu’au gosier de blockbusters technologiques et rutilants : ici, un certain goût pour l’authentique traverse, du moins dans les intentions, l’esthétique et les idées : la pâtisserie contre la conserve, et des thèses discrètement écologiques sur l’extinction des espèces ou la nécessaire ouverture vers l’inconnu en lieu et place de son habituelle et aveugle destruction.
Le bestiaire promis est certes éclectique, mais on peine néanmoins à réellement surprendre : des aptitudes (invisibilité, ailes triples, cuirasse lumineuse…) au design, on quitte rarement le terrain connu, même si certaines séquences peuvent prêter à sourire, comme celle de la taupe cleptomane dans une bijouterie ou d’un serpent à plume à taille variable.
Reste donc à nous présenter tout cela, et mettre en place une intrigue. Le duo classique entre un sorcier et un non-initié se charge de l’exposition, et même si elle n’évite pas certaines lourdeurs, le personnage de l’impétrant boulanger est assez attachant, et leur valse avec deux sœurs sorcières sait ménager quelques échanges un peu malicieux.
Il n’en reste pas moins que ce pseudo nouvel univers accuse des lenteurs au démarrage d’un bon vieux diesel : le rythme est problématique, d’une mollesse assez surprenant en cette époque de montage frénétique, sans pour autant instituer une quelconque valeur à la lenteur : on s’ennuie un peu, on attend beaucoup.
Le problème est là : maintenant qu’on nous a annoncé que cet univers se déclinerait en cinq épisodes, il semblerait qu’on attende de nous une tolérance pour cette longue introduction. Les enjeux sont toujours les mêmes (les sorciers luttent pour rester inconnus des humains, certains sorciers ont des velléités guerrières), et la gradation vers les scènes spectaculaire assez vaine : on en revient toujours à ces fumerolles noires, signe d’une puissance dark side qui semble aussi ringarde qu’elle l’était dans Spiderman 3, c’est dire, le tout dans des destructions numériques de rues entières avec un sens de la répétition qui lasse rapidement.
On le sent bien, tout se prépare. Certes, l’imaginaire garde le pouvoir, occasionnant de belles idées (la valise et sa dimension interne défiant les lois les plus élémentaires de la géographie, la scène de condamnation à mort, correcte) comme des ratés (l’excitation nuptiale du rhino/néon, des combats à coup de baguette désormais vraiment éculés), mais les personnages manquent encore cruellement de chair. En ahuri gentiment barge, Eddie Redmayne lasse plus qu’il ne séduit, et sa side-kick Katherine Waterson peine à donner chair à un personnage assez inepte.
Des animaux, certes. Fantastiques…cela reste à prouver ; les producteurs ont le temps, et le savent : c’est là justement un des éléments qui irrite le plus.