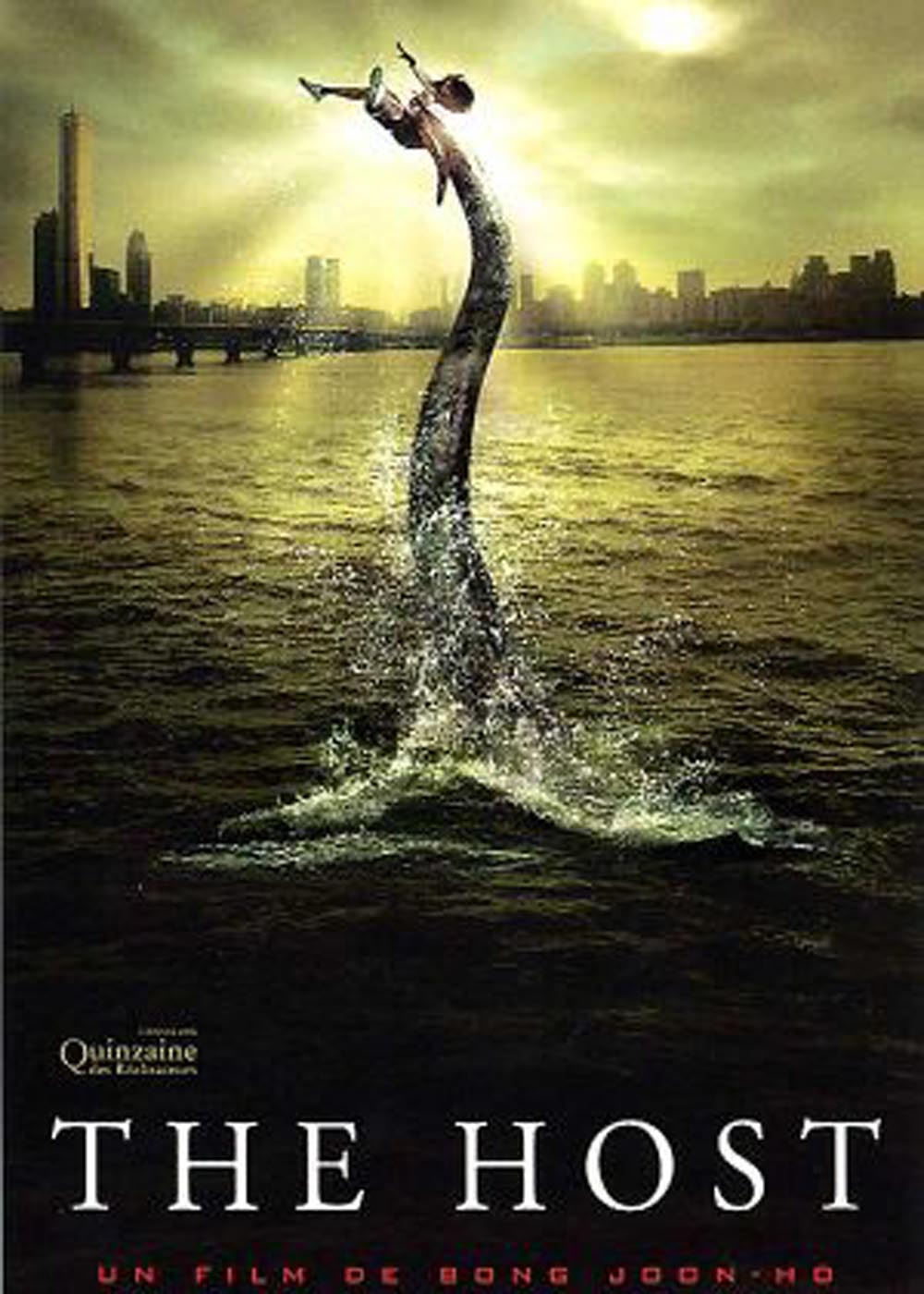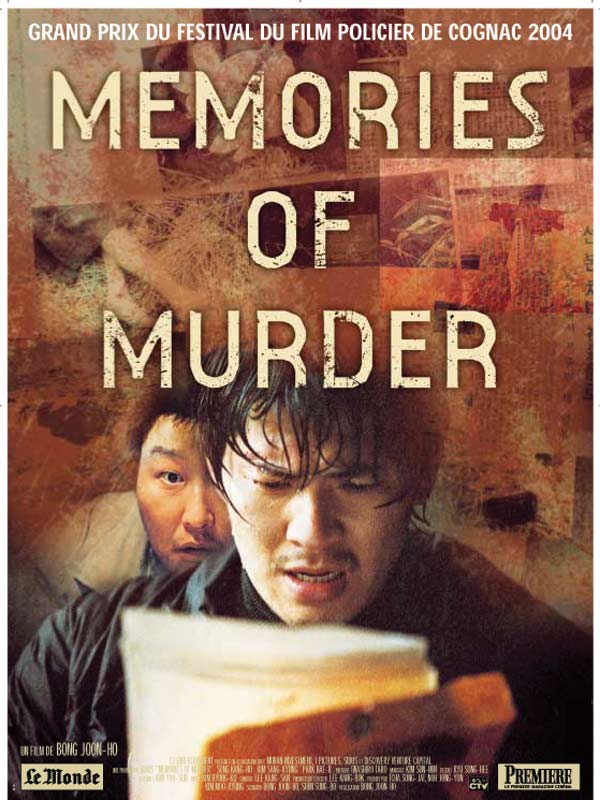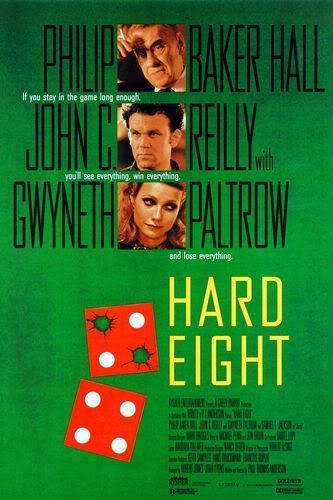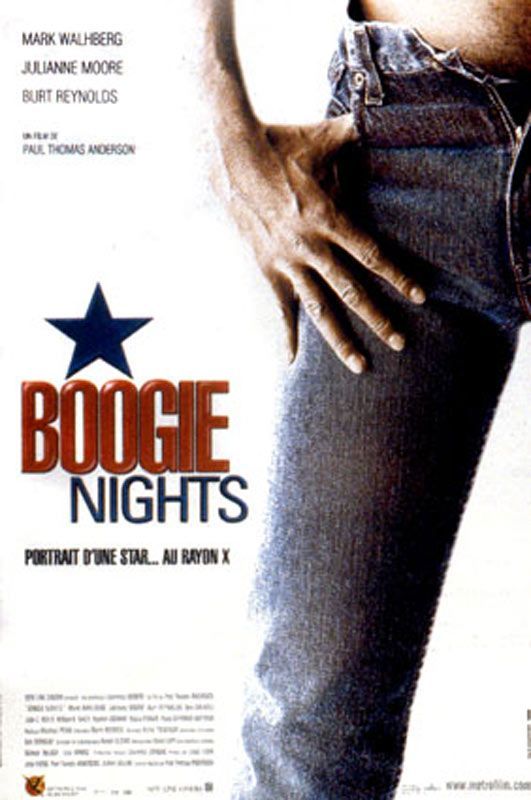Lie me a river.
Les personnages de François Ozon ont toujours eu à composer avec le mensonge ou la fiction : c’est l’occupation favorite du jeune lycéen dans Dans la maison, l’activité cachée de la jeune fille dans Jeune et Jolie, ou l’identité sexuelle de Duris dans Une nouvelle amie.
Frantz creuse le même sillon, mais sous le joug de quelques modulations qui en renouvellent les finalités : d’abord, une vérité cachée aussi au spectateur, et un accès à la vérité qui ne prendra pas forcément le tour attendu.
Dans une Europe encore brulée par la guerre, l’arrivée d’un français en Allemagne, en 1919, vient remuer les braises. Ozon prend son temps dans le portrait réduit d’un pays, entre une famille en deuil et une petite ville dans laquelle nait déjà le nationalisme blessé qui aura les conséquences que l’on connait. La rigueur un peu protestante de ces images, l’austérité des intérieurs et le recours au noir et blanc font forcément penser au Ruban blanc d’Haneke. Deux mensonges cohabitent déjà : celui d’une Allemagne pensant se reconstruire dans la revanche, et celui qu’on pressent, sans le comprendre, d’Adrien.
Cette atmosphère étouffante, qui exploite les passions exacerbées, voire l’épuisement de toute une population après le carnage et la défaite, parvient à ses fins : le discours pacifiste, l’absurdité de la guerre et la relativité de la victoire sonnent assez juste.
Au sein de la famille, le couple franco-allemand s’impose : si Niney insiste un peu trop sur la fébrilité et manque parfois de mesure, sa partenaire, Paula Beer, est rigoureusement parfaite.
Puisqu’il s’inspire du Broken Lullaby de Lubtisch, Ozon joue la carte du mélo à l’ancienne : on sent aussi quelques touches du Temps de vivre et le temps de mourir de Sirk, sur cette cohabitation entre la haine collective de la guerre opposée à l’épanouissement sentimental des individus.
C’est cet aspect qui pèche un peu. La navigation entre le noir et blanc et la couleur, parfois assez poussive, empèse la démonstration, et l’écriture en deux temps vire au systématisme. Alors qu’on a bien compris que le regard sur l’Allemagne renvoie dos à dos deux nations, Ozon se sent obligé de tendre un miroir inversé d’un très grand nombre de séquences (le train, les hymnes nationaux, les morceaux de musique, les familles…), dévoilant des artifices d’écriture dont on aurait pu se passer.
Pourtant, les développements de l’intrigue dans ce nouveau départ prennent une direction vraiment intéressante.
Cet accès à une vérité unique, constitutive d’un individu, se nourrit des mensonges entendu et de ceux redistribués. Ce parcours vers la révélation aura beau avoir pris les détours du romanesque et les larmes du mélodrame, il puise sa source dans deux images essentielles : un visage quadrillé dans un confessionnal, dans lequel l’idée du pardon s’impose, et le plan final, où l’évidence d’un élan vers la vie se formule.