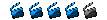Andrei Roublev d'Andrei Tarkovski (1966) - 8/10
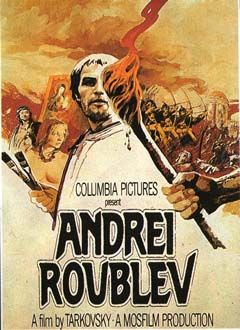
Alors que le monde s’écharpe dans des travers irrévocables, Andrei Roublev médite sur sa compétence à pouvoir ériger une quelconque retranscription du monde dans lequel il vit. Sa mission : peindre le jugement dernier. De prime abord, la lecture du titre du film est aussi intéressante que purement anecdotique : Andrei Roublev. Mais le film parle d’Andrei. Mais duquel ? Roublev ou Tarkovski. Le visionnage du film, monumental et étouffant, laisse songeur sur la place que se donne le réalisateur dans l’entièreté de son œuvre. Car aussi visible que cela puisse paraître, Andrei Tarkovski, sa réalisation, son regard tout en recul sur les phénomènes qui gravitent autour du moine, ne laissent aucun doute sur l'identification de l’auteur à l’artiste.
L’œuvre qui se présente à nous, n’est en rien un biopic comme un autre : Tarkovski ne dévoilera qu’à la toute fin, les prouesses picturales du peintre. Ce n’est pas un film hommage mais un film monstre qui se pose une question que tout créateur se pose au moins une fois dans sa vie : où et comment trouver l’inspiration ? Dans une Russie moyenâgeuse, qui perd ses valeurs aux yeux du moine qu’est Andrei Roublev, Tarkovski dilate son récit en plusieurs chapitres, qui marquent à chaque fois, une étape dans l’introspection du peintre dans sa quête d’éclaircis sur un monde qui semble si éloigné de lui et de ses préceptes : telle une montgolfière qui prendrait son envol, l’humain qui se rapproche des cieux et qui voit ses rêves s’écraser au sol comme s’effacerait la croyance en l’Homme.
Ce chapitrage est un procédé narratif qui permet à l’histoire d’avoir plusieurs films dans le film, de ne pas tomber dans une linéarité inféconde, passant alors de l’épique à l’errance, du questionnement au passage à l’acte, de l’hypnotique à la dramaturgie, comme si un nouvel horizon s’émancipait : un chapitre équivaut à une question pour une réponse, un regard pour une émotion. De l’attaque meurtrière des Tatars, de la fondation d’une cloche, d’un doute sur le bienfondé d’une création jusqu’à la tentation d’une fête païenne, le voyage initiatique d’Andrei Roublev n’est pas de tout repos et mettra sa conscience en l’Homme et en l’humain à rude épreuve. Tout comme l’assiduité du spectateur. Car Andrei Roublev est une œuvre exigeante, longue, concentrant son rythme (ou non rythme) sur une respiration opaque où le contemplatif se fait rare. Andrei Tarkovski propulse son film dans un spectre où la chair prend forme, où l’odeur de la boue se fait saisissante, où la misère s’enclave dans les esprits.
Une opposition de l’image assez singulière, filmant de près la matière alors qu’elle intègre ses protagonistes dans un environnement laconique, humble et presque vide de toute flamboyance, loin d’un décorum surchargé. Une œuvre de la sensation qui se marie parfaitement avec la prouesse visuelle qui se dessine devant nos yeux. Car si L’enfance d’Ivan n’était que le premier échantillon du génie d’Andrei Tarkovski, ce dernier semble déterminé à dépasser les limites de la perfection esthétique : travellings vertigineux, paysages expressionnistes, jeux de lumière fuyants, montage et capacité à manipuler le temps. Et la magie opère à de nombreuses reprises : lors de ce plan circulaire dans cette grange qui abrite la misère de la pluie et de l’oppression, cette séquence de festivité païenne où la forêt se voit remplir d’hommes et femmes nus dans un écrin lumineux assez prodigieux, les plans séquences chorégraphiques fondation d’une cloche. Mais Andrei Roublev est une œuvre aussi esthétique que philosophique.
Car si le réalisateur cherche la grâce absolue, il en est de même pour son personnage principal. Même si les questionnements qui jalonnent certains longs dialogues touchent du doigt le spirituel (sans être prêchi prêcha), il est beaucoup question de l’humain et de comment l’environnement va égratigner les certitudes du moine : la honte face à sa lâcheté, sa culpabilité de meurtrier, son silence face à l’avidité de l’autre, de sa croyance en lui-même, et de la volonté de l’artiste pour faire de l’art une arme pacifique contre l’ignorance et l’autoritarisme. Mais c’est dans l’un de ses derniers actes que Tarkovski se veut plus foisonnant dans sa description de l’art (la fondation de la cloche où il est difficile de ne pas penser à Ivan avec cet enfant-homme) et des sacrifices individuels et collectifs qui entourent la constitution de l’ouvrage artistique. Au lieu faire de l’art pour de l’art, pour le profit et haine de l’autre, Andrei Roublev se veut plus humaniste que Théophane : où un don de Dieu est la profession de foi en l’humain.
L’œuvre qui se présente à nous, n’est en rien un biopic comme un autre : Tarkovski ne dévoilera qu’à la toute fin, les prouesses picturales du peintre. Ce n’est pas un film hommage mais un film monstre qui se pose une question que tout créateur se pose au moins une fois dans sa vie : où et comment trouver l’inspiration ? Dans une Russie moyenâgeuse, qui perd ses valeurs aux yeux du moine qu’est Andrei Roublev, Tarkovski dilate son récit en plusieurs chapitres, qui marquent à chaque fois, une étape dans l’introspection du peintre dans sa quête d’éclaircis sur un monde qui semble si éloigné de lui et de ses préceptes : telle une montgolfière qui prendrait son envol, l’humain qui se rapproche des cieux et qui voit ses rêves s’écraser au sol comme s’effacerait la croyance en l’Homme.
Ce chapitrage est un procédé narratif qui permet à l’histoire d’avoir plusieurs films dans le film, de ne pas tomber dans une linéarité inféconde, passant alors de l’épique à l’errance, du questionnement au passage à l’acte, de l’hypnotique à la dramaturgie, comme si un nouvel horizon s’émancipait : un chapitre équivaut à une question pour une réponse, un regard pour une émotion. De l’attaque meurtrière des Tatars, de la fondation d’une cloche, d’un doute sur le bienfondé d’une création jusqu’à la tentation d’une fête païenne, le voyage initiatique d’Andrei Roublev n’est pas de tout repos et mettra sa conscience en l’Homme et en l’humain à rude épreuve. Tout comme l’assiduité du spectateur. Car Andrei Roublev est une œuvre exigeante, longue, concentrant son rythme (ou non rythme) sur une respiration opaque où le contemplatif se fait rare. Andrei Tarkovski propulse son film dans un spectre où la chair prend forme, où l’odeur de la boue se fait saisissante, où la misère s’enclave dans les esprits.
Une opposition de l’image assez singulière, filmant de près la matière alors qu’elle intègre ses protagonistes dans un environnement laconique, humble et presque vide de toute flamboyance, loin d’un décorum surchargé. Une œuvre de la sensation qui se marie parfaitement avec la prouesse visuelle qui se dessine devant nos yeux. Car si L’enfance d’Ivan n’était que le premier échantillon du génie d’Andrei Tarkovski, ce dernier semble déterminé à dépasser les limites de la perfection esthétique : travellings vertigineux, paysages expressionnistes, jeux de lumière fuyants, montage et capacité à manipuler le temps. Et la magie opère à de nombreuses reprises : lors de ce plan circulaire dans cette grange qui abrite la misère de la pluie et de l’oppression, cette séquence de festivité païenne où la forêt se voit remplir d’hommes et femmes nus dans un écrin lumineux assez prodigieux, les plans séquences chorégraphiques fondation d’une cloche. Mais Andrei Roublev est une œuvre aussi esthétique que philosophique.
Car si le réalisateur cherche la grâce absolue, il en est de même pour son personnage principal. Même si les questionnements qui jalonnent certains longs dialogues touchent du doigt le spirituel (sans être prêchi prêcha), il est beaucoup question de l’humain et de comment l’environnement va égratigner les certitudes du moine : la honte face à sa lâcheté, sa culpabilité de meurtrier, son silence face à l’avidité de l’autre, de sa croyance en lui-même, et de la volonté de l’artiste pour faire de l’art une arme pacifique contre l’ignorance et l’autoritarisme. Mais c’est dans l’un de ses derniers actes que Tarkovski se veut plus foisonnant dans sa description de l’art (la fondation de la cloche où il est difficile de ne pas penser à Ivan avec cet enfant-homme) et des sacrifices individuels et collectifs qui entourent la constitution de l’ouvrage artistique. Au lieu faire de l’art pour de l’art, pour le profit et haine de l’autre, Andrei Roublev se veut plus humaniste que Théophane : où un don de Dieu est la profession de foi en l’humain.