
Déclarations de dépendance.
Il semble y avoir, dans la carrière de Michael Mann, un avant et un après Heat. Le succès critique et public de son grand œuvre provoque chez le cinéaste une confiance qui lui permet de pousser plus loin certaines tentations dans son esthétique. Révélation en est le terreau, Ali le confirmera, jusqu’à une certaine rupture toujours à l’œuvre depuis.
Révélation quitte le terrain balisé du polar et du monde des gangster si cher au réalisateur pour traiter d’une grande enquête journalistique autour d’un lanceur d’alerte sur l’industrie du tabac : c’est résolument la cour des grands, puisque les faits sont véridiques, les personnages réels et les entités de véritables institutions, comme CBS ou les grandes firmes américaines de cigarettes. On n’échange plus des rafales de balles, mais on s’affronte à coup de milliards et de procédures juridiques, de clauses de confidentialités et d’entourloupes face à la légalité : dans ce monde compassé, Mann gère avec toujours autant de maestria les différents instances, comme il le faisait dans Le dernier des Mohican : un individu, sa famille, un journaliste, sa structure, une firme, la loi, le pays tout entier s’entremêlent en un tableau à la fois exhaustif et fluide. Le montage alterné, entièrement au service du drame, est millimétré, à l’image de cette séquence lors de laquelle Wigand doit choisir de venir déposer ou non dans une cour du Mississipi, va et vient entre son hésitation et la pièce dans laquelle les avocats l’attendent.
Révélation peut déconcerter dans sa première heure : puisqu’il sait qu’il prendra son temps, Mann met en place avec une certaine austérité son thriller, avant que ne montent en puissance les enjeux dramatiques : la destruction d’un individu, les imbroglios juridiques et les débats journalistiques finiront par ne former plus qu’un écheveau inextricable, d’une force de frappe indiscutable. Cette sorte de désincarnation initiale est peut-être une façon pour le cinéaste de coller à la personnalité un peu opaque de Wigand, bien rendue par Crowe, et qui équilibre certaines grandes sorties de Pacino qui semblent par moment s’épancher dans des scènes écrites sur la démesure de son jeu.
Car la question du regard est évidemment primordiale : Mann fait désormais un film de mise en scène : elle est le sujet même de son récit (comment cacher ou révéler, donner à voir sans en avoir le droit), et une déclaration d’intention esthétique. Les champs/contre-champs se multiplient, et les dialogues durant lesquels la tête de l’interlocuteur au premier plan occupe une partie du champ. Souvent, les visages sont à moitié occultés par l’obscurité, notamment dans la fameuse interview filmée pour Sixty Minutes : l’image joue habilement sur cette fragmentation et ce rapport biaisé à la prise de parole contrainte.
Cette enquête magnifiée par un regard exigeant renvoie au Zodiac de Fincher : une osmose entre le réel et sa métamorphose par la grâce du montage. Dans cette austérité affichée, Mann ne renonce pas pour autant à son esthétique habituelle : l’ambiance reste bleutée et urbaine comme on la voit depuis Le Solitaire. L’atmosphère carcérale de la paranoïa est particulièrement soulignée dans une thématique des fenêtres et des lucarnes dans des tonalités très picturales au point qu’on pense à du Hopper sur certains plans. Puis le récit s’ouvre sur quelques séquences d’un lyrisme assumé, comme un green nocturne constellé de balles de golf, un homme les pieds dans l’océan pour capter une conversation téléphonique et son interlocuteur voyant son papier peint se transformer en toile de projection du manque de ses filles.
Cette montée en puissance accuse certaines limites : la musique de Lisa Gerrard n’est pas particulièrement pertinente dans les séquences finales, et Pacino peut avoir tendance à trop en faire, mais le réalisateur parvient à ne pas en faire les apogées du film.
Car la question finale est bien celle de la vérité : croisade pour pouvoir la diffuser, et à laquelle répond la campagne de dénigrement du lanceur d’alerte. Le film ne s’occupe pas tant de Révélations que de propagation et de divulgation : comment dire, par quel biais, comment se faire entendre, quel prestige en retirer, quel dégâts accepter pour ce faire. Dans ce monde cynique et vénal, on broie toutes les valeurs, et l’individu n’en sort jamais vainqueur, même s’il l’est sur le papier.
En cela, la conclusion est particulièrement intéressante : la victoire est indiscutable, mais ce qui reste explique les choix singuliers de mise en scène opérés par Mann, fondés sur la brisure et la part d’ombre et que le personnage de Pacino explique en démissionnant :
“What got broken here doesn't go back together.”
(8.5/10)








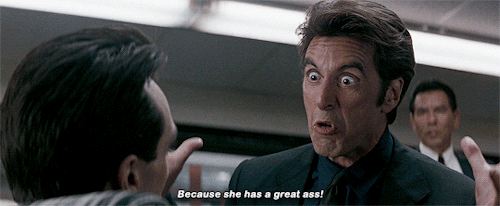






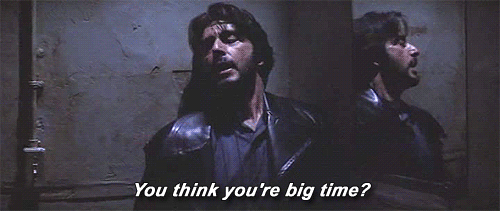


 Bon, on va chez vous et on baise ?
Bon, on va chez vous et on baise ?