
[Nulladies] Mes critiques en 2016
Modérateur: Dunandan
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
J'en pense la même chose 


-

osorojo - King Kong

- Messages: 22382
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Tigre & Dragon - 7/10
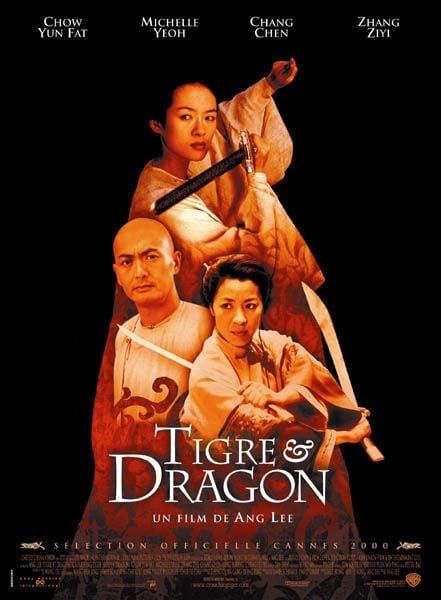
Les rois de l’attraction
En 2000, l’Occident émerveillé découvre le wu xia pian : la combinaison d’un exotisme frais et des dernières technologies en date au service des scènes de combats font de Tigre et dragon un carton international.
Le revoir 16 ans plus tard commence par étonner : ce qu’on avait retenu de lui, à savoir ses scènes maitresses, n’occupe qu’un quart du film (mais mobilisa 80 % du tournage…). Le récit est en effet assez bavard, notamment lors d’une exposition interminable et des échanges à rallonge sur les enjeux sentimentaux qui lient ou déchirent les protagonistes.
Les questions traditionnelles occupent l’intrigue : le rapport entre maitre et disciple, l’âpreté de l’initiation, l’ambition qui aveugle et la nécessité de juguler ses passions, au premier rang desquelles l’amour. L’intérêt d’une écriture au long cours réside dans l’ambivalence de Jiao Long, la splendide et volatile Zhang Ziyi : dévorée aussi bien par l’amour que la colère propre à sa jeunesse, le désir de surpasser les maitres et la reconnaissance progressive du respect qui leur est dû, elle accompagne le spectateur dans un parcours qui se soldera par la victoire du lyrisme le plus pathétique.
Si le rythme d’ensemble souffre d’une trop grande disparité, il s’organise tout de même sur un principe, celui de l’attente : les scènes de combat, semble-t-on nous dire, se méritent, tout comme les jeunes recrues doivent apprendre patience et abnégation. Et force est de reconnaitre que la patience est récompensée. Le principe de la beauté plastique préside à tous les autres critères : par la variété des décors, instaurant à chaque fois une esthétique propre : sur les toits, de nuits, sur une cascade, dans l’architecture des temples, sur deux étages d’une auberge, dans une forêt de bambous : à chaque séquence sont exploitées les spécificités spatiales et visuelles du lieu.
Le travail sur le son, remarquable, combine percussion et bruit des lames fendant l’air à la délicatesse infinie des corps maitrisés à la perfection : c’est sur du velours que se déplacent les protagonistes.
Car c’est bien évidemment sur cet aspect que Tigre et Dragon frappe les esprits : son affranchissement de l’apesanteur. Un an après Matrix, le magicien Yuen Woo-ping revient aux sources de son art et livre une partition mémorable : le ballet aérien est d’une maitrise totale, et les adversaires dansent autant qu’ils s’affrontent. L’interaction entre leur lutte et l’espace est chorégraphiée à la perfection, particulièrement sur la dernière séquence au sommet des bambous. On a rarement atteint une telle grâce, une si grande délicatesse dans les déplacements.
Pour ces seules séquences, Tigre et Dragon est un film important. Allié à la mélancolie qui se dégage de son intrigue, il peut aussi parvenir à toucher, malgré certaines pesanteurs dans son équilibre général.
Critiques similaires
| Film: Tigre et Dragon Note: 8,5/10 Auteur: Dunandan |
Film: Tigre et Dragon Note: 8/10 Auteur: Scalp |
Film: Tigre et Dragon Note: 8/10 Auteur: Heatmann |
Film: Tigre et Dragon Note: 8/10 Auteur: Killbush |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Hero (2002) - 6,5/10

Trois petits tours et cris sans fond.
Evidemment, Hero sent à plein nez le filon exploité dans le sillage du succès de Tigre et Dragon : moins de dialogues, une dimension plus épique et spectaculaire, et une mise en perspective de tous les éléments de combats.
L’alternance est savamment menée entre les grandes scènes collectives, dans des architectures monumentales (l’attaque des archers, la cité royale) et les combats d’arts martiaux.
Le modèle narratif, sur le principe assez connu du Rashomon, consiste à ne cesser de corriger un récit rétrospectif, dont les versions se succèdent pour aboutir à une vérité bien éloignée de celle initialement donnée. Certes, la formule a ses limites : les récits sont tellement contradictoires qu’au bout du troisième, le spectateur n’investit plus véritablement d’émotion face à ces personnages girouettes, comprenant qu’il s’agit surtout d’assurer une combinatoire permettant de faire combattre n’importe quel protagoniste contre un autre.
Mais c’est dans l’esthétique que se situe surtout l’intérêt d’une telle diversité : d’un flash-back à l’autre, la dominante chromatique change, et avec elle les contraintes imposées au combat. L’un est mis en lien avec la musique, l’autre avec la calligraphie. L’un a lieu à la surface de l’eau, l’autre sous la pluie, dans les feuilles mortes… Ballet ultra stylisé et bénéficiant de la même grâce que son prédécesseur, Hero fait de ces séquences les pièces maitresses.
Bien entendu, la surenchère n’est pas forcément gage de réussite. Si l’on peut apprécier de voir les combats plus longs et une voltige encore plus maitrisée, il faut accepter de faire de la forme le but premier…et ultime, jusqu’à l’excès. Le recours à la CGI, notamment dans les gouttes de pluie ou les feuilles mortes, enlaidit des séquences qui n’en demandaient pas tant…
Il s’agit surtout de définir ce que l’on est venu chercher : certes, les thèmes pseudo politiques et sacrificiels sont d’une grande superficialité, et Tigre et dragon était –légèrement – plus ambitieux sur les questions de fond ; mais après tout, on ne songerait pas à reprocher à un cirque d’abuser des couleurs ou des rutilances. C’est à peu près la même chose ici : opéra visuel, Hero mise tout sur son apparence : inutile d’aller y chercher du Shakespeare comme on le ferait dans Ran ou Kagemusha, qui, en dignes chefs d’œuvres, concilient virtuosité formelle et richesse du fond.
A l’image de la calligraphie dont il évoque la grâce, Hero est un signe, et non un langage. On peut s’en satisfaire, à condition de ne pas réduire le wu xia pian à cela.
Critiques similaires
| Film: Hero (2002) Note: 2/10 Auteur: Pathfinder |
Film: Hero (2002) Note: 4,5/10 Auteur: Alegas |
Film: Hero (2002) Note: 7/10 Auteur: Dunandan |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Happiness Therapy - 7/10
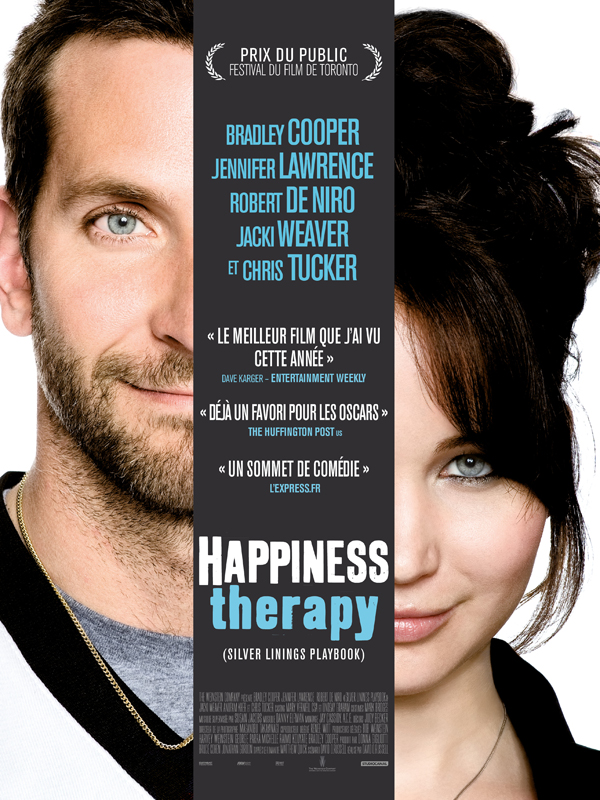
Clash Dance
Happiness est une réussite : pendant les trois quart de sa durée, il parait à faire totalement oublier les raisons qu’on pouvait avoir de s’en tenir à l’écart, à savoir la crainte qu’on nous serve une énième romcom comme semblait le promettre la bande annonce.
Dans une atmosphère assez proche des meilleurs Alexander Payne, notamment The Descendants ou Nebraska, David O. Russell met en place une exposition d’une rare efficacité : des personnages réellement originaux, un univers incarné, un entourage crédible.
Happiness Therapy est un film porté par ses comédiens. Il faut reconnaitre que le duo Lawrence/Cooper génère une alchimie assez unique. Le handicap de leur personnage brisés par la vie leur permet de penser à voix haute, le tout avec un sens de la répartie indexé sur les capacités d’un Uzi. En résulte un premier repas absolument jubilatoire, où toutes les convenances (américaines, notamment) s’écroulent, dévoilant toute la puissance dévastatrice et la fragilité mentale des protagonistes. Ajoutons à cela la réussite dans l’écriture des personnages secondaires, et particulièrement l’ami dans l’immobilier, cocotte-minute du modèle de réussite capitaliste, et la mayonnaise monte définitivement.
Le récit prend son temps pour installer les personages et distille quelques crises permettant de cerner leurs abimes : là aussi, la mise en scène s’avère très efficace, notamment lors de cette nuit de furie ou Pat cherche la cassette vidéo de son mariage, et les effets boule de neige de sa démence sur le quartier tout entier. Nerveuse, rythmée, gérant avec tact l’alternance entre musique et paroles, la séquence est pertinente en tout point.
Lorsque l’histoire et ses enjeux empruntent des rails plus traditionnels, Russell a le mérite de nous avoir rendus ses personnages attachants. Mais le dernier quart, à coup de mensonges, de trahisons, de concours, de paris aux enjeux foireux permettant de lier les deux arcs de la destinée économique familiale et sentimentale individuelle, force trop le trait pour pleinement convaincre. Certes, on nous évite une success story trop lisse, et dans l’esprit de Little Miss Sunshine, on crédibilise la compétition finale.
Mais l’épaisseur des personnages, leur singularité si bien exposée, les rendait dignes d’une destinée un peu plus reluisante que ce final qui semble les décapiter pour pouvoir les faire rentrer dans le moule.
On n’en accordera pas moins le mérite à Russell de les avoir fait exister avec cela.
Critiques similaires
| Film: Happiness therapy Note: 7/10 Auteur: Heatmann |
Film: Happiness therapy Note: 5,5/10 Auteur: pabelbaba |
Film: Happiness therapy Note: 8/10 Auteur: Mark Chopper |
Film: Happiness therapy Note: 8/10 Auteur: Jack Spret |
Film: Happiness therapy Note: 6/10 Auteur: Alegas |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Ma Loute - 7,5/10

L’écart naval des animaux.
Un premier plaisir : voir Ma Loute imposé en sélection officielle et se voir représenter en partie la France dans une compétition internationale d’envergure. Imaginer l’embarras, l’incompréhension, les yeux qui s’écarquillent, l’ennui, voire quelques éclats de rire. Enfin, du mouvement.
Car il s’agit bien de cela : orchestrer la collision. A la suite du savoureux P’tit Quinquin, Dumont déploie son comique, quitte à nous faire craindre la répétition : l’enquête, le duo de flics improbable, l’idiome par borborygmes, et l’histoire d’amour à l’abri du monde. Mais c’est pour mieux reprendre les choses où il les avait laissées, et pousser tous les curseurs vers l’excès. Pour ce faire, deux nouveautés, et non des moindres : en faire un film d’époque, et convoquer trois gloires du cinéma français, (dont Binoche, aux antipodes de sa prestation dans Camille Claudel 1915) ingrédients bourgeois, intrusion d’un ordre ancien, d’une classe bourgeoise et moribonde selon le cinéaste, qui va exacerber la machine de destruction massive.
Il ne sera plus (maladroitement) dit que Dumont méprise les non-professionnels populaires qu’il a jusqu’alors embauchés : personne ne sort grandit de son ballet farcesque, et les dégénérés fin de race de la bourgeoisie se vautrent dans la consanguinité tandis que le bas peuple se venge d’eux par le cannibalisme : deux formes de régression, d’animalité, même, qui lorgnent autant du côté de la tragédie grecque que du grotesque muet.
Les intentions sont donc claires : confronter des mondes, les genres et les tonalités au profit d’un objet hybride où tout peut arriver. Travailler l’image avec un sens graphique d’une grande finesse, moins ostentatoirement beau que sur P’tit Quinquin ou Hors Satan, mais un peu brûlé, en hommage aux premières images colorisées de l’histoire du septième art. Organiser un cadre et une profondeur de champ fascinante pour faire cohabiter cette cohorte folle, notamment depuis le promontoire du Thyphonium, point de vue omniscient donnant accès au peuple comme aux bourgeois qui les envahissent. L’esthétique de Dumont est toujours aussi maitrisée, et travaille aussi, chose nouvelle, la musique, tardive mais puissamment lyrique, ainsi que les bruitages, omniprésents dans la veine burlesque, proche de l’orfèvrerie de Tati.
L’audace coûte cher : tout ne fonctionne pas, et les manques, le ridicule ou l’excès déconcertent autant qu’ils plombent. Dans ce récit fondé sur la cohabitation des contraires, le réalisateur marche sur un fil, et trébuche régulièrement. Ma Loute est un film contraignant, long, embarrassant, même, tant pour les comédiens que l’audace de son auteur, qui étire certains plans, insiste sur un ridicule qu’on préférerait éviter. Mais la somme de ces folies l’emporte sur ces instants de décrochage, pour peu qu’on accepte la lévitation proposée, au propre comme au figuré.
Car s’il recourt à la fantaisie la plus débridée, Dumont n’abandonne jamais la quête de la grâce : c’est notamment le cœur de son intrigue, non pas l’enquête, mais le point de jonction entre les deux mondes, cette mystification amoureuse entre le pêcheur et Billie, ce personnage androgyne dont on ne saura jamais vraiment le sexe (et, malice suprême, ne comptez pas sur le générique pour vous y aider…) : dans ce no man’s land sexuel, social et verbal, l’émotion vraie est possible. Aussi touchante que brutale, aussi chargée d’élan que rivée à la brutalité d’un monde souillé par sa barbarie animale ou ses déviances sociétales, l’histoire amoureuse existe et creuse des couches insoupçonnées de profondeur dans le récit.
Dès lors, pourquoi ne pas suivre la danse ? de Fellini (dont ce plan en lévitation au bout d’une corde rappelle furieusement l’un des rêves inauguraux de Huit et demi) à Dreyer, en passant par la bande-dessinée et Mack Sennett, des corps qui chutent, se cognent à ceux qui s’envolent, de l’indigeste cannibale à la sublimation collective, des (dés)illusions utopiques à la tragédie d’un monde mécanique, Dumont tire sur tout ce qui bouge avec une jubilation nouvelle, et parle toujours de la même chose : cette insondable et complexe humanité.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Café Society - 6,5/10

Design for loving
Le premier réflexe à avoir désormais face à la livraison annuelle d’Allen (7 mois seulement nous séparent du si pesant Homme irrationnel !) est de résister au procès d’intention. Savoir pourquoi on y retourne à chaque fois, et que lui reprocher des constances qui motivent notre fidélité serait tout de même pousser la mauvaise foi un peu loin.
Il faut aussi se souvenir de la gigantesque et prolifique filmographique du cinéaste pour tenter de faire le point sur ce qu’il nous propose depuis quelques temps. Des ratages, certes, mais aussi une capacité à toujours creuser le même sillon sans pour autant raconter les mêmes histoires. Un choix de casting sans cesse renouvelé qui permet à la jeunesse glamour du moment une récréation vintage et classieuse, comme l’avait fait Bogdanovich dans son dernier opus, Broadway Therapy. Une atmosphère unique, éculée, certes, un peu limée par endroits, où se mêle fascination pour les riches, réflexions philosophiques sous formes de boutades, le tout mâtiné d’un jazz qui caresse dans le sens du poil.
Le ballet de Café Society fonctionne, comme toujours, et lorgne cette fois du côté de Lubitsch : triangle, voire quatuor amoureux, hésitations, traits d’esprits, et jeu constant entre les hautes sphères sociales opposées à la misère amoureuse permettant de malmener gentiment les hautes figures du glamour contemporain. Le couple Stewart/Eisenberg est adorable, la reconstitution impeccable, le jeu sur l’opposition Los-Angeles/New York à l’origine de quelques saillies amusantes.
Car Allen poursuit ici sa quête insatiable d’un cinéma-musée, voyage dans le temps fantasmatique. On parle beaucoup de Radio Days, auquel le film fait effectivement penser : un retour nostalgique sur un âge d’or, qui faisait toute la réflexion du très limité Minuit à Paris, et se trouvait aussi dans Magic in the Moonlight. Le Hollywood des années 30 est ici l’occasion d’un name dropping assez épuisant (qu’Eisenberg a beau tourner en dérision, on ne nous le sert pas moins…), autocongratulation du cinéma américain qui occupait déjà les frères Coen dans Avé César. C’est amusant, tout au plus, mais ce n’est pas dans ce vernis qu’on trouvera de quoi épaissir nos personnages en quête de hauteur.
C’est toujours la même question : Allen n’excelle jamais autant que dans les portraits des seconds rôles (toute la famille de Bobby, ses beaux-frères, sa mère, sont l’occasion d’archétypes assez délicieux), tandis que les protagonistes souffrent de cette légèreté généralisée et peinent à émouvoir.
La vanité pourrait donc l’emporter, et Café Society se limiter à ce ballet joliment orchestré, mais dont l’amertume ne reste pas en bouche.
C’est sans compter sur un autre facteur qui lui aussi mérite qu’on tienne compte du passif du cinéaste : la mise en scène. Allen ne s’est jamais véritablement distingué par son sens visuel, misant tout sur l’incisif de ses répliques et le plaisir de ses intrigues.
Or, Café Society est plastiquement splendide : une photographie moirée, un travail sur la disposition des costumes dans ces plans d’ensembles mondains qui abondent, permettent à l’hommage de s’imposer avec un charme fou. La première séquence dans la villa au bord de la piscine illustre à merveille la beauté du film : mouvements aussi discrets que justes des travellings, superbe jeu de lumière et chromatisme rutilant, tout est absolument parfait.
Il serait malhonnête d’y voir là un cache-misère : l’hommage au cinéma passe aussi par le soin apporté à l’écrin qu’on lui dessine, et les personnages gagnent en épaisseur dramatique (des âmes esseulées dans un carnaval flamboyant) ce qu’ils peinent à distiller en émotion.
Un constat tout de même assez revigorant lorsqu’on constate que le réalisateur nous propose ici son cinquantième film, et qui peut même nous donner envie de voir les prochains.
Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
X-Men : Apocalypse - 4,5/10

First Past of Last Stand.
Au futur uchronique qui ouvrait Days of Future Past répond dans Apocalypse une remontée dans l’Antiquité Égyptienne : idée insolite, pour une séquence grandiose et assez jubilatoire dans laquelle on mélange le péplum et Angry Birds, un sens du grandiloquent, voire du kitsch, qui pèse ses images dans sa volonté de proposer l’épique le plus rutilant.
Puisque l’on visite toute l’Histoire sous l’égide des mutants, le très travaillé générique, toujours sous la forme de ce vortex caractéristique, s’organise sous forme de frise chronologique, poursuivant cette ambition démesurée.
S’arrêter à cette forme folle pourrait sauver ce nouvel opus ; ce serait oublier qu’il a pour charge de raconter une histoire. Autant First Class et Days of Future Past renouvelaient la franchise, autant ce paroxysme annoncé joue la carte de la paresse.
Le méchant annuel, divinité qui se voudrait à la croisée d’un Empereur de Star Wars et de La Vision des Avengers n’a d’autre projet que d’éradiquer la race humaine, et nos mutants de l’aider ou non.
Point.
La race humaine est face à eux complètement larguée, reléguée à l’arrière-plan et dans une panique à peu près totale, ce qui, reconnaissons-le, est plutôt jouissif quand il s’agit de gérer l’arsenal nucléaire ou de lâcher un Wolverine plus bestial que jamais dans une base militaire.
La principale inquiétude du film gravite autour de l’équilibre à maintenir dans sa dimension chorale : Magneto, Xavier et Jean sont les personnages les plus importants, et si l’on revient sur la genèse de quelques mutants, rien ne permet de leur donner une véritable personnalité. La gestion des différents plans d’action est fluide, dénuée de temps morts, mais justement sans aspérité, engoncé dans un cahier des charges trop lourd à porter. On pourra sauver quelques idées dans le combat par l’esprit des trois protagonistes, qui permet une couche supplémentaire au final, mais celui-ci n’échappe pas à la bouillie numérique qui avait déjà biens souillé le troisième épisode.
(Spoils à venir)
On attendait un sommet avec la nouvelle intervention de QuickSilver, qui à elle seule résume bien des soucis des blockbusters : faire mieux, plus loin, plus long, plus spectaculaire. A la douceur spiralaire de l’opus précédent succède ici une gigantesque explosion sur Eurytmics, (caution années 80) et un pendant très cartoon. C’est amusant, certes, mais dénué de la poésie initiale, inféodé sur du grandiloquent qui perd de la finesse qu’on connaissait au personnage.
Ce qui fâche vraiment s’accroit à mesure que le film avance : une sous-intrigue totalement dispensable permettant, une fois encore, à Magneto de justifier qu’il en veuille à la terre entière, une réunion des quatre serviteurs du mal qui vont ouvrager à la fin du monde avant de se dire que tout de même, ce serait un peu excessif en matière de colère.
Cette manière totalement hypocrite de résoudre une intrigue qui n’avait déjà pas de saveur rappelle bien entendu l’escroquerie Civil War : c’était pour de faux, hein, vous savez bien.
D’où une énième accolade Magneto/Xavier, qui se rapproche de plus en plus du premier volet puisqu’à la perte de ses jambes, il ajoute désormais celle de ses cheveux.
Les jeunes recrues sortent d’un cinéma après avoir vu Le Retour du Jedi, et expliquent que dans une franchise, le troisième épisode est toujours le plus nul, séquence méta bien lourde. La question est de savoir si Bryan Singer fait référence à l’épisode trois, qui clôturait une première trilogie, ou celui-ci, qui est le sixième…Tous deux sont effectivement sur bien des points les plus fragiles de la franchise.
Critiques similaires
| Film: X-Men : Apocalypse Note: 5,5/10 Auteur: Mark Chopper |
Film: X-Men : Apocalypse Note: 5/10 Auteur: Alegas |
Film: X-Men : Apocalypse Note: 1/10 Auteur: Scalp |
Film: X-Men : Apocalypse Note: 4/10 Auteur: Milkshake |
Film: X-Men : Apocalypse Note: 5,5/10 Auteur: Hannibal |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Mort aux trousses (La) - 10/10

Paths of story.
La mort aux trousses a ceci de grandiose que c’est un film entièrement dévolu au plaisir. On pourrait en faire une critique extrêmement brève, expliquant qu’aux origines du blockbuster se situe cette œuvre matricielle, qui a absolument tout compris de ce qui fait vibrer le spectateur.
Hitchcock a expliqué un jour que le peintre, lorsqu’il peint un arbre ou une corbeille de fruit, se soucie peu de la nature de ce qu’il représente : quelle pomme, quel arbre, qu’importe : c’est le regard qui compte ; cette réponse donnée sur sa manière de filmer explique en peu de mots le génie fondateur du réalisateur qui a pris le cinéma dans son entière spécificité. D’où le MCGuffin, d’où l’attention portée à la mise en scène d’un voyeur hors pair, capable de vous faire jubiler sans que vous sachiez vraiment pourquoi : un magicien.
La particularité de La mort aux trousses est d’ajouter à cette virtuosité l’un des scénarios les plus parfaits de sa filmographie. Dès lors, le qualificatif de chef d’œuvre s’impose.
La mort aux trousses est un film sur le trajet : de son titre originel en forme d’indication topographique à la diversité des moyens de transport, de sa course folle de New-York au Mont Rushmore, du nord au nord-ouest, c’est la quête d’un homme qui a perdu le nord et qui va reconquérir l’Amérique, une âme et une âme sœur. Rien que ça.
La façade fantastique de Saul Bass qui ouvre le film indique de multiples directions, et nous plonge, à travers l’architecture dans une plongée sur la fourmilière parmi laquelle le sort va extraire un quidam dénué de tout intérêt particulier. Quand Hitchcock choisit son innocent, il est traqué jusqu’au bout : à ce plan initial répond la fabuleuse prise de vue depuis le siège des Nations Unies où l’être esseulé court seul, dans une vision cauchemardesque.
Thornhill, c’est l’homme vide : le O ajouté à ses initiales, ROT, le pourrit comme le néantise. Dans le giron de maman, ayant épuisé deux mariages, il est ironiquement condamné par le sort à prendre les traits d’un fantôme : manipulé, ballotté, sa quête le conduira, via le dépouillement le plus total (enivré, déshabillé, les lunettes brisées, mordant la poussière) à dépasser les instances qui tirent les ficelles pour faire triompher l’individu et l’amour.
Pour ce faire, il s’agit d’investir, sous le patronage du metteur en scène, toutes les instances visitées par le cinéma : l’espace, la stratégie, la foule et les cœurs.
L’espace, de la ville à la montagne, d’un trajet en train dans lequel il fait fausse route (la séduction d’Eve) à la pénétration d’un tunnel qui chante sa victoire, voit défiler tous les paysages, des cœurs névralgiques du pouvoir (l’ONU) aux antichambres de l’espionnage (les résidences de campagne).
La stratégie, c’est la convergence du regard de Thornhill avec le point de vue omniscient d’Hitchcock : d’abord perdu, dans des plans d’ensemble qui ne cessent de montrer, en arrière-plan, des menaces qu’il ne voit pas, l’apprenti héros s’initie à lire entre les lignes : la fausseté d’Eve, la tentatrice somptueuse et glaciale de duplicité, les routes trop droites pour un rendez-vous en plein champ, les statues trop rebondies pour être creuses... Thornhill est devenu un héros, lorsqu’il en sait davantage que chaque camp, et qu’il peut balancer son nom gravé sur une boite d’allumette : son identité est devenue salvatrice, parce qu’il existe enfin.
La foule, dont il est issu, et qui commence par le condamner, devenu ennemi public. L’intelligence hitchcockienne se loge dans la réversibilité : faire de ses angoisses un atout : lorsqu’il se noie dans la foule avec la casquette d’un contrôleur ou qu’il se distingue volontairement parmi le public de la vente aux enchères, Thornhill se mêle, puis s’extrait pour sauver sa peau… et s’offrir une véritable individualité.
Le cœur, enfin : romance vénéneuse, La Mort aux trousses est un voyage des jupes de maman à la rencontre avec un alter ego sous les fourches caudines de délicieuses chausse-trappes. On aura rarement vu de telles montagnes russes mélodramatiques, durant lesquelles on ne sait comment comprendre une femme qui se jette dans les bras d’un homme qu’elle avait envoyé à une mort certaine, ou dans le mouvement de ses doigts sur son cou avant d’y glisser un mot doux à l’autre bout du compartiment.
Hitchcock l’a compris : le plaisir provient du trouble : tout est suspect, tout est menace. Une main sur une épaule, une blonde, un avion épandeur. Cette fameuse scène cristallise à elle-seule la malice par l’artisan de l’angoisse : un rendez-vous digne d’un film noir pris totalement à contrepied : dans un champ, en plein jour, sans musique, introduit par une lenteur qui semble annoncer la jouissance rythmique des futurs Sergio Leone : un western clivé, un Duel avant l’heure, dont la gestion de la profondeur de champ (dans les deux sens du terme) annule toutes les prouesses technologiques qui s’échinent depuis dans une 3D stérile.
Le maitre a tout dit. Après lui, le déluge du film de divertissement : le blockbuster est né. Descendants, copistes, auteurs en quête du thrill, souvenez-vous : à son origine, il racontait la quête d’une âme.
Critiques similaires
| Film: Mort aux trousses (La) Note: 7/10 Auteur: Milkshake |
Film: Mort aux trousses (La) Note: 6,5/10 Auteur: lvri |
Film: Mort aux trousses (La) Note: 10/10 Auteur: jean-michel |
Film: Mort aux trousses (La) Note: 10/10 Auteur: johell |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Re: X-Men : Apocalypse - 4,5/10
Nulladies a écrit:Au futur uchronique qui ouvrait Days of Future Past répond dans Apocalypse une remontée dans l’Antiquité Égyptienne : idée insolite, pour une séquence grandiose et assez jubilatoire dans laquelle on mélange le péplum et Angry Birds,
C'est exactement la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu la scène.

-

Kakemono - Spiderman

- Messages: 10249
- Inscription: Mer 10 Mar 2010, 16:38
- Localisation: Dans la Ville rose
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
Kakemono a écrit:Nulladies a écrit:Au futur uchronique qui ouvrait Days of Future Past répond dans Apocalypse une remontée dans l’Antiquité Égyptienne : idée insolite, pour une séquence grandiose et assez jubilatoire dans laquelle on mélange le péplum et Angry Birds,
C'est exactement la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu la scène.
Je sais pas si pour le coup, on peut dire que les grands esprits se rencontrent...

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Business is Business - 6/10
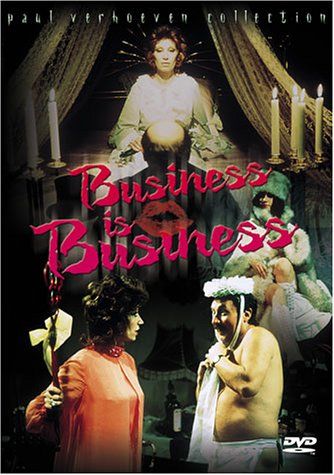
Expansion du domaine de la pute.
Le premier long métrage de Verhoeven est sur bien des points une ébauche de ce qui fera la suite de sa longue et prolifique filmographie. Ebauche, parce qu’il faut bien reconnaitre qu’on est là face à un brouillon qui a beaucoup vieilli et qui ne fait pas montre d’une ambition démesurée : les 70’s sévissent en diable, tant dans l’image que la musique (on se croirait dans les comédies françaises avec Pierre Richard…) et l’aspect comédie est souvent très limité : tartes à la crème, gags poussifs tombant à plat, on est bien plus proche du gras de Benny Hill que du souffre d’un Fassbinder.
Il reste que certains germent apparaissent çà et là pour indiquer les grandes directions à venir : le portrait de femme, évidemment, à travers le quotidien de deux prostituées qui sera repris avec plus d’ampleur dans Kattie Tippel, l’une d’entre elle se caractérisant par une audace à toute épreuve. Cette façon débridée de suffisamment connaitre la (basse) nature humaine pour pouvoir rire au nez des tenanciers de l’ordre moral traverse tous les films à venir, de Turkish Délices à Spetters, de La Chair et le Sang à Showgirls jusqu’à Black Book : la prostituée, la prédatrice sexuelle est un grand coup de pied dans les bijoux de la couronne, et une exploitation du monde phallocrate par ses faiblesses les plus évidentes.
Si le récit reste très convenu (en somme, le choix à faire entre poursuivre son métier ou rentrer dans le rang, devenir mère ou rester fille), c’est surtout le portrait de la gent masculine qui mérite le détour : maris pathétiques, compagnons brutaux, naïfs dépensiers : les hommes brillent par leur médiocrité. Et ce n’est pas les tentatives d’insertion sociale, sur le modèle Pretty Woman, qui permettront une pacification : pour Greet, l’indépendance est non négociable et la société figée un second plan à balayer du revers de la main.
Au-delà de cette dimension idéologique, c’est surtout sur la mise en scène des fantasmes que Verhoeven s’amuse le plus : vaste panorama de toutes les perversions, du SM à l’infirmière en passant par la maitresse d’école, Greet est la comédienne parfaite de l’imaginaire déluré des mâles frustrés. Le grand point commun de toutes ces scénettes reste le ridicule, et le sourire en coin de la salariée qui domine l’homme par sa tige insatiable et ses désirs régressifs, jolie figure du cinéaste naissant, et qui creusera ce sillon dans les décennies à venir.
Critiques similaires
| Film: Business is Business Note: 7/10 Auteur: Dunandan |
Film: Business is Business Note: 6,5/10 Auteur: osorojo |
Film: Business is Business Note: 8/10 Auteur: Jed_Trigado |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Elle - 8/10

Guérir les mâles par le mal.
En seulement deux films sortis simultanément en salle, la sélection cannoise 2016 annule la fadeur de la précédente : Elle rejoint Ma Loute dans cette catégorie indéfinissable de film aussi déconcertant que revigorant, témoins de la vitalité du cinéma et des heureuses prises de risque que peuvent encore prendre les auteurs.
La filmographie de Verhoeven est toujours un événement : suite à son retour fracassant au cinéma hollandais avec Black Book il y a dix ans, on le savait suffisamment libre pour faire tout ce lui chante. Après une expérience ratée avec la télévision (Tricked), c’est la France qui l’accueille sur ses terres auteuristes, grâce à l’adaptation du vénéneux roman de Philippe Djian.
Il est impossible de faire le tri dans l’incroyable foisonnement narratif de ce nouvel opus : le spectateur est assailli par les propositions scénaristiques comme l’est le personnage de Michèle, par un violeur dans la première séquence du film, mais aussi par toute cette collectivité dont elle est le pivot. De son père à son petit-fils, de son amie à son amant, de son ex à la nouvelle conquête de sa mère, de ses voisins à ses employés, la foule des prédateurs est bigarrée, et la folie, plus ou moins douce se décline en autant de perversions.
Elle restitue le parcours d’une victime qui refuse ce statut. Ce rôle, taillé pour la stature de la comédienne unique au monde qu’est Isabelle Huppert, va occasionner autant de malentendus que de choix déconcertants.
Le film commence par jouer sur les terres de Basic Instinct, un thriller relativement convenu où se pose un temps la question de l’identité du violeur et de sa capacité à harceler sa victime. Mais dans ce jeu du chat et de la souris, (thème majeur du film, le premier plan s’ouvrant sur un félin contemplant la scène du viol, avant de revenir à plusieurs reprises dans cette histoire, souvent au profit de jump-scares plus ou moins comiques), Verhoeven refuse bien évidemment le rôle traditionnellement dévolu à la femme. Dans la lignée de ses femmes qui prennent à bras le corps la violence et la vulgarité de ce monde phallocrate, (dès Spetters, puis dans Katie Tippel, La Chair et le Sang, Black Book et bien sûr Showgirls) Michèle prend le contrôle.
Le sujet du film n’est pas tant la revanche que les moyens tordus de parvenir à se sentir maitre d’une situation. Sur tous les fronts – au point qu’à certains moments, on en oublie le viol et ses conséquences -, Michèle va au-devant de ce qui pourrait la contraindre : rencontrer la petite-amie de son ex-mari, par exemple, éventer sa relation adultère, ou révéler le terrible secret d’une tuerie originelle qu’on nous révèle au compte-goutte. Pour vivre, elle s’approprie les vérités et révèle les mensonges, braquant sur le fantasme généralisé (les hommes prennent très cher dans ce film) un projecteur qui en dévoile tout le ridicule. Michèle a un mot d’ordre : agir et devancer. En offrant aux hommes ce qu’ils désirent secrètement, elle les prive de ce besoin de l’obtenir grâce à leur illusoire charme (son amant, son fils aussi par l’argent, son ex par la jalousie) ou par la force. Du viol, elle fait un choix personnel qui la conduira à un orgasme aussi dérangeant que libérateur, précédé d’une masturbation sur la nativité qui rejoint le goût inné de Verhoeven pour la provocation, déjà à l’œuvre dans Turkish Délices ou Le quatrième homme.
C’est là le point le plus subtil et déconcertant du récit : sa capacité à jongler avec toute la diversité des registres. Policier et soap parodique, comédie bourgeoise à la française et marécage psychanalytique, toute la palette est convoquée dans cette gigantesque catharsis. Inutile de tenter de tout expliquer dans ces comportements déviants : il ne s’agit pas tant de se cacher derrière le masque confortable de la folie, mais de montrer à quel point chaque membre de cette communauté la partage sur un plan. Contrôler la situation, c’est regarder le psychotique dans les yeux et jouer selon les règles de son jeu à lui, alors qu’il ne les connait souvent pas lui-même.
Conte noir, Elle brille aussi de l’éclat sombre de l’immoralité : tuer le père, répandre les cendres de la mère ou inscrire son fils dans une tradition familiale du meurtre purificateur ne sont jamais des actes symboliques. Et si les femmes sont les grandes victorieuses (Michèle, mais aussi Anne, l’amie fusionnelle, et Rebecca), c’est parce qu’elles font leur la monstruosité ambiante. La dernière réplique de Rebecca est en cela terrible de lucidité, et dite avec ce même visage qui a éclairé celui de Michèle tout au long du film, aussi dérangeant que fascinant, témoin d’un dépassement et d’une intelligence redoutable : un sourire.
Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Julieta - 7,5/10

Mauvais aloi du silence.
Le hasard veut que le dernier film que j’ai vu d’Almodovar soit La mauvaise éducation, soit il y a douze ans. Douze ans de silence, d’une rupture passive (quatre films ignorés) mais sans regrets, soit précisément ce qui caractérise la relation de Julieta et sa fille.
Ce sont les permanences qui rassurent lors des retrouvailles, et ce film porte en bien des points la marque de son réalisateur : une histoire de femme, de maladie, de deuil et de culpabilité, des portraits avec des châles et des lunettes noires, des enquêtes et des mensonges.
Almodovar organise son récit comme un puzzle. A partir d’un double cliché, une photo déchirée d’elle et de sa fille qu’elle va réassembler avant d’entamer par écrit le récit rétrospectif de ce qui les a conduites à la rupture, les différents éléments vont progressivement s’emboiter par le biais de flashbacks qui phagocytent le récit principal. Les thèmes chers au cinéaste sont certes un brin galvaudés, et certaines situations forcées pour que la tragédie mélodramatique fonctionne. On ne s’embarrassera pas toujours de questionner la crédibilité des comportements ou des solutions qui existaient pour que la rupture soit moins radicale, car ce n’est pas vraiment la question.
La musique d’Alberto Inglesias le souligne, oscillant entre le lyrisme mélancolique et les atmosphères mouvantes du film noir : Julieta est plus proche du conte que de la chronique familiale, du thriller sentimental que de la tranche de vie. Deux modèlent planent clairement sur ce film, Hitchcock et Sirk, jusque dans le travail de l’image, qui mérite vraiment d’être salué. La photographie insiste en effet dès le départ sur les matières : le plan qui ouvre le film, sur la robe rouge de Julieta, puis les teintes très vives de sa cuisine, et enfin le blanc du papier. Cette couleur crue se retrouvera dans toute la chronologie du récit, à la faveur notamment d’un retour dans les années 90 et des teintes électriques qui le caractérisent. Le bleu des collants et du pull-over de Julieta sur le velours rouge des siège du train dialogue efficacement entre deux époques : celle du souvenir, mais surtout celle de l’idéalisation d’un fantasme comme seul l’âge d’or hollywoodien savait les magnifier. On retrouve les chromes de Vertigo comme ceux de Sirk, auxquels Todd Haynes avait déjà rendu hommage il y a quelques années dans Loin du Paradis. Ces emprunts assumés le sont par un motif récurrent dans le film, l’écran des fenêtres : dans le train, bien sûr, notamment pour cette belle apparition du cerf, et dans lequel se reflètera la première nuit d’amour entre Julieta et Xoan ; mais aussi celle donnant sur la mer, et tout le motif qu’elle suppose, très largement appuyé par les références à Homère et l’Odyssée que ne cesse de faire la protagoniste dans ses cours.
Les hommages au passé fastueux du cinéma américain alliés au goût pour l’emphase d’Almodovar pouvaient provoquer bien des excès ; c’est là que le cinéaste fait montre d’une pudeur tout à fait pertinente. Julieta, par son culte du secret et sous l’égide d’un double deuil qu’on croit digne parce qu’on n’en parle pas, traite de la méconnaissance et de l’incommunicabilité. De ce fait, la multiplicité des actrices, le changement d’apparence physique matérialisent ce mystère insondable qui fait un individu, ses revirements et ses décisions incompréhensibles. La gestion des ellipses et du temps qui passe, notamment lors de ce splendide raccord entre deux actrices grâce à une serviette posée sur la tête, fascine autant qu’elle donne à voir les béances d’une vie.
(Spoils)
Si l’on peut trouver un peu forcé le motif des retrouvailles (la mort d’un fils de Julieta lui fait prendre la mesure de ce que sa mère doit endurer à être privée de sa présence), il s’inscrit dans un motif de répétition qui sature tout le film : des femmes malades, des hommes qui les trompent (le père de Julieta, puis son mari), et la vie qui continue en dépit d’une mort qui rode. De ce fait, la rencontre laissée en suspens entre la mère et la fille garde intacte ce à quoi personne n’a eu accès. Le récit se contentait de prendre acte d’un silence, et de le briser. Ce qui se jouera par la suite, est un autre film, une autre vie.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Tricked - 3/10

Pas nettes erreurs.
Le voilà enfin, le petit opus vraiment honteux de la filmographie de Verhoeven, mais pour lequel on peut trouver bien des circonstances atténuantes.
Diffusé en DTV, de façon assez confidentielle et apparemment limitée aux Pays Bas, Tricked est avant tout une expérience alternative en matière de production et d’écriture, puisqu’il s’agit pour le cinéaste de s’essayer au sourcefunding : un début de scénario donne lieu à un développement par les internautes, qui suivent progressivement le tournage et interagissent en fonction de ce qui est montré.
Visiblement, Verhoeven lui-même a pris ses distances avec le produit fini et ne semble pas prêt à renouveler l’expérimentation. On lui reconnaitra le mérite d’avoir essayé, mais c’est à peu près tout.
Téléfilm assez minable, le récit commence comme une sorte de Festen insipide (anniversaire et règlement de comptes sur le papa queutard invétéré) pour se poursuivre dans des histoires de manipulations dignes des pires soaps. Résolutions à l’arrache, jeu inepte, rien ne semble porter la patte du cinéaste, à une exception près, et qui fait froid dans le dos si on la doit à des internautes ayant peut-être vu là une forme d’hommage : la vue en gros plan, à l’intérieur d’une cuvette, d’un tampon imbibé de sang. Il est vrai que dès Turkish Delices et jusqu’à Showgirls, en passant par Black Book et sa douche fécale, Verhoeven a toujours eu un rapport malicieux avec les excrétions. Mais c’est ici tellement minable, sans intérêt et forcé qu’on ne peut que reprocher au cinéaste d’avoir accepté de descendre aussi bas.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Pusher - 6,5/10

Glauque around the clock
Etonnant parcours que celui de Refn : remonter aux sources de sa filmographie ne laisse pas supposer les dérives esthétisantes qui font la patte de ses dernières œuvres ; c’est même le contraire qui caractérise la trilogie Pusher, dont ce premier volet se veut une petite claque bien rêche dans le monde si éprouvé du film de gangsters.
Pusher, c’est l’immersion dans le quotidien sans fard de petits pions d’un système, celui du trafic de stupéfiant. Nulle dimension internationale ou hagiographie du gangster ici : la principale ambition du récit semble plutôt de mettre à plat les mécanismes de la nécessité, et la façon dont chaque maillon de la chaine se trouve à la fois acteur du processus et rendu prisonnier par lui. Frank, dealer minable, se situe en son bout, poids mort qui se retrouve avec une dette impossible à rembourser suite à la perte d’un lot important face à la police.
La première partie le voit dans un quotidien en tout point méprisable (petites combines, conversations ineptes et vulgaires avec un coéquipier, rôle aussi minable qu’incandescent porté par Mads Mikkelsen) qui lorgne du côté de Clerks ou des échanges de Reservoir Dogs, la pose en moins : il ne s’agit pas ici de faire rire, de cynisme ou d’ironie, mais d’une confrontation brutale à un milieu par lequel et dans lequel on va crever, tout simplement. La seconde partie s’organise ainsi comme une course contre la montre de plus en plus désespérée, dont la circulation de la dette illustre le désespoir croissant : tout le monde se doit de l’argent, tout le monde recours aux mensonges et aux esquives, et dans ce vaste marché de dupe, on espère une seule chose, voir un autre s’effondrer à sa place.
Son direct, lumière au néon, caméra à l’épaule : l’illusion documentaire, accentuée par une interprétation saisissante donnant souvent l’impression d’être improvisée, génère un double effet particulièrement efficace : la captation sur le vif d’une violence quotidienne, et la laideur des bas-fonds généralement occultés.
Les illusions coutumières sont égrenées pour mieux confirmer l’absence de tout espoir : une mère ruinée, une petite amie étrange, vaguement associée dans le business, vaguement prostituée, face à laquelle on ne sait plus trop quoi exiger ou reprocher, un binôme qu’on fracasse dans un bouge, une utopie en Espagne : l’avortement de chaque piste voit se répandre une noirceur de laquelle il sera impossible de sortir.
Dans cette fange urbaine, la vie est un sursis, et c’est bien de cette urgence que sourd progressivement une humanité pourtant malmenée : Frank, dans sa course pathétique, dans ses arrangements minables, devient le porte-parole mutique de l’individu broyé par la misère et les mauvais choix qu’elle engendre.
Le final suspendu ne dit pas autre chose : le cauchemar ne va pas nécessairement s’achever en sacrifiant aux lois du romanesque : le faire perdurer dans ces minables esquives du réel sert beaucoup plus la démonstration sans compromis de ce qu’est l’enfer sur terre.
Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

