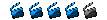•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE CONGRÈS
Ari Folman | 2013 | 7.5/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
« Un p'tit smarties pour Maman »
Épuré de son premier tiers, Le congrès eut été un formidable terrain d’expression, un essai dystopique unique à la puissance folle. Mais c’eut été sans compter sur la soif revendicatrice d’Ari Folman qui amorce la séance par une réflexion maladroite sur un certain cinéma contemporain, qui tend à remplacer la performance d’acteur par des calculs informatiques. Un peu balourde et graveleuse, toute la partie « monde réel » qui initie le congrès est bien trop poussive et surtout fait l’impasse sur l’émotion. Harvey Keitel et Robin Wright ont beau se débattre pour faire vibrer la corde sensible au sein d’une sphère aux milles lumières, l’encéphalogramme émotionnel reste désespérément plat.



Puis un torrent de couleurs acidulées d’un monde fantasmé envahit le cadre avec violence pour dessiner formes et personnages aux mille et une facettes. Déroutante dans les premiers instants, une direction artistique psychédélique ôte au cadre la morosité ambiante laissée par l’introduction : Le congrès atteint enfin sa pleine expression. Les idées d’animation s’enchaînent, et petit à petit, l’émotion se fait une belle place dans le sous texte rageur d’Ari Folman. D’une part, le nombrilisme du premier quart d’heure s’estompe, Robin Wright devient un personnage qui se libère de la figure lui ayant donné vie et d’autre part, le propos corrosif qui porte l’ensemble s’élargit, dérivant sur une réflexion bien plus universelle que l’illustration de la politique d’enfoiré que mènent des studios de production trop gloutons.



Une fois libéré du pitch qui l’a mis sur les rails de l’oisiveté visuelle, Le congrès déroule un riche tapis de thématiques aux multiples lectures possibles. Outre l’instinct maternel qui enrobe le discours, Ari Folman lance des pistes de réflexions passionnantes, comme le refus de se laisser emporter par le temps qui passe, ou bien l’abandon de sa propre individualité pour un bonheur fantasmé vécu à travers le regard des autres, ou encore ce mythique choix entre pilule rouge et bleue, entre réalité désenchanté et bonheur synthétique ressenti comme réel (comme dirait oncle Cypher, les ignorants sont bénis).
Difficile cependant de boucler autant de pistes : conséquence directe, la fin renoue en partie avec la monotonie du début, mais elle parvient néanmoins à conserver l’émotion que la poétique Robin est parvenue à rendre à l’écran par ses traits non définis, rendus malléables à l’infini par une technique d’animation impressionnante.



On touche là le cœur doré de ce congrès. Si Ari Folman et son équipe avaient déjà prouvé avec Valse avec Bachir qu’ils étaient formellement capables du meilleur, ils vont bien au-delà dans ce nouveau fait d’arme, touchant du doigt l’excellence graphique. L’animation est fluide, les idées de transition entre les dessins sont magiques et génératrices d’une poésie visuelle hypnotique qui atteint son paroxysme lorsque le réalisme laisse place à l’onirisme. Il n’y a que les différents clins d’œil à la pop culture qui semblent superflus, parce que trop solidement ancrés dans un réel qui rappelle à l’ordre les rêveurs.
Un choix qui se défend, parce qu’il est dans la lignée du sujet certes, mais qui sur la distance dérange : je me serais bien passé de voir le père Clint tirer la tronche ou d’assister à la reconversion en serveur du king of pop alors que j’étais plongé, corps et âme, dans un monde surréaliste magnifiquement inspiré.