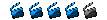[oso] Ma prose malade en 2016
Modérateur: Dunandan
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
De la grosse merde en boîte Snowpiercer, j'en rigole encore de cette fin.
-

logan - Spiderman

- Messages: 10724
- Inscription: Lun 25 Aoû 2014, 21:47
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Résumer un film à une fin. 

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50860
- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05
- Localisation: In the Matrix
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Ben ouais, c'est pas important la fin Logan.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22277
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Barry Lyndon - 6/10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BARRY LYNDON
Stanley Kubrick | 1975 | 6/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
« Sympathique salopard »
Il y a dans Barry Lyndon un certain paradoxe qui peut maintenir à distance le plus volontaire des spectateurs. Un déséquilibre latent qui tend à lier une mise en scène chirurgicale et une narration d’un didactisme tel qu’elle ôte, à quiconque voudrait s’investir, le droit de s’impliquer moralement dans l’histoire racontée. Peu importe, finalement, la réflexion qu’il pourrait initier, Kubrick concentre tous ses efforts à la livraison de la prouesse technique pour laquelle il est connu. Si habituellement, la froideur de ses récits paraît servir son sujet (le vide d’un voyage spatial dans 2001, l’épure émotionnelle des porteurs de mort de Full Metal Jacket ou encore le malaise d’une violence complice dans Orange mécanique), elle paraît plus difficile à défendre ici tant elle génère de la distance avec un sujet qui ne demandait pourtant qu’à construire des personnages charismatiques.
En lieu et place d’une fresque épique dans laquelle chacun pourrait choisir son camp, Kubrick se lance dans une illustration, certes artistique, mais aussi très scolaire, d’une époque délicate à cerner. Du fleuve enragé promis émane la curieuse impression de naviguer à contre-courant, en eaux calmes, loin des remouds où l’action prend place : à chaque barrage potentiellement porteur d’un peu d’animation, le professeur d’histoire reprend les commandes et continue son récit de manière conventionnelle, pour initier un énième bond temporel dans le futur du très détestable Barry Lyndon. Pendant 3 heures plus ou moins bien rythmées —la dernière heure souffre de quelques longueurs— les scénettes s’enchaînent avec soin, sans autre but cependant que de se rapprocher du point de raisonnement du cinéaste : n’en veuillez pas aux enfoirés, ni à ceux qui ont la belle vie, une fois morts et enterrés, nous sommes tous égaux. Une morale un peu particulière, que l’on pourrait entendre chez Francisque après quelques pastis lourdement servis.
Dans Barry Lyndon, le XVIIIème siècle se veut réaliste mais il est curieusement retranscrit. Certes l’opportunisme des hautes sphères y est amusant à suivre, mais il est bien difficile de se sentir concerné par une époque où le libertinage se consomme pudiquement, les duels au pistolet se livrent sans haine, les soldats font la guerre sans hargne et les hommes s’y échangent leur condition sociale sans broncher. A cela s’ajoute l’idée saugrenue de faire muter certains personnages, telle cette mère paysanne aimante qui se transforme en marâtre froide et calculatrice au parler noble parfaitement éprouvé. Toutes ces ramifications cavalières, d’une histoire qui se voulait réaliste et désabusée, recouvrent la reconstitution d’époque d’un voile factice assez dérangeant. Certes, un second degré subtil enrobe la démonstration de Kubrick, mais à force de naviguer entre différentes tonalités, le récit perd une partie de sa cohérence et certains acteurs, comme le pleutre général qui convoite la cousine du tenace Barry, semblent avoir du mal à trouver la juste partition.
Plastiquement parlant, par contre, Barry Lyndon impressionne. Les séquences filmées en intérieur à la lumière des bougies constituent un réel tour de force, et certains passages sont portés par une photographie qui reste en rétine, à l’image du duel parricide final : rarement une grange et quelques pigeons n’auront généré autant d’esthétisme. Se retrouvent indéniablement à l’écran la singularité visuelle de Kubrick : une précision chirurgicale en matière de composition d’image. Pour autant, sa mise en scène manque d’une once supplémentaire d’inspiration, car si les plans magnifiques se succèdent, ils manquent cependant d’idées lorsqu’il est question d’inviter le mouvement. Au bout du cinquième recourt au zoom arrière pour introduire une nouvelle séquence, une certaine lassitude s’installe.
Heureusement elle est vite contrebalancée par un Ryan O’Neil qui bouffe l’écran avec un rôle délicat qui est loin de le glorifier, et par les électrons plus ou moins libres qui gravitent à ses côtés, totalement investis. Marisa Berenson, notamment, en épouse délaissée qui sombre peu à peu dans la folie ou encore Leon Vitali, seul vrai personnage touchant, voir humain, d’un récit parfois trop rocambolesque. Une composante essentielle qui permet au portrait d’homme que tisse Kubrick d’imposer un certain respect malgré les réserves qu’il peut susciter.
Pour ma part, même si je n’ai pas spécialement adhéré au voyage, je salue l’initiative à son origine, ainsi que l’audace dont y fait preuve son auteur. Sans céder aux sirènes du divertissement grand spectacle, il tente de livrer un film plus ou moins réaliste, ambigu, désespéré et désespérément froid. Tout simplement trop à mon goût, cette fois-ci.
En lieu et place d’une fresque épique dans laquelle chacun pourrait choisir son camp, Kubrick se lance dans une illustration, certes artistique, mais aussi très scolaire, d’une époque délicate à cerner. Du fleuve enragé promis émane la curieuse impression de naviguer à contre-courant, en eaux calmes, loin des remouds où l’action prend place : à chaque barrage potentiellement porteur d’un peu d’animation, le professeur d’histoire reprend les commandes et continue son récit de manière conventionnelle, pour initier un énième bond temporel dans le futur du très détestable Barry Lyndon. Pendant 3 heures plus ou moins bien rythmées —la dernière heure souffre de quelques longueurs— les scénettes s’enchaînent avec soin, sans autre but cependant que de se rapprocher du point de raisonnement du cinéaste : n’en veuillez pas aux enfoirés, ni à ceux qui ont la belle vie, une fois morts et enterrés, nous sommes tous égaux. Une morale un peu particulière, que l’on pourrait entendre chez Francisque après quelques pastis lourdement servis.
Dans Barry Lyndon, le XVIIIème siècle se veut réaliste mais il est curieusement retranscrit. Certes l’opportunisme des hautes sphères y est amusant à suivre, mais il est bien difficile de se sentir concerné par une époque où le libertinage se consomme pudiquement, les duels au pistolet se livrent sans haine, les soldats font la guerre sans hargne et les hommes s’y échangent leur condition sociale sans broncher. A cela s’ajoute l’idée saugrenue de faire muter certains personnages, telle cette mère paysanne aimante qui se transforme en marâtre froide et calculatrice au parler noble parfaitement éprouvé. Toutes ces ramifications cavalières, d’une histoire qui se voulait réaliste et désabusée, recouvrent la reconstitution d’époque d’un voile factice assez dérangeant. Certes, un second degré subtil enrobe la démonstration de Kubrick, mais à force de naviguer entre différentes tonalités, le récit perd une partie de sa cohérence et certains acteurs, comme le pleutre général qui convoite la cousine du tenace Barry, semblent avoir du mal à trouver la juste partition.
Plastiquement parlant, par contre, Barry Lyndon impressionne. Les séquences filmées en intérieur à la lumière des bougies constituent un réel tour de force, et certains passages sont portés par une photographie qui reste en rétine, à l’image du duel parricide final : rarement une grange et quelques pigeons n’auront généré autant d’esthétisme. Se retrouvent indéniablement à l’écran la singularité visuelle de Kubrick : une précision chirurgicale en matière de composition d’image. Pour autant, sa mise en scène manque d’une once supplémentaire d’inspiration, car si les plans magnifiques se succèdent, ils manquent cependant d’idées lorsqu’il est question d’inviter le mouvement. Au bout du cinquième recourt au zoom arrière pour introduire une nouvelle séquence, une certaine lassitude s’installe.
Heureusement elle est vite contrebalancée par un Ryan O’Neil qui bouffe l’écran avec un rôle délicat qui est loin de le glorifier, et par les électrons plus ou moins libres qui gravitent à ses côtés, totalement investis. Marisa Berenson, notamment, en épouse délaissée qui sombre peu à peu dans la folie ou encore Leon Vitali, seul vrai personnage touchant, voir humain, d’un récit parfois trop rocambolesque. Une composante essentielle qui permet au portrait d’homme que tisse Kubrick d’imposer un certain respect malgré les réserves qu’il peut susciter.
Pour ma part, même si je n’ai pas spécialement adhéré au voyage, je salue l’initiative à son origine, ainsi que l’audace dont y fait preuve son auteur. Sans céder aux sirènes du divertissement grand spectacle, il tente de livrer un film plus ou moins réaliste, ambigu, désespéré et désespérément froid. Tout simplement trop à mon goût, cette fois-ci.
Critiques similaires
| Film: Barry Lyndon Note: 8,5/10 Auteur: Bik |
Film: Barry Lyndon Note: 9/10 Auteur: Alegas |
Film: Barry Lyndon Note: 9,5/10 Auteur: droudrou |
Film: Barry Lyndon Note: 8/10 Auteur: Invité |
Film: Barry Lyndon Note: 9,5/10 Auteur: Milkshake |
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22277
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
C'est bien payé pour un film qui raconte en trois heures ce qu'il aurait pu raconter en seulement deux.
-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14651
- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41
- Localisation: On the fury road...
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
A une époque, Logan se serait énervé. Maintenant il met moins 
-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44979
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Je suis en tout cas étonné de constater que le film fédère autant de monde. Non pas qu'il n'ait pas de qualités, bien au contraire, mais j'aurais pensé qu'il diviserait davantage. Mais visiblement non, après avoir lu quelques critiques, ici et ailleurs, il est majoritairement adoré.
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22277
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Perso, il m'a bien fait chier et je ne vais pas le revoir pour pondre une critique. 

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24359
- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
A part la photographie, je trouve ce film surestimé et foutrement chiant. Une fois n'est pas coutume, je préfère largement le premier Ridley Scott.
-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44979
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Comme je le dis, j'ai été assez déçu niveau mise en scène. Belle photo certes, mais en mouvement, c'est pas ouf.
Et puis pour la première fois devant un Kubrick, j'ai subi la bande son, en mode musique d’ascenseur
Et puis pour la première fois devant un Kubrick, j'ai subi la bande son, en mode musique d’ascenseur
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22277
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Ouais, c'est l'équivalent d'une pub version longue pour les yaourts La Laitière.
-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14651
- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41
- Localisation: On the fury road...
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
Han, salaud ! 

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22277
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2016
En tout cas c'est sympa de l'avoir viré du top avec ta critique.
-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44979
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com