
[Nulladies] Mes critiques en 2016
Modérateur: Dunandan
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
dunandan a écrit:Nulladies, tu boudes le topic du classement annuel ?
Ah non je boude pas, je sais plus trop comment faut quoi faire.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Soyez Sympas, Rembobinez - 6,5/10

Be kind, remind
Le titre français porte bien son nom : il s’agit d’un film sympa.
Sorte d’invitation à la fabrique de ses films, le récit force donc deux gentils losers à retourner des films effacés par erreur, avec les moyens du bord. Si le prologue est un peu long à se mettre en place, notamment focalisé sur un Jack Black en roue libre (phobique des ondes, complotiste et magnétisé dans une centrale électrique…), toute la partie centrale fonctionne à plein régime. En jeu, deux lignes de fuite : celle d’une revisite des chefs d’œuvre du cinéma suédés (néologisme assez génial et totalement improbable accolé aux films revus et bricolés, et qui ont donné lieu à la fortune des amateurs sur youtube depuis), usine fébrile à idées bricoleuse, ode à l’inventivité poétique. Le plan séquence enchainant les séquences maitresses de 2001, l’Odyssée de l’espace, King Kong ou Carrie est à lui seul un petit chef-d’œuvre, saturé de clins d’œil et d’hommages. L’autre quête, plus discrète, est celle du personnage joué par Danny Glover, décidé à sortir de la ringardise dans son immeuble voué à la démolition pour être standardisé et sa boutique de location de VHS. C’est donc une visite de ce que devient le monde, formaté, en numérique, d’un avenir aseptisé où le cinéma propose moins de diversité, par des gens en uniforme qui n’y connaissent rien. Ce goût très tarantinesque de la cinéphilie comme travail de mémoire (qui lorgne aussi du côté du non moins sympathique Clerks) irrigue tout le film qui prend dès lors les allures d’un conte. Convoquant les grandes œuvres du 7ème art comme les plus populaires (de Ghostbuster à Robocop), le rap et le jazz, Michel Gondry valorise l’esprit communautaire. Travail collectif, maelstrom culturel, retour aux sources par l’histoire de Fats Waller, c’est aussi une défense passionnée de la fiction, ce mensonge salvateur dans lequel se projettent toutes les tendresses humaines.
Rembobiner : un programme qui pourrait sembler réac et passéiste, mais qui ne glisse jamais sur cette pente, en évitant de même les excès inhérents au conte, à savoir un happy end qui verrait le rouleau compresseur capitaliste vaincu par les bonnes âmes. La dernière image est celle d’un envers d’une très belle symbolique : la toile sur laquelle le film était projeté pour les happy few à l’intérieur du vidéoclub est scrutée par le quartier entier de l’autre côté de la vitrine. Ce thème du message lisible dans les deux sens traverse tout le film : par le message cryptique de Fletcher sur la vitre du train, un temps illisible pour les deux écervelés, dans le travail sur la structure du film sur Waller lorsqu’on envisage de commencer par sa mort, et que le personnage de Black demande s’il faudra alors parler à l’envers, et enfin par la structure du méta-film lui-même, puisqu’il commence par les extraits du projet final des protagonistes sur Fats Waller. Gondry l’affirme donc avec malice : rembobiner, certes, ne pas s’adonner à l’idolâtrie d’une modernité insipide, mais pour mieux agir, fédérer un inventer ensemble une vie un peu plus savoureuse.
Critiques similaires
| Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 6,5/10 Auteur: Dunandan |
Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 7/10 Auteur: Val |
Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 8,5/10 Auteur: Chacha |
Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 7/10 Auteur: Bik |
Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 8/10 Auteur: Invité |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Labyrinthe de pan (Le) - 7,5/10

De l’autre côté du mouroir.
Il fallait bien un labyrinthe pour organiser ce tortueux carrefour entre histoires et Histoire, entre contes et réel. Le labyrinthe de Pan est une odyssée tout à fait passionnante, un double parcours qui parvient à un point d’équilibre ténu entre le fantastique et l’historique, au profit d’une émotion authentique.
En faisant de son héroïne une enfant, del Toro permet ce point de bascule : le récit ne cessera d’aller et venir entre sa quête, rivée au conte de fée, et le décor extérieur dans lequel les conséquences de la guerre civile espagnole font rage.
Mais, loin d’en constituer une échappée un peu vaine, l’incursion dans l’imaginaire en est davantage le miroir déformant : l’horreur est partout, est l’un des grands mérites du film est de ne pas avoir fait de concession dans l’objectif d’élargir son public. On a beau traiter des enfants et de leur univers onirique, le réel s’invite et le contamine. De ce fait, l’organique, la bave, la boue, le sang, sont les souillures nécessaires à l’initiation qui ne se fera pas sans douleur. L’imagerie est aussi belle qu’effrayante, renvoyant aux toiles de Goya, inventive dans ses créatures (très belle idée de ces yeux dans les mains qu’on pose ensuite sur le visage), visions outrées d’un drame qui se joue dans la cellule familiale.
Car l’extérieur, renvoyant au film historique, plonge tête baissée dans les horreurs d’une guerre civile. Alors que la nation se déchire dans une lutte fratricide, la cellule familiale semble en pleine décomposition, n’en déplaise aux curés qui voudraient garantir une stabilité de facade. La famille d’Ofelia est à la fois recomposée et décomposée, pourrie dès l’origine par des mystères étranges sur l’origine du couple, tout comme le rapport du beau-père à son propre père qui semble le hanter. Dans cette demeure sylvestre, nimbée d’une splendide photographie, la nuit n’est pas tant le relai vers l’imaginaire (cantonné à la seule jeune fille, qui a la possibilité de tracer des cloisons à la craie pour s’en extraire) que vers la forêt des clandestins, deux mondes qui cohabitent et créent tout un réseau de double jeu.
Violente, pessimiste, saturée de nuit, la fable a tout du cauchemar éveillé : une course au sacrifice, une imagerie à la fois gore et tragique, dans lequel toutes les factions (nationales, familiales, fraternelles) s’entretuent. Reste l’acceptation de la mort, et de ce fait, le dénouement, qui n’est rien d’autre qu’un retour à l’image première, est à double tranchant : une victoire, certes, mais aussi et surtout une illustration radicale de ce que supposerait le passage de l’enfance au monde des adultes et des hommes : une mise à mort, symbolique ou non, par ceux qui la peuplent et vous initient à sa violence barbare.
Critiques similaires
| Film: Labyrinthe de Pan (Le) Note: 9,5/10 Auteur: zirko |
Film: Labyrinthe de Pan (Le) Note: 10/10 Auteur: jean-michel |
Film: Labyrinthe de Pan (Le) Note: 9/10 Auteur: Christine83 |
Film: Labyrinthe de Pan (Le) Note: 10/10 Auteur: helldude |
Film: Labyrinthe de Pan (Le) Note: 8,5/10 Auteur: Doppio |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Ni le ciel ni la terre - 7/10
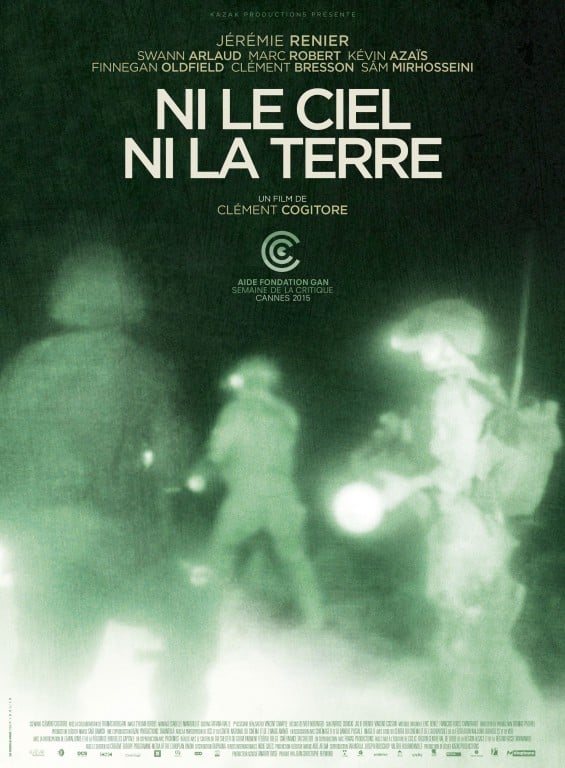
Cendre est la nuit
Enfin, du nouveau, enfin un peu d’audace, se dit-on sur le générique de fin, avec d’autant plus de réjouissance qu’on est en train de le dire au sujet d’un film français. Elles ne sont pas très nombreuses, les tentatives de sortie des sentiers battus, et ce premier film de Clément Cogitore, culotté et assez passionnant, en propose un certain nombre.
L’armée française postée en Afghanistan, garantissant la sécurité d’un village face aux Talibans, doit faire face à des disparitions inexpliquées de soldats. Elles ont toujours lieu la nuit, à la faveur du sommeil.
Avant même que ne surgisse un possible surnaturel, le cinéaste aura travaillé le déracinement et la situation hors norme des soldats : une terre aride, des coutumes incompréhensibles, et quelques indices distant d’une vraie vie laissée au pays. Sans cesse rivés à l’interprète, les soldats tentent de comprendre : un univers dans lequel on les a héliportés, et, progressivement, les superstitions et rites dans lesquels ils auraient mis les pieds, comme par erreur.
Les personnages sont des soldats : ils gèrent, ou du moins le prétendent, déjà légèrement minés par ce climat attentiste, et gagnés par une angoisse grandissante qui leur dicte de renoncer au rationalisme en vigueur.
C’est là tout le point d’équilibre du film : instaurer un climat instable tout en ménageant des possibilités d’hallucination. Cette définition du fantastique va principalement se jouer à la faveur de la nuit. Silence, redéfinition des volumes ou des silhouettes, toute l’imagerie modifiée est longuement explorée par le cinéaste qui multiplie les séquences en vision nocturne, à travers le matériel high tech des militaires. On repense à la séquence similaire de Sicario, avec cette différence de taille : elle n’a ici rien d’un petit gadget éphémère, mais constitue bien le cœur du film.
Dans cette atmosphère anxiogène, où il est question de l’incompréhensible foi des autochtones, le langage perd progressivement sa suprématie : les corps prennent le relai, creusant la roche, s’affrontant, ou au le temps d’une très belle séquence de danse sur un techno fébrile. Cette maladie possible du sommeil fait aussi écho à la trame de Cemetery of Splendour de Weerasethakul : un entre-deux hypnotique, un lien possible avec une réalité parallèle, comme le dit la dernière phrase du film : « Un monde à l’intérieur du monde, à côté du monde, tout autour du monde ».
Dense, déconcertant, audacieux, donc : Ni le ciel ni la terre est un film non seulement fascinant, mais aussi le très probable acte de naissance d’un cinéaste avec lequel il va falloir compter.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
Oh, ça a l'air sympa, tu le vends bien en tout cas ! 
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22324
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
osorojo a écrit:Oh, ça a l'air sympa, tu le vends bien en tout cas !
Tant mieux, je trouve qu'il mérite une visibilité plus grande.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Intolérable cruauté - 4/10

On ne cabotine pas avec l’amour
Il est certaines filmographies qu’on suit depuis si longtemps qu’il nous vient l’envie irrépressibles de combler ses petits manques. Des frères Coen, il ne me manquait que celui-ci, et le suivant, à la réputation encore pire, Ladykillers.
Les Coen, c’est un peu comme Woody Allen : pour peu qu’on ait gouté et apprécié leur univers, on a foncièrement envie d’y retourner. Ici, le prologue annonce la couleur : grotesque et outrancier, le monde matrimonial et ses manigances entre avocats ne va pas s’embarrasser de psychologie ou de finesse.
Au centre des débats, Clooney cabotine comme rarement et son endive de comparse, Zeta Jones se contente de laisser ses cheveux jouer à sa place.
Le film se voudrait une relecture des comédies de remariage mâtiné d’un screwball, et c’est tout sauf réussi. Pesant, très rarement drôle, incohérent au possible, il est en tout point indigne du talent des frangins en matière de comédie, qu’elle soit grinçante (Fargo) ou loufoque (The Big Lebowski), absurde (Barton Fink) ou bon enfant (Le Grand Saut).
Le problème majeur réside dans l’absence évidente de distance par rapport au sujet. Si, par exemple, Burn After Reading était aussi un opus mineur, il s’attachait à portraiturer des imbéciles et pouvait brandir l’excuse de la parodie. Ici, la tournure de romance que prend le récit fait des personnages des fantoches dénués de toute substance, désactivant tout attachement à leurs frasques ineptes qu’ils tentent de compenser dans des grimaces fatigantes.
Il reste un point positif à ce film : les coups de mou peuvent exister sans pour autant condamner une carrière entière : succèdera à cette période des splendeurs comme No Country for Old Men ou Inside Llewyn Davis. Leur retour récent à la comédie avec Avé Cesar, s’il n’est pas non plus un sommet dans leur potentiel comique, reste honorable par rapport à cette petite chose oubliable.
Critiques similaires
| Film: Intolérable cruauté Note: 6/10 Auteur: Alegas |
Film: Intolérable cruauté Note: 6,5/10 Auteur: nicofromtheblock |
Film: Intolérable cruauté Note: 4/10 Auteur: Scalp |
Film: Intolérable cruauté Note: 7/10 Auteur: Eikichi Onizuka |
Film: Intolérable cruauté Note: 4,5/10 Auteur: Jimmy Two Times |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Twixt - 6/10

Ghosts in the jail
Le génie en roue libre comporte toujours son lot de surprise. Depuis que Coppola fait ce qu’il veut, il réinvente le temps et le langage (L’homme sans âge), expérimente toutes les esthétiques possibles (Tetro), et le voilà qui s’attaque au film d’horreur.
Quoi qu’on en dise, le fil rouge existe bien entre ses trois derniers délires : un primat très net accordé à la forme, un fond plutôt obscur, à la fois référentiel et atypique.
Le mérite de Twixt, en comparaison avec la prétention des deux essais précédents, réside dans sa dérision. Dès l’introduction, l’absurde le dispute à l’horrifique, le conte noir à l’enfilade de clichés, et c’est avant tout à un jeu de piste que semble nous convier le cinéaste.
L’univers est d’autant plus codifié que les moyens pour le signifier sont outrés : noir et blanc lustré duquel émergent d’uniques couleurs, souvent le rouge, (un rappel en expansion des expériences de Rusty James) plans obliques, accompagnés d’un grand travail sur le son.
Les références sont à peines voilées, tantôt aux labyrinthes de Lynch sur les beautés vénéneuses et oniriques de Lost Highway ou Mulholland Drive, ou au Shining de Kubrick quant à la panne d’inspiration de l’écrivain alcoolique, voire au Vertigo d’Hitchcock par les escaliers escarpés menant au clocher.
La question est de savoir si quelque chose émerge de la menace constante du grotesque généralisé. Pour peu qu’on s’immerge dans les méandres insolubles et qu’on laisse cette imagerie fantastique se déployer, oui. Une fascination, une certaine mélancolie, même. Dans les arcanes de l’inspiration, le jeu des lieux communs (la jeune fille blafarde et spectrale, le motard marginal citant Baudelaire, le prédateur d’enfants) est une réponse à la vie réelle, une expansion de ses drames, d’un mariage raté, d’une carrière minable et du deuil de l’enfant.
Ce mélange d’amateurisme assumé sur le plan narratif et de travail outré sur la forme accouche d’une œuvre hybride qui marque le spectateur, tant par son audace un peu délirante que par certaines fulgurances visuelles.
On ne sait pas si c’est là le dernier film de Coppola, mais quoi qu’il en soit, on attend avec une véritable excitation le suivant : tout est désormais possible. Et, lorsqu’on constate à que point certains maitres ne parviennent qu’à refaire indéfiniment le même film, à l’instar de Woody Allen, on ne peut que s’en réjouir.
Critiques similaires
| Film: Twixt Note: 2/10 Auteur: Jack Spret |
Film: Twixt Note: 0/10 Auteur: Scalp |
Film: Twixt Note: 8/10 Auteur: cinemarium |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Re: Revenant (The) - 4,5/10
Nulladies a écrit:Mais le film est comme la vengeance : plat, et il se mange froid.
Jolie tournure

Sinon très jolie critique dont je comprends le ressenti.
Nulladies a écrit:Le film est saturé de ce genre d’affèteries, au point qu’on finit, et c’est assez rare pour le signaler, par ne voir que la caméra.
C'est souvent l'un des tics qu'on reproche à Innaritù, son côté pompeux, mais perso pas de saturation pour moi, et je suis souvent cueilli par la démonstration. Et au final encore plus ici donc, où finalement quelque part, malgré un festival visuel, il se met paradoxalement en retrait vis à vis de son histoire, du coup dans son côté démonstratif. Et s'il y a donc un léger déséquilibre dans l'intention entre la forme et fond, l'intensité qui se dégage du film est pour moi indéniable et magnifique.
-

elpingos - Predator

- Messages: 4666
- Inscription: Ven 15 Avr 2011, 12:12
- Localisation: Nantes
Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016
elpingos a écrit:C'est souvent l'un des tics qu'on reproche à Innaritù, son côté pompeux, mais perso pas de saturation pour moi, et je suis souvent cueilli par la démonstration. Et au final encore plus ici donc, où finalement quelque part, malgré un festival visuel, il se met paradoxalement en retrait vis à vis de son histoire, du coup dans son côté démonstratif. Et s'il y a donc un léger déséquilibre dans l'intention entre la forme et fond, l'intensité qui se dégage du film est pour moi indéniable et magnifique.
Oui, on me dit beaucoup ça. C'est dommage pour moi, j'aurais bien aimé subir le même effet. Cela dit, je l'ai eu dans la première demi-heure au moins.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Séparation (Une) - 7,5/10

Compromissions impossibles
Revoir une Séparation peut ne pas lui rendre service. Lors de sa découverte, ce fut un choc assez terrible, quelque peu nuancé depuis par le prolongement du Passé qui exhibait avec un peu trop de lourdeur sa mécanique d’écriture, et qu’on est tenté de retrouver ici, passé l’enthousiasme premier.
C’est sur les fausses pistes que se construit ce récit, autant de fils et de repères qui vont progressivement interagir au point de former un écheveau inextricable. Dans un premier temps, le spectateur occidental plaque son regard critique sur une société dont il faut fuir à tout prix. C’est ce que semble indiquer cette première séquence en plan fixe, filmée du point de vue du représentant administratif, où l’on demande à l’épouse les raisons qu’elle a de vouloir quitter le pays et divorcer de son mari qui refuse d’y abandonner son père.
Le sujet est déjà assez puissant pour qu’on y voie la trame principale, mais il n’en sera rien. Alors que le mari peut passer pour un réactionnaire, la suite du développement le montre au contraire on ne peut plus progressiste avec sa fille de 11 ans, et préoccupé à juste titre du sort de son père, atteint d’Alzheimer.
Mélange des générations dans cette cellule familiale presque bourgeoise, et tentée en partie par les opportunités qu’offrirait l’occident. Asghar Farhadi va alors ajouter l’élément qui manquait, l’intrusion d’une autre classe sociale, plus populaire et pieuse, par la femme de ménage et son mari.
Les sujets sont désormais légion : le poids de la religion dans les pratiques, le travail des femmes, la fracture sociale, la façon de gérer un débat, entre la violence primaire de l’homme du peuple et la rhétorique condescendante, voire machiavélique de l’intellectuel.
Farhadi enferme sa petite communauté dans une série de lieux aussi clos que son intrigue retorse : l’appartement, admirablement filmé, avec ses parois vitrées et ses cloisons étouffantes, le bureau trop exigu du juge ou les couloirs bondés où l’on patiente. Les comédiens sont tous impeccables, et la valse des partis pris proprement vertigineuse : formatés qu’il est à vouloir à tout prix déterminer à qui donner tort ou raison, le spectateur suit et revire au gré de ce véritable thriller moral.
Chaque personnage ment. Chaque personnage à ses raisons. Chacun se compromet. Tout au plus peut-on sauver l’épouse et son désir de rétablir la vérité, ou la fille. Le plus terrible réside sans doute dans la lucidité portée sur cet enfer pavé de bonnes intentions : la façon, par exemple, dont on ne cesse de dire à la fille que c’est à elle de choisir, qu’on rétablira la vérité si elle le demande, procède d’un chantage proprement intenable, tout comme on utilise la foi puissante des plus démunis pour les coincer en les menant au parjure sur le Coran.
Une séparation n’est pas un film sur la société iranienne ou sur la corruption du système : il explique avec une radicalité exténuante que les individus se débrouillent très bien tout seul pour s’entredéchirer.
Dans ces débats sans fin et ces twists (un brin forcés sur la fin), l’essentiel se joue dans le silence : c’est le regard noir de la fillette porté sur les adultes qui la tourmentent, les larmes de celle qui pourrait être sa grande sœur et qui doit choisir entre son père et sa mère. Car cette première intrigue éponyme qu’on avait presque oubliée refait surface et prend une nouvelle tournure : personne ne gagne dans cette mécanique maléfique.
Il y a de quoi jubiler lorsqu’on veut fustiger la médiocrité humaine, mais on peut aussi se questionner sur la facilité à mettre en place une telle structure : la critique est aisée, mais l’art de vivre difficile.
Critiques similaires
| Film: Séparation (Une) Note: 9/10 Auteur: cinemarium |
Film: Séparation (Une) Note: 8,5/10 Auteur: elpingos |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Wake in Fright - Réveil dans la terreur - 8/10

Very mad trip
Avant même de se pencher plus avant sur ses abîmes, Wake in Fright a tout pour séduire : un long sommeil depuis sa sortie, une aura de film sans concession, des scènes réelles de massacre de kangourous et une plongée dans les bas-fonds de la nature humaine, entre biture, baston et canicule.
Le propos est universel : à l’écart du monde git l’homme primal, et lui rendre visite ne fait pas du bien. Sur cette trame proche du Delivrance de Boorman, Ted Kotcheff dresse une galerie de portraits bruts, tous portés par une interprétation imparables. Virilité alcoolisée, nymphomanie désœuvrée, la parenthèse désenchantée du personnage principal, instituteur coincé dans ce lieu de perdition, a tout du film d’horreur. Les décors participent largement à ette atmosphère, alternance entre l’outback australien, nature aride constellée de pustules, bicoques insalubres dans lesquelles se terrent des hommes à l’état sauvage. Le plan initial, qui présente à 360° le désert et deux baraques de bois, ne dit pas autre chose : un western sans action, une scène délaissée depuis longtemps par la geste héroïque.
On pourra s’indigner sans difficulté de cette immersion quasi documentaire aux racines du mal qu’on appelle l’humanité, et dans laquelle le climat semble favoriser les déviances, à l’image du Twenty-nine palms de Dumont. Violence, excès, abrogation du langage, échanges fondés sur les coups et la fureur suffisent à dresser le portrait nihiliste de notre race humaine.
Mais il faut décaper Wake in Fright de tous le vernis culte qui l’engonce pour saisir ce qui en fait une véritable pépite noire.
Contrairement au western ou au film d’horreur, son parti pris est de ne jamais réellement juger ses personnages, de ne proposer aucune catégorisation. Alors que le spectateur est sans cesse dans l’attente d’une révélation frontale propice à la condamnation, le récit ne cesse d’emprunter des voies de traverse : la violence avec laquelle on réagit quant Grant refuse un verre en est le symptôme : on y voit des psychopathes, ce ne sont que des hospitaliers. Il en va de même pour l’unique personnage féminin, qu’on considère d’abord comme une victime, avant de déceler en elle une attitude libertaire et, selon le médecin, en accord avec elle-même. Ce dernier est d’ailleurs la figure la plus fascinante, médecin alcoolique sans attache, moitié clochard, moitié noceur, ayant trouvé son équilibre dans la crasse et la débauche, philosophe à la marge accepté par ses semblables.
Tout semble affaire de consentement : de ce point de vue, Bundanyabba fait figure de contre-Eden : un enfer permissif où l’on reprendrait contact avec ses racines. Éphémère pour l’homme civilisé, permanent pour ceux qui l’ont invité avec insistance. Et c’est bien dans cette posture ambivalente que se situe toute l’intelligence retorse de ce trip aussi malade que roboratif.
Critiques similaires
| Film: Wake in Fright - Réveil dans la terreur Note: 6,5/10 Auteur: Alegas |
Film: Wake in Fright - Réveil dans la terreur Note: 7/10 Auteur: Val |
Film: Wake in Fright - Réveil dans la terreur Note: 6,75/10 Auteur: Scalp |
Film: Wake in Fright - Réveil dans la terreur Note: 8,5/10 Auteur: osorojo |
Film: Wake in Fright - Réveil dans la terreur Note: 8/10 Auteur: pabelbaba |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Cri du sorcier (Le) - 6,5/10
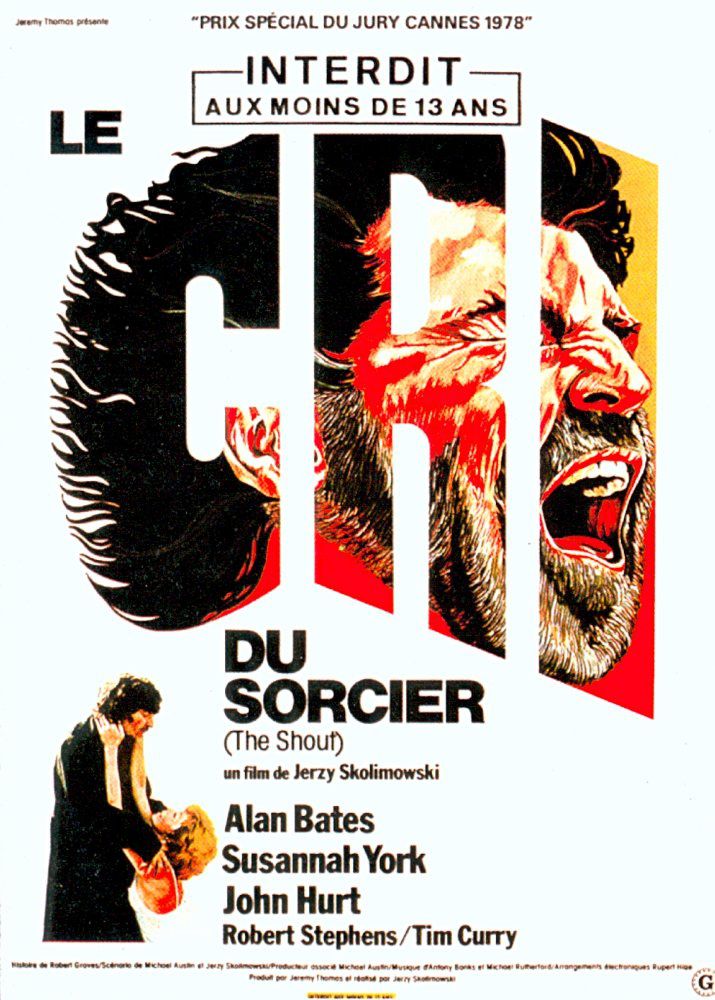
Fist and shout
Skolimowski, c’est le type dont tu prends un film avec l’assurance de passer un moment particulier, qui ne te laissera de toute façon pas indifférent. Qu’il visite les émois adolescents sur fond de piscine londonienne dans Deep End, la passion pour les rallyes de JP Léaud dans Le Départ ou la folle échappée d’un terroriste en territoire hostile dans Essential Killing, il pose à chaque fois un regard radical sur son sujet, sans concession et au profit d’une expérience singulière.
C’est la sorcellerie qui l’intéresse sur cet opus, où il est question d’un homme s’incrustant chez un couple après, selon ses dires, avoir appris chez les aborigènes des pratiques de magie noire. Le premier plan, sur cette étendue lunaire de sable, ainsi que cette incursion, rappellent au préalable l’intrigue et le final du Théorème de Pasolini. Mais ici, on parlera moins : c’est bien l’image qui se charge de générer l’inquiétante étrangeté. Eclaté sur la temporalité, le récit dérange les repères traditionnels de la narration, et navigue entre plusieurs époques qu’on a du mal à ressouder avant les dernières minutes.
Certes, la progression du mal et la possession des personnages constitue une intrigue qui lorgne du côté de Polanski (Le Locataire, ou Répulsion), mais ce n’est pas sur ce point névralgique que Skolimowski se concentre : l’atmosphère va se construire par deux éléments majeurs, le son et l’image. Le métier du protagoniste, un musicien expérimental, occasionne une recherche acharnée sur des sons nouveaux, dont on nous donne pas mal d’aperçus, autant de cercle concentriques autour du son ultime, le fameux cri qui a le pouvoir de tuer. De la même manière, l’exploration des espaces génère une angoisse tout à fait prégnante : le cadrage des intérieurs, souvent des couloirs démesurés ou des encadrements de portes très colorés (échos aux expériences visuelles de Deep End) alterne avec des prises de vues vastes et splendides de la côte anglaise, où l’on s’effondre dans les dunes, recherche l’âme des proches dans les cailloux enfouis sous le sable, ou brûle sous la foudre punitive.
Si Le cri du Sorcier ne provoque pas la peur qu’on pouvait nous promettre, moins efficace que Polanski sur le même terrain, c’est probablement de la volonté même du réalisateur, qui brise souvent la linéarité et l’aspect hypnotique de certaines séquences par une variété étrange des tons : ces ruptures nous poussent régulièrement à changer de points de vue, alternant entre les complices, voire les victimes de la sorcellerie ou ses observateurs lucides d’une maladie mentale.
De ce déséquilibre surgit un autre malaise, bien plus insidieux, et finalement très malin : celui de la porosité des genres, et de la singularité d’un univers singulier, propre à ce réalisateur hors norme.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Donnie Darko - 7,5/10
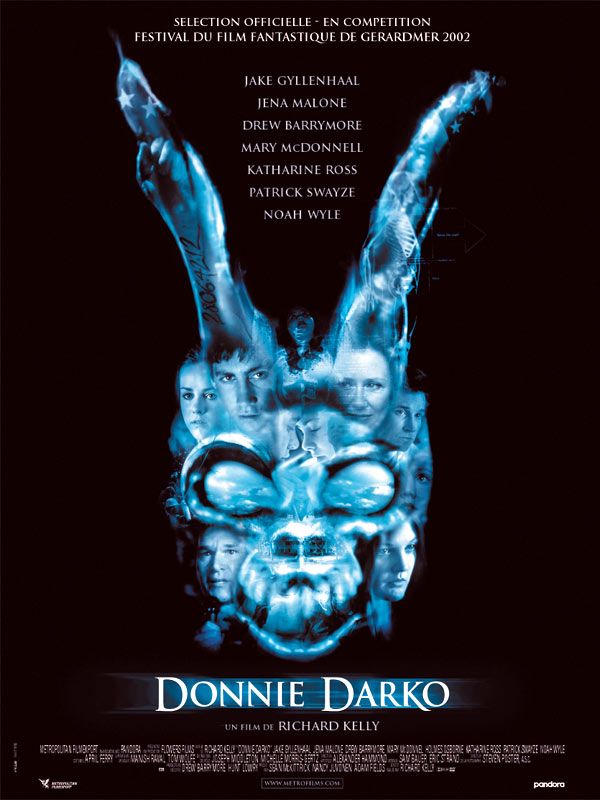
Teenage ban club
Une route en lacets surplombant la ville, un corps inerte, un habillage sonore discrètement anxiogène : si l’on n’avait vérifié la chronologie des sorties, on aurait pu penser à une citation de Mulholland Drive, qui sort deux semaines auparavant aux États-Unis.
De fait, le premier long métrage de Richard Kelly va se superposer sur deux genres, deux atmosphères complémentaires : le film fantastique et le high school movie. Du second, il emprunte le portrait traditionnel d’une tranche d’âge, souvent ingrate, celle de la cellule familiale et des émotions vives propres à cette période de transition. Lyrique, au gré de séquences clipesques (ralentis, accélérés, plans obliques) et sous le joug d’une BO imparable (au premier rang de laquelle figure la splendeur The Killing Moon d’Echo & the Bunnymen) le récit nous plonge avec conviction dans les élans adolescents, comme le faisait Virgin Suicides de Sofia Coppola.
Sans se cantonner aux plus jeunes, Kelly prend soin de croquer l’ensemble d’une communauté, souvent sous l’angle de la satire : une Amérique puritaine qui voudrait interdire certains livres, obsédée par l’apparence et la compétition, notamment par l’organisation du spectacle juvénile. Les adultes se scindent en deux groupes : les fanatiques, morbides et gourous en puissance (la prof de gym et le télévangéliste qui se révélera pédophile) et les indécis, : les parents de Donnie, plutôt tolérants, et ce couple d’enseignants qui semblent avoir l’âge de leurs élèves et se soumettre malgré eux à l’institution. L’une est éjectée pour le programme littéraire qu’elle propose, l’autre choisit de se taire quant aux théories pas très catholiques sur le voyage dans le temps.
Au sein de ce carcan, doublé de la violence traditionnelle des rackets et des humiliations, Donnie est l’électron libre, celui qui vandalise et qui fait bouger les lignes. Mais, et c’est là l’un des intérêts du récit, son attitude iconoclaste ne lui appartient pas. « They made me do it », écrit-il sous l’un de ses forfaits, pantin de force étranges qui vont faire dévier, dans tous les sens du terme, la trajectoire des événements.
Kelly met ici en place un univers qu’il ne quittera pas, de la folie de Southland Tales à la fable The Box : un mélange de fantastique de lyrisme, quelques accrocs à une explication finale, notamment due aux voyages dans le temps.
Il faut reconnaitre que dans cette convergence vers une fin du monde annoncée (une véritable obsession chez Kelly, présente dans tous ses films), les questions sont bien souvent plus savoureuses que la résolution ; la schizophrénie de Donnie, les apparitions de la créature mettent en place un univers proche de Twin Peaks, tandis que les correspondances avec la scène attendue appauvrissent un peu le propos.
Sur cette impasse, où seul le spectateur sait ce qui est perdu, on retrouve l’émotion nostalgique du dénouement d’Eternal Sunshine of the Spotless mind. Un mélange de fulgurances, de marques oniriques mêlant l’effroi à l’épiphanie : ce qui nous reste, en somme, de l’adolescence.
Critiques similaires
| Film: Donnie Darko Note: 9,5/10 Auteur: Dunandan |
Film: Donnie Darko Note: 9,5/10 Auteur: Velvet |
Film: Donnie Darko Note: 9/10 Auteur: lvri |
Film: Donnie Darko Note: 9/10 Auteur: Alegas |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800
- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com




