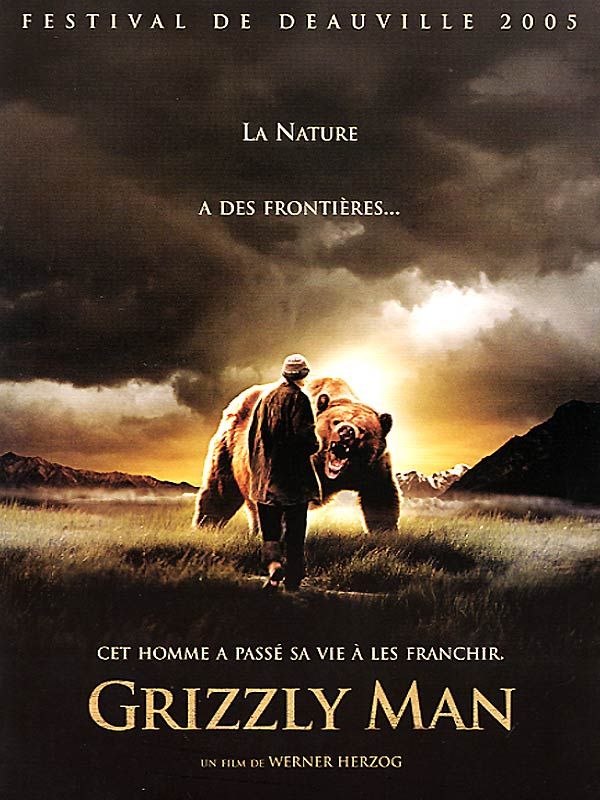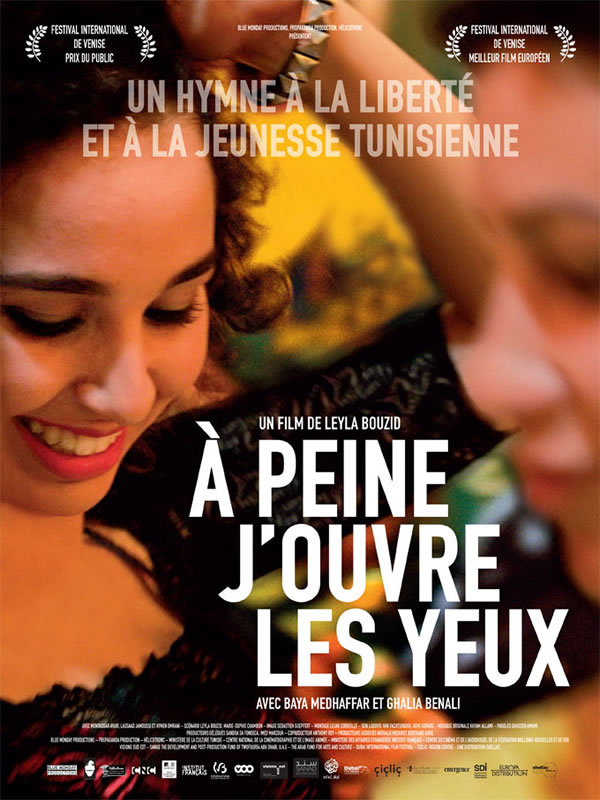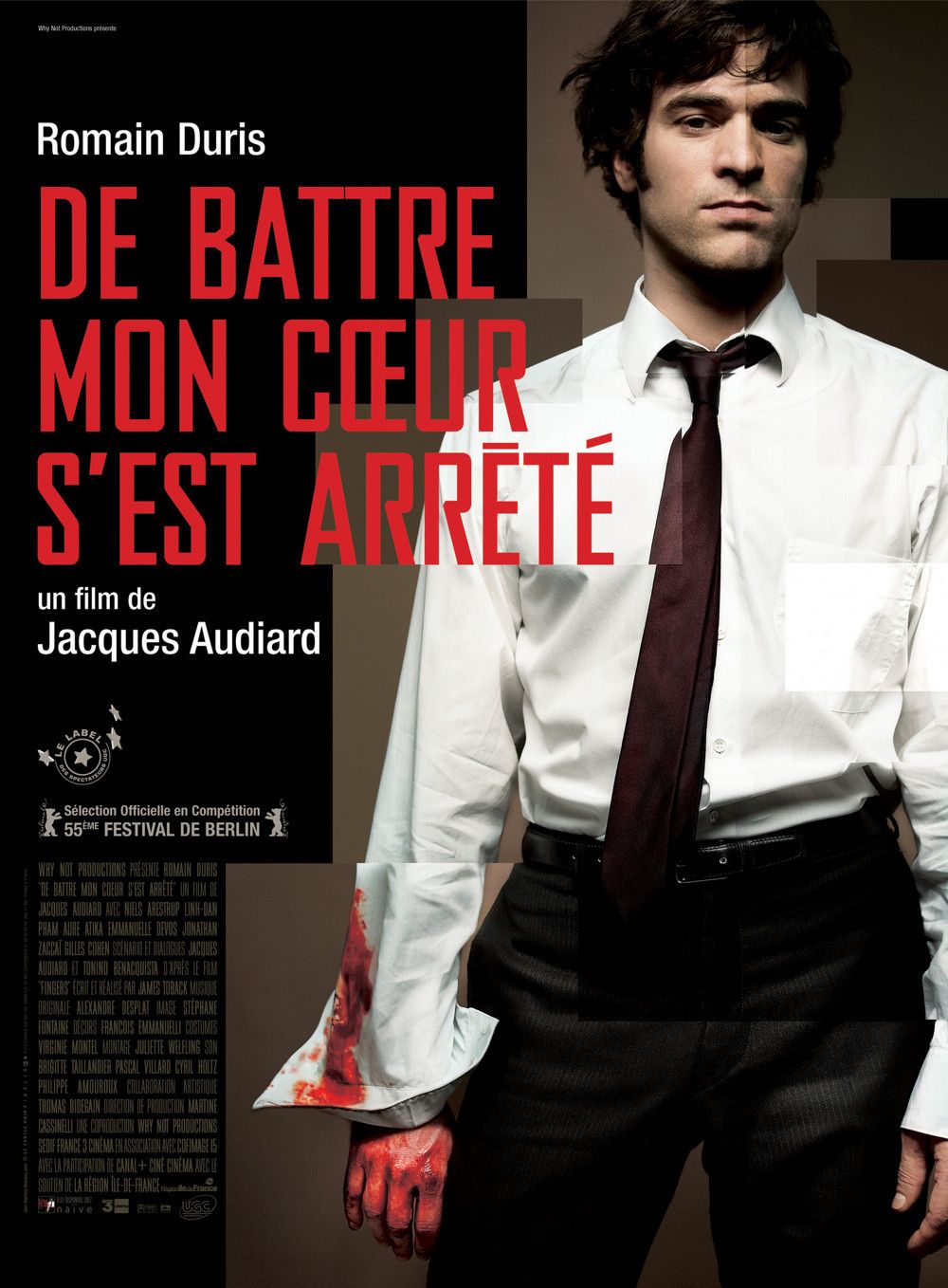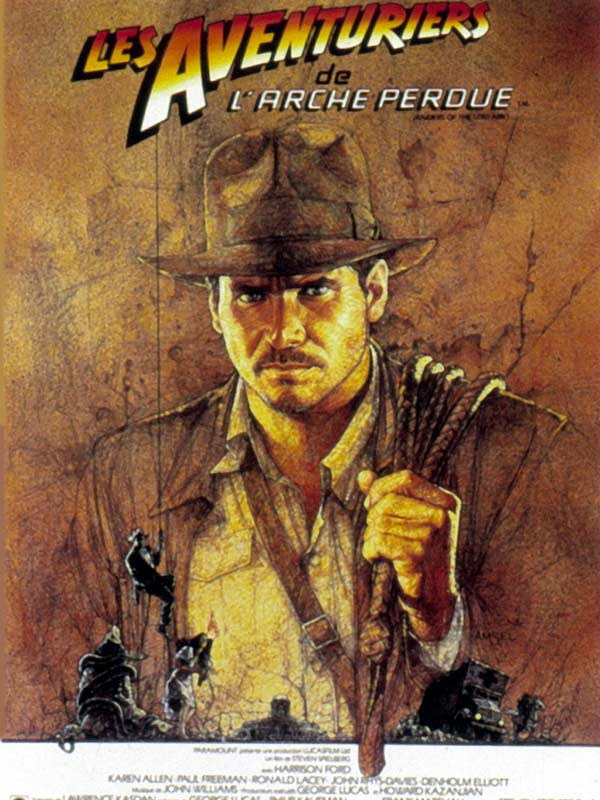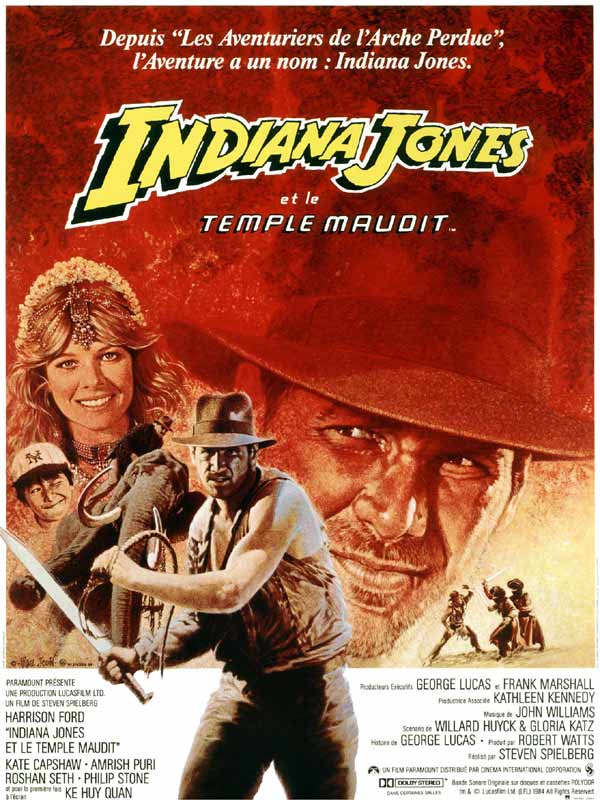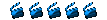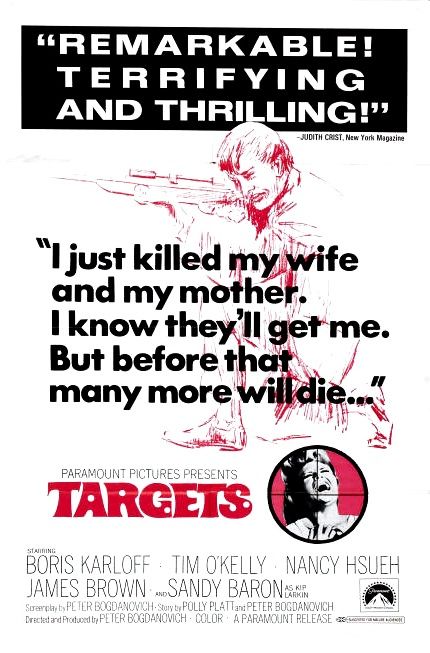
American Horror Glory.
Targets fait partie de ces films qui instaurent d’emblée une ambiance poisseuse comme seule l’Amérique sait en générer : terre des fantasmes, du trop-plein et de l’iconicité, paysage cinématographique par excellence, ayant su y créer sa mythologie du présent, le Nouveau Monde est le règne de l’ambivalence.
C’est sur cette problématique du regard que Peter Bogdanovich (qu’on a connu bien plus léger dans le chef d’œuvre La Barbe à Papa ou la récente friandise Broadway Therapy) fait ses armes, avec un budget dérisoire et des contraintes dont il va faire sa force.
Targets ménage deux récits parallèles : celui d’une star vieillissante devisant sur ce lieu commun des gouffres entre l’apparat et la réalité, et le parcours d’un bon fils de famille, sorte de clone inquiétant de Matt Damon, s’initiant au rôle de sniper fou, posture désormais tristement connue aux Etats-Unis.
La démonstration se fait sans ambages (au risque d’une certaine saturation) : les écrans sont partout, les médias omniprésents, voix-off de la radio, téléviseurs, cinéma, talk show ; ce qui reste du réel est une famille trop parfaite pour être honnête, et qu’on sacrifiera, et à l’autre bout du spectre, un petit monde occupé à alimenter cette illusion dans la grande usine à rêve hollywoodienne.
L’atmosphère noire renvoie à des petites pépites brutes comme The Offence de Lumet ou That Cold Day in the Park d’Altman, premiers échos du Nouvel Hollywood, où l’on décape le vernis pour y fouiller dans les zones d’ombre.
Si les parties dévolues à l’acteur vieillissant peuvent sembler un peu longues, la progression vers la folie du sniper occasionne une traversée du paysage urbain superbement cadrée. A l’intimité retorse du massacre familial succède une séquence de tirs hasardeux depuis un réservoir sur la freeway qui cite explicitement l’un des grands films ayant fait basculer Hollywood vers sa nouvelle ère : le documentaire de Zapruder sur l’assassinat de JFK.
Le final, lui aussi un brin didactique dans sa mise en abyme, répond à l’ouverture qui se faisait sur la fin d’une projection : il s’agit désormais de projeter un film dans un drive-in, et de faire venir le comédien qui sera donc à la fois à l’écran et parmi les spectateurs, dont on commence par établir une sorte de panorama sociologique. Les identifier, c’est aussi l’occasion pour le tireur de définir ses cibles, crevant au sens propre du terme l’écran pour faire advenir l’horreur dans le réel. Bogdanovich le souligne à plusieurs reprises, l’horreur baroque des films de série Z est bien plus séduisante que celle des faits divers dans cette société qui engendre des monstres.
Le montage, de plus en plus rapide, alterne jusqu’au vertige les allées et venues entre les deux mondes, le virtuel et le réel, jusqu’aux décharges sacrificielles.
Au-delà de la thèse et du jeu de massacre, c’est par son épilogue que Targets marque : de la même façon qu’il insistait jusqu’au malaise sur la façade trop brillante de la famille américaine, ce plan final sur le parking déserté du Drive-in est à lui seul une démonstration frappante de l’inconscience avec laquelle le monde se déshumanise : par le vide.