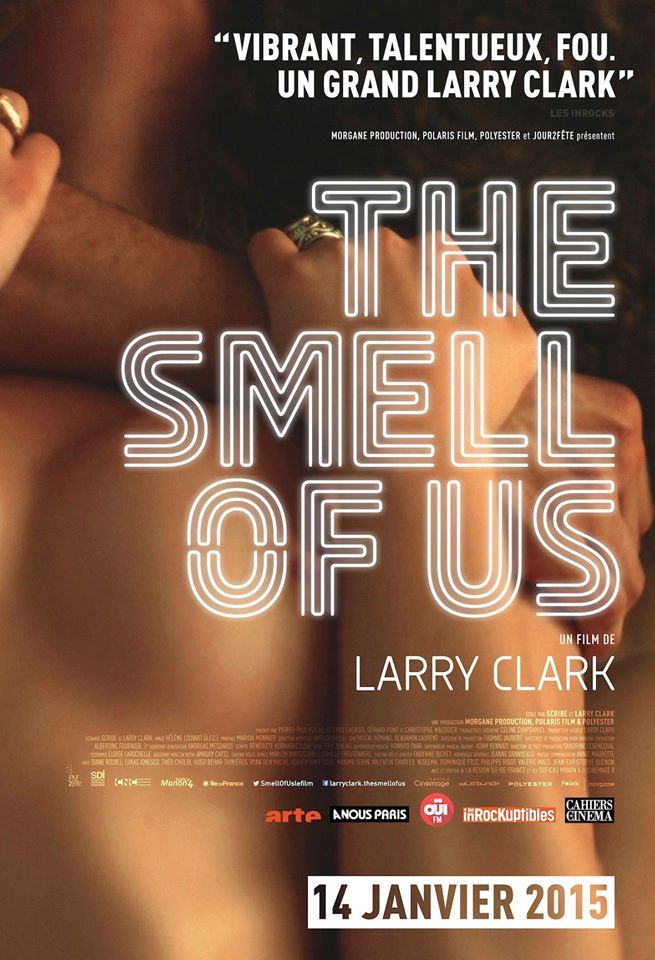Tous les matins s’effondrent.
Lorsque le film s’achève, sur ce suspens entre la brisure et les élans d’une vie qui se poursuivra, conclusion de tant de films de Sautet, on se dit que toute sa filmographique tendait à ce chef-d’œuvre.
Pourtant, Un cœur en hiver n’est plus en tout point fidèle à la flamboyante œuvre du maitre. L’époque a changé, le temps a passé. Les groupes se sont réduits, et la géométrie collective se densifie dans une communauté restreinte, où chaque lien a son sens : l’amitié, masculine ou mixte, le triangle amoureux, et la filiation.
Sautet décape : le crépuscule de sa vie semble atteindre ses personnages, pourtant d’une jeunesse encore vigoureuse, mais prudents, à l’écoute de leur part d’ombre, avares de mots et de grandes sorties, qui n’en seront que plus bouleversantes lorsqu’elles ne pourront plus être contenues. L’image, d’un grain sublime, absorbe l’obscurité dans des clair-obscur fascinants, et occasionne des portraits magnifiques.
Les grands personnages de Sautet ont toujours pris le silence comme complice : Romy, dans Une histoire simple ou César et Rosalie, Piccoli dans Les Choses de la vie ou Max et les ferrailleurs, Auteuil dans Quelques jours avec moi, Dewaere dans Un mauvais fils… optent pour cette devise qui est désormais l’épitaphe sur la tombe du cinéaste : Garder le calme devant la dissonance. Dans ce nouveau chapitre des tourments amoureux et de la vie face à la perte, Sautet embrasse enfin pleinement une passion de toujours, la musique, et la met au centre des échanges. Camille ne se confie jamais autant que l’archet à la main, avec lequel elle caresse ou gifle. Stéphane ne se livre jamais autant que lorsqu’il écoute, et ne croit aimer qu’une seule personne, son ancien maitre de musique qui fait figure de père au soir de sa vie.
Contrepoint à l’expression musicale, le silence de l’artisan, le travail des mains et du bois, qui ouvre le film, sur un violon qu’on ouvre puis qu’on scelle, parcours inversé de ce que fera le luthier avec son cœur. Tout est parfaitement méticuleux, et Stéphane pense avoir compris la vie en spectateur, auditeur ou lecteur. L’amour, c’est la déchirure des vieux couples ou ceux, si familiers de Sautet, à la table voisine du bistrot. « Ecrit, c’est souvent très beau », concède-t-il. Mais il ne se laissera pas prendre, tout au plus aura-t-il la faiblesse de constater à quel point les autres peuvent flancher. Ce personnage de Stéphane restera l’un des plus beaux écrits par Sautet, d’une complexité compréhensible, d’un handicap excusable, qu’on voudrait parfois faire sien pour échapper aux ravages ce qui fait notre humanité : la passion.
Il y aura les pluies. Il y aura des larmes. La mort de la figure du patriarche, comme souvent. Des comédiens exceptionnels, capables d’incarner dans le calme toutes les inflexions de l’humanité. Si les générations se succèdent et que les talents restent aussi flamboyants, c’est bien à une direction d’acteurs hors norme qu’on le doit.
« On ne peut pas démystifier les sentiments. Personne ne peut prétendre à cet orgueil-là. » assène le maitre de musique à Stéphane, sur la voie de la rédemption. Il n’y a pas de morale, pas de victoire. Un échec, peut-être, mais surtout un parcours, qui laisse au temps qui passe la possibilité de voire une nouvelle saison succéder à l’hiver.
Comme toujours.
Sautet joue avec les modulations de sa partition, irisé du sourire triste de celui qui sait être parvenu au sommet de son art.