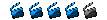La Porte du Paradis - Michael Cimino (1980)

La Porte du Paradis reste à ce jour, une œuvre sans précédent dans l'histoire du cinéma et dans celle de Michael Cimino, LE génie sacrifié du cinéma américain : un film cultivant ses paradoxes sans honte, d'un côté la mégalomanie avec une débauche de moyens ahurissante (on ne compte pas les plans où les figurants s'exposent par centaines) pour reproduire l'esprit d'une époque, de l'autre, une véritable humilité thématique où la petite histoire se parallélise face à la Grande, une histoire d'amour liée à un terrible génocide, un fait historique gravissime longtemps renié par l'Amérique : celle du massacre de Johnson County, un village accueillant une majorité d'immigrants européens (français, allemands, slaves), perpétré par de riches propriétaires terriens peu enclins à laisser des étrangers s'installer dans leur pays.
On retient encore aujourd'hui de ce film son immense four commercial qui brisa à la fois le Nouvel Hollywood et la carrière de Michael Cimino, n'ayant plus jamais l'occasion de jouir d'une telle liberté artistique (du moins jusqu’à Sunchaser). Le limiter néanmoins à cette réputation de nadir, occulte la richesse de la vision profondément humble et intense de son récit, celle d'un western désenchanté, ralenti et hors du temps où les moments simples ont parfois plus de valeur que que les "grosses" scènes : que dire de cette longue introduction à Harvard où nous voyons les personnages du film vivre leurs derniers moments de pure candeur, où les rires francs et les danses majestueuses remplacent les massacres organisés de leur vie d'adulte ?
Cette première séquence s'amorce tel un écho à son précédent film The Deer Hunter qui fonctionnait aussi sur cette opposition passages légers/tragiques, amplifiant ainsi le destin de chacun des personnages, devenant plus incarnés aux yeux du spectateur en montrant plusieurs facettes de leur existence. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'il procède aussi comme Deer Hunter à des ellipses temporelles, laissant chaque fois plus de deux décennies passer entre chaque étape de la vie de Kristofferson, un choix d'autant plus malin qu'il laisse toute place à l'intelligence du spectateur pour méditer sur ses expériences qu'il a pu endurer durant tout ce temps, là où un autre réalisateur aurait préféré jouer jouer la carte du trop-plein de séquences justificatives au vu de la durée (ce que Leone a fait avec Once Upon a Time in America mais dont la narration éclatée excuse cet était de fait avec la réussite que l'on sait). Chez Cimino, a l'instar de Leone, et plus que jamais dans Heaven's Gate, on prend son temps pour mieux se laisser porter par l’atmosphère à une heure où le cinéma effectue une course a la technologie pour soi-disant nous immerger dans un film. Que ce soit entre les milliers de figurants utilisés dans les plans dans la grande ville construite en taille réelle ou bien perdu dans les immenses vallées de l'Idaho, on est définitivement plongé en plein cœur d'une époque révolue et ce uniquement par le choix d'un axe, la durée d'un plan et la réelle authenticité qui s'en dégage.
Heaven's Gate forme aussi le premier volet d'une trilogie sur les fondations de la nation américaine avec Year of The Dragon (qui sera son pendant contemporain, en s'attardant sur une autre communauté immigrante, celle des asiatiques) et The Sunchaser (la synthèse de ses prédécesseurs), où l'accent est porté donc sur l'importance des valeurs et des archétypes face à la vilénie du genre humain, Kris Kristofferson dit d'ailleurs qu'Heaven's Gate est un film qui montre que l'argent est plus important que les gens (lecture un tantinet simpliste, mais indéniable de raison). A mes yeux, c'est surtout ce rêve illusoire de toucher du doigt l'essence d'une époque mais avec l'extrême conscience de savoir qu'il n'y aura pas de lendemains meilleurs, à l'image de la scène finale quasi-silencieuse où l'on voit le héros se fermer littéralement à la vie, n'ayant plus la force d'exprimer grand chose à ses proches après les terribles épreuves qu'il a vécues. Un grand film donc, autant dans la forme que dans le fond, qui sonnait inconsciemment le glas d'une époque et d'un genre, se refusant à une quelconque forme d'intellectualisme élitiste et que tout amoureux du western se doit d'avoir vu dans sa version intégrale, la seule qui trouve grâce tant chaque scène est parfaitement à sa place, contribuant ainsi à la force de cette gigantesque épopée presque trop courte tant elle a de choses a nous montrer.
10/10