[oso] Ma prose malade en 2015
Modérateur: Dunandan
Sous les Drapeaux, l'Enfer - 8/10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SOUS LES DRAPEAUX, L'ENFER
Kinji Fukasaku | 1972 | 8/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Furtivement, pendant près de 2 heures, Kinji Fukasaku rallume les cœurs éteints des guerriers ayant combattu sous le joug du Japon pendant la seconde guerre mondiale. Qu’ils aient nourri le champ de bataille par leur sang en laissant derrière eux familles éplorées et patrie ingrate ou qu’ils soient rentrés chez eux, entiers pour les plus chanceux, à l’heure du bilan, le constat est le même pour tous : leur âme est restée en terre ennemie, chaque soldat est revenu des affrontements meurtri au plus profond de son âme, dépossédé de cette once d’espoir et de positivisme qui lui permettait, avant la guerre, de nourrir rêves et ambitions d’un futur potentiellement heureux.



Avec sa virulence habituelle, et sa rage informative assénée de manière quasi clinique, Kenji Fukasaku met toute sa furie, visuelle et thématique, au service d’une critique très corrosive de l’approximation totale avec laquelle les hautes sphères militaires de son pays ont géré la seconde guerre mondiale sur le terrain. Un bilan sans appel pour le cinéaste qui annonce la couleur d’entrée de jeu et n’a de cesse, au fur et à mesure qu’il distribue le rôle du point de vue à ses différents personnages, d’alourdir sa charge sans jamais envisager une seule seconde de la nuancer. Cette volonté d’illustrer l’horreur folle de la guerre de manière presque manichéenne peut paraître un peu cavalière mais au moment où elle commence à construire un portrait d’homme troublant, elle prend tout son sens. Lorsque le mystère entourant cet esprit à peine esquissé s’estompe et que ses traits se cristallisent enfin, les vannes de l’émotion s’ouvrent en grand : la plus rugueuse des carapaces déposera les armes devant le sort funeste du pauvre bougre et de ses compagnons d’arme : Fukasaku n’épargne personne, s’attarde sur chaque détail du dénouement de son histoire, le malaise est total.



Pour autant et malgré les coups de massue, le portrait semble juste, bien qu’il soit si définitif. Le Japon a certainement été l’un des pays les plus touchés par les conflits de la seconde guerre mondiale, déplorant des pertes humaines gigantesques. Son peuple, qu’il ait été exposé en premières lignes aux atrocités de la guerre ou qu’il ait assisté aux horreurs de loin, est sorti du conflit on ne peut plus traumatisé. On peut alors comprendre l’antimilitarisme rageur qui anima Fukasaku lors de la réalisation de ce film, comme on savoure sans peine le fruit des efforts qu’il déploie pour faire porter son cri de colère.






En plus d’être un double portrait prenant, de femme d’abord et d’homme ensuite, à travers un couple décimé par des conflits à différente vitesse — qui prennent d’abord place lors de la guerre elle-même, puis dans l’après-guerre, par l’intermédiaire de discours manipulés qui visent à faire croire aux survivants que le meilleur est à venir —, Sous les drapeaux, l’enfer est mû par un récit savamment orchestré, une direction d’acteur très solide et un sens de la mise en scène éprouvé qui permet à Fukasaku de jouer avec ses gimmicks de manière efficace (passage du N&B à la couleur, insertion d’images d’archive etc) tout en sachant les faire discret lorsque l’image se suffit à elle-même (la scène de l’exécution par exemple). De quoi forcer le respect, marquer les esprits et insuffler l’envie d’en parler. Et pas qu’un peu.



Avec sa virulence habituelle, et sa rage informative assénée de manière quasi clinique, Kenji Fukasaku met toute sa furie, visuelle et thématique, au service d’une critique très corrosive de l’approximation totale avec laquelle les hautes sphères militaires de son pays ont géré la seconde guerre mondiale sur le terrain. Un bilan sans appel pour le cinéaste qui annonce la couleur d’entrée de jeu et n’a de cesse, au fur et à mesure qu’il distribue le rôle du point de vue à ses différents personnages, d’alourdir sa charge sans jamais envisager une seule seconde de la nuancer. Cette volonté d’illustrer l’horreur folle de la guerre de manière presque manichéenne peut paraître un peu cavalière mais au moment où elle commence à construire un portrait d’homme troublant, elle prend tout son sens. Lorsque le mystère entourant cet esprit à peine esquissé s’estompe et que ses traits se cristallisent enfin, les vannes de l’émotion s’ouvrent en grand : la plus rugueuse des carapaces déposera les armes devant le sort funeste du pauvre bougre et de ses compagnons d’arme : Fukasaku n’épargne personne, s’attarde sur chaque détail du dénouement de son histoire, le malaise est total.



Pour autant et malgré les coups de massue, le portrait semble juste, bien qu’il soit si définitif. Le Japon a certainement été l’un des pays les plus touchés par les conflits de la seconde guerre mondiale, déplorant des pertes humaines gigantesques. Son peuple, qu’il ait été exposé en premières lignes aux atrocités de la guerre ou qu’il ait assisté aux horreurs de loin, est sorti du conflit on ne peut plus traumatisé. On peut alors comprendre l’antimilitarisme rageur qui anima Fukasaku lors de la réalisation de ce film, comme on savoure sans peine le fruit des efforts qu’il déploie pour faire porter son cri de colère.






En plus d’être un double portrait prenant, de femme d’abord et d’homme ensuite, à travers un couple décimé par des conflits à différente vitesse — qui prennent d’abord place lors de la guerre elle-même, puis dans l’après-guerre, par l’intermédiaire de discours manipulés qui visent à faire croire aux survivants que le meilleur est à venir —, Sous les drapeaux, l’enfer est mû par un récit savamment orchestré, une direction d’acteur très solide et un sens de la mise en scène éprouvé qui permet à Fukasaku de jouer avec ses gimmicks de manière efficace (passage du N&B à la couleur, insertion d’images d’archive etc) tout en sachant les faire discret lorsque l’image se suffit à elle-même (la scène de l’exécution par exemple). De quoi forcer le respect, marquer les esprits et insuffler l’envie d’en parler. Et pas qu’un peu.
Critiques similaires
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Ça a l'air super !
Et ça change de ses polars.
Mais sinon tu mets combien ?
La critique référence un 8 alors que ta critique donne 8,5
Et ça change de ses polars.
Mais sinon tu mets combien ?
La critique référence un 8 alors que ta critique donne 8,5

"- Ça vous dirait un petit échange dans la ruelle, derrière le bar ?
- Si c’est un échange de fluides corporels, je suis pas contre. Mais alors dans ce cas, tu passes devant."
-

Jack Spret - Robocop

- Messages: 8047
- Inscription: Mar 25 Déc 2012, 10:57
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Va pour 8 si c'est important ^^
Et oui, ça vaut vraiment le coup d'oeil, en plus c'est torché en 1h35, certains devraient en prendre de la graine
En truc à part de ses polars, faut que je chope Virus aussi, mais c'est plus long par contre
Et oui, ça vaut vraiment le coup d'oeil, en plus c'est torché en 1h35, certains devraient en prendre de la graine
En truc à part de ses polars, faut que je chope Virus aussi, mais c'est plus long par contre
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Pas une priorité Virus...
-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45100
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Ah ué, c'est pas fou ?
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Franchement bof...
Essaie Violent Panic : The Big Crash si tu veux un divertissement sympatoche.
Essaie Violent Panic : The Big Crash si tu veux un divertissement sympatoche.
-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45100
- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Ça roule 

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Lost River - 6/10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LOST RIVER
Ryan Gosling | 2015 | 6/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lost River est symptomatique d’une première réalisation ambitieuse, Ryan Gosling a voulu frapper trop fortement du poing sur la table pour concurrencer ses maîtres à penser mais s’est un peu perdu au moment de concrétiser ses envies. La moindre parcelle de son film se fait l’écho d’une source d’inspiration différente et le résultat souffre d’un déséquilibre global qui rend l’ensemble aussi malade qu’il est attachant.
Malade parce que sa narration fait dans la demi-mesure. Entre drame social carabiné, fable initiatique pantouflarde, survival apocalyptique et freak show poussé à l’extrême jusqu’à la provoc’ gratuite, il est bien difficile de s’y retrouver. Les pistes fusent, les personnages se croisent, parmi eux quelques réguliers, parfois attachants, mais souvent lointains, il manque un ciment qui réunirait tout le monde. Et c’est bien dommage, parce que si sur une demi-heure, l’ambiance magique de Lost River a de quoi ravir les rétines, y compris celles qui commencent à se lasser, sur la durée, l’effort se fait trop ressentir. A tel point que lorsque les scènes continuent de s’étirer plus que de raison, alors même qu’elles jouent un dernier acte très attendu, l’intérêt vacille.
Mais Lost River sait aussi être attachant parce qu’il a pour lui de jolis atouts. Une envie de bien faire, tout d’abord, qui oriente la caméra en permanence. L'envolée visuelle constante est de circonstance, et si elle peut lasser sur al distance, on ne pourra reprocher à Gosling et son équipe de s’être reposé sur leurs lauriers. Visuellement, Lost River est un véritable tour de force : prises de vue subaquatique, jeu constant sur la profondeur de champ, part belle faite à la couleur, tout y passe, et avec maîtrise la plupart du temps.
Du coup, même si l’ennui s’est fait ressentir dans la dernière demi-heure, je sors de la séance intrigué. Gosling se vautre certes dans les travers d’une première réalisation (trop d’idées, trop d’envie, pas assez de réalisme dans la réalisation) mais il rend aussi son film intéressant par sa plastique solide et quelques unes de ses thématiques (le côté cabaret de l’horreur, c’est plutôt réussi). Je serai au rendez-vous si le bougre se lance dans une seconde tentative en espérant qu’il saura mettre ses manières au placard et qu’il passera la seconde niveau écriture.
Malade parce que sa narration fait dans la demi-mesure. Entre drame social carabiné, fable initiatique pantouflarde, survival apocalyptique et freak show poussé à l’extrême jusqu’à la provoc’ gratuite, il est bien difficile de s’y retrouver. Les pistes fusent, les personnages se croisent, parmi eux quelques réguliers, parfois attachants, mais souvent lointains, il manque un ciment qui réunirait tout le monde. Et c’est bien dommage, parce que si sur une demi-heure, l’ambiance magique de Lost River a de quoi ravir les rétines, y compris celles qui commencent à se lasser, sur la durée, l’effort se fait trop ressentir. A tel point que lorsque les scènes continuent de s’étirer plus que de raison, alors même qu’elles jouent un dernier acte très attendu, l’intérêt vacille.
Mais Lost River sait aussi être attachant parce qu’il a pour lui de jolis atouts. Une envie de bien faire, tout d’abord, qui oriente la caméra en permanence. L'envolée visuelle constante est de circonstance, et si elle peut lasser sur al distance, on ne pourra reprocher à Gosling et son équipe de s’être reposé sur leurs lauriers. Visuellement, Lost River est un véritable tour de force : prises de vue subaquatique, jeu constant sur la profondeur de champ, part belle faite à la couleur, tout y passe, et avec maîtrise la plupart du temps.
Du coup, même si l’ennui s’est fait ressentir dans la dernière demi-heure, je sors de la séance intrigué. Gosling se vautre certes dans les travers d’une première réalisation (trop d’idées, trop d’envie, pas assez de réalisme dans la réalisation) mais il rend aussi son film intéressant par sa plastique solide et quelques unes de ses thématiques (le côté cabaret de l’horreur, c’est plutôt réussi). Je serai au rendez-vous si le bougre se lance dans une seconde tentative en espérant qu’il saura mettre ses manières au placard et qu’il passera la seconde niveau écriture.
Critiques similaires
| Film: Lost River Note: 7/10 Auteur: Velvet |
Film: Lost River Note: 6/10 Auteur: Nulladies |
Film: Lost River Note: 1,5/10 Auteur: Alegas |
Film: Lost River Note: 7/10 Auteur: caducia |
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Visiteurs (1972) (Les) - 6,5/10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LES VISITEURS
Elia Kazan | 1972 | 6.5/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S’inscrivant sans fioriture dans la mouvance dépressive du nouvel Hollywood, Elia Kazan parvient, en dépit d’une économie de moyens spartiate, à faire de son film un uppercut vicieux en jouant malicieusement sur les paradoxes qui caractérisent l’être humain. Du père fricotant avec les loups qui viennent d’investir sa bergerie, allant jusqu’à renier la chair de sa chair, une descendance qu’il juge indigne de sa lignée, à la petite amie trop sure d’elle et moralisatrice à ses heures, qui se laisse prendre au jeu de démons qui n’évoluent pas dans la même cour qu’elle, les personnages peuplant Les visiteurs sont peu nombreux mais d’une présence magnétique. Les séquences s’enchaînent, chacune plus impalpable que la précédente, pour construire un rapport de domination qui ne fait que changer de main.
Si l’exercice est particulièrement réussi quand il s’agit de faire tourner la carte du salopard toute catégorie, à l’heure de conclure, l’exécution est plus troublante. Au moment où les rescapés d’un match trop arrosé se mettent à écrire le dernier acte, deux sentiments se livrent bataille. A commencer par une effrayante indifférence : que ce dénouement brutal soit la suite trop logique d’une trame narrative qui a tout fait pour lui dérouler le tapis rouge le rend encore plus difficile à encaisser. D’où un retour réflexif qui remet en perspective cette supposée indifférence : impossible de finir le film sans penser longuement à ses dernières minutes. Alors que l’horreur de la situation aurait été digérée plus facilement si elle avait initié le film, pour tenter de désamorcer la situation par la suite, conclure par ce moment d’un désespoir absolu, alors qu’il a été plusieurs fois question de son évitement pendant la séance, rend sa symbolique encore plus dévastatrice.
D’autant plus que le dernier plan enfonce violemment le clou : voir les deux agneaux qui viennent de se faire tordre l’âme par une meute de loups aux états d’âme changeants, accepter leur pauvre sort sans soubresaut de révolte est totalement désarmant. Du désespoir qui transparaît de ce salon qui n’aura jamais été éclairé de façon satisfaisante se nourrit l’impuissance d’un spectateur laissé à sa propre réflexion. Les visiteurs est un film particulièrement impalpable qui reste en tête pendant un bon moment même s’il n’inspire pas forcément que du positif lorsqu’il est question de le quitter.
Si l’exercice est particulièrement réussi quand il s’agit de faire tourner la carte du salopard toute catégorie, à l’heure de conclure, l’exécution est plus troublante. Au moment où les rescapés d’un match trop arrosé se mettent à écrire le dernier acte, deux sentiments se livrent bataille. A commencer par une effrayante indifférence : que ce dénouement brutal soit la suite trop logique d’une trame narrative qui a tout fait pour lui dérouler le tapis rouge le rend encore plus difficile à encaisser. D’où un retour réflexif qui remet en perspective cette supposée indifférence : impossible de finir le film sans penser longuement à ses dernières minutes. Alors que l’horreur de la situation aurait été digérée plus facilement si elle avait initié le film, pour tenter de désamorcer la situation par la suite, conclure par ce moment d’un désespoir absolu, alors qu’il a été plusieurs fois question de son évitement pendant la séance, rend sa symbolique encore plus dévastatrice.
D’autant plus que le dernier plan enfonce violemment le clou : voir les deux agneaux qui viennent de se faire tordre l’âme par une meute de loups aux états d’âme changeants, accepter leur pauvre sort sans soubresaut de révolte est totalement désarmant. Du désespoir qui transparaît de ce salon qui n’aura jamais été éclairé de façon satisfaisante se nourrit l’impuissance d’un spectateur laissé à sa propre réflexion. Les visiteurs est un film particulièrement impalpable qui reste en tête pendant un bon moment même s’il n’inspire pas forcément que du positif lorsqu’il est question de le quitter.
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Un film qui mériterait d'être plus connu. 
Un vétéran de l'époque de l'âge d'or des studios qui s'adapte aux conditions du Nouvel Hollywood tout en développant un discours cohérent, c'est rare pour être souligné.

Un vétéran de l'époque de l'âge d'or des studios qui s'adapte aux conditions du Nouvel Hollywood tout en développant un discours cohérent, c'est rare pour être souligné.
-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14680
- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41
- Localisation: On the fury road...
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Jed_Trigado a écrit:Un vétéran de l'époque de l'âge d'or des studios qui s'adapte aux conditions du Nouvel Hollywood tout en développant un discours cohérent, c'est rare pour être souligné.
C'est pas faux. N'empêche, le film est assez pète couille...

(cela-dit, pas revu depuis quelques années et je l'ai gardé pour lui donner une seconde chance)
- angel.heart
- Robocop

- Messages: 9397
- Inscription: Lun 28 Mar 2011, 14:55
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
@Jed : Yep, il mérite qu'on le mette en lumière, même s'il risque d'en ennuyer plus d'un ^^
@angel : je suis d'accord avec la gestion du rythme qui est par moment un peu faiblarde (d'ou ma note), mais dans l'ensemble c'est de belle facture quand même, le traitement des personnages est bien foutu.
@angel : je suis d'accord avec la gestion du rythme qui est par moment un peu faiblarde (d'ou ma note), mais dans l'ensemble c'est de belle facture quand même, le traitement des personnages est bien foutu.
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Parrain (Le) - 8,5/10
• Critique à la chaîne •
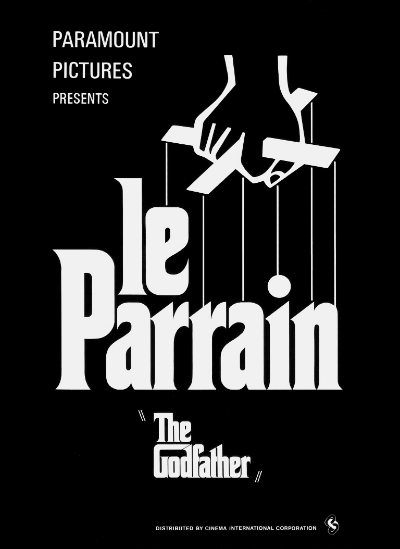
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE PARRAIN
Francis Ford Coppola | 1972 | 8.5/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
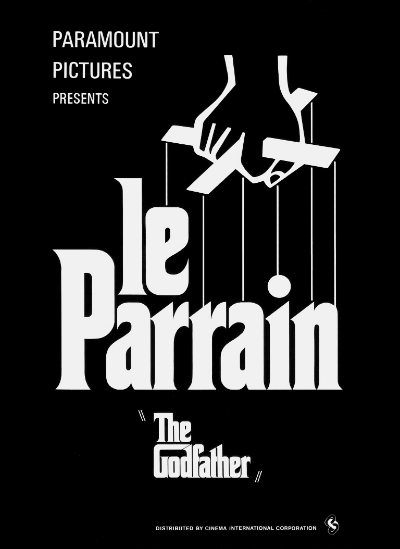
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE PARRAIN
Francis Ford Coppola | 1972 | 8.5/10
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Coppola ouvre Le parrain par un mariage, un choix judicieux qui lui permet de présenter tous les personnages qui vont faire la pluie et le beau temps dans sa célèbre fresque mafieuse. A n’en pas douter, avec ce premier film d’une saga dont il me reste à découvrir deux exemplaires, Francis Ford Coppola est devenu, à raison, la référence incontournable du film mafieux dans ce qu’il a de plus divertissant. A comprendre qu’en lieu et place d’une dénonciation rugueuse et brutale comme cela pouvait être le cas dans les polizieschi directement influencés par le néoréalisme italien, Le parrain se présente comme le versant américain du genre : un film qui associe le spectaculaire des règlements de compte à la précision subtile des dialogues qui les mettent en marche.



Pour dérouler sa symphonie funeste, Coppola peut compter sur la présence d’acteurs forts en tronche. Du changeant Al Pacino, qui troque les masques avec aisance, mutant du fiston diplomate à l’apprenti parrain inflexible avec un naturel saisissant, à l’inflexible mais charmeur Marlon Brando, présenté comme la voix de la sagesse alors qu’il n’est autre que l’incarnation d’une faucheuse impitoyable, les hommes sont au cœur du film, plus importants même que les actions qui les caractérisent. C’est en cela que le parrain s’imprime dans les rétines, par sa capacité à raconter plusieurs destins sans en perdre un seul en cours de route. Quand le second couteau apprend à son futur boss comment cuisiner sa spécialité, et qu’il endosse à nouveau la casquette professorale quelques minutes plus tard, troquant les tomates pour un révolver ajusté aux mains novices de son élève, il devient aussi important pour l’histoire que les membres de la famille Corleone eux-mêmes.



C’est aussi à sa mise en scène inspirée, qui ne s’emballe jamais, Coppola étant un cinéaste de la maîtrise, que Le parrain doit sa juste réputation. Qu’il s’agisse de filmer la fulgurance d’un assassinat prenant place dans l’intimité d’un petit restaurant familial ou d’introduire le personnage central du film, lors d’une première scène qui assure d’entrée de jeu la qualité de ce qui va suivre, la caméra est d’une précision redoutable, peut-être trop rigoureuse par moment, mais l’efficacité de son placement n’est jamais à remettre en question, chaque scène est d’une lecture limpide.






Toutes ces qualités étant énoncées, il y a quelques petites choses qui m’ont tout de même un peu tracassé — toute proportion gardées hein, lâchez donc les pierres que vous venez de ramasser —dans ce premier Parrain.
L’absence, d’abord, d’un personnage féminin marquant. Le parrain est un film de bonhommes, certes, mais il est dommage que les femmes y aient une place si limitée. En tout et pour tout, trois jolies jeunes femmes (enfin 2 et demi) se partagent la bobine, et deux d’entre elles ont la chance d’énoncer plus de deux phrases en 3h de temps. D’un côté, l’attendrissante femme du futur parrain, qui a été bien gentille d’attendre que son promis s’amuse en Sicile avec une jeunette avant de devenir une roue de secours de luxe. De l’autre, la sœur Corleone, qui est certainement celle qui a le plus de présence à l’image et se cantonne à être une hystérique qui aime se prendre des roustes par son mari. Alors oui, Talia Shire est celle qu’il vous faut pour hurler à tue-tête, on est d’accord, mais quand même, il y avait plus subtil à faire, surtout quand on voit la qualité de la plume qui construit les personnages masculins.
Le côté très académique et un peu trop littéraire de l’ensemble ensuite. Finalement, le parrain, c’est un peu la mafia racontée pour la famille, une fresque attendrissante sur des pourris qui butent n’importe qui pour un peu d’oseille, mais qu’il faut croire quand ils vous disent que c’est pour subvenir aux besoins de leurs familles. Qu’on s’entende, la démarche est parfaitement légitime, on est dans une fiction et les personnages sont voulus marquants, mais je crois que je préfère le traitement d’un Scorsese à ce niveau là, qui n’hésite pas à faire de pourris mafieux des vrais salopards, et qui prend son plaisir à rendre plus acharnée la violence qui les anime.



Évitons tout de même de finir cette palabre sur cette note négative, parce que ce grand film mérite tous les éloges qu’il reçoit généralement. A l’image de ses dernières minutes inspirées, lors desquelles Pacino reprend le flambeau et devient le parrain de manière définitive —glaçant moment qui voit une porte qui se ferme le séparer de sa femme après qu’il lui ait menti sans sourciller—, c’est une œuvre particulièrement maîtrisée dans sa folle ambition qui inspire un immense respect. Et même si cette dernière n’est pas un coup de cœur pour moi, c’est tout simplement parce que malgré son défilé d’acteurs ultra solides et sa maîtrise formelle de chaque instant, son écriture un peu trop idéalisée est moins ma tasse de thé.



Je suis également resté un peu sur ma faim quant au choix de Coppola d’acter, par les interactions entre les différents boss, la guerre des familles plutôt que par l’action à proprement parler. Au niveau, notamment, des effusions de violence qui sont parfaitement mises en scène dans ce premier opus mais un peu trop ponctuelles à mon goût, même si c’est certainement ce qui leur confère cette puissance qui vous cloue au siège lorsqu’elles prennent d’assaut l’écran et s’impriment sur les rétines à tout jamais.



Pour dérouler sa symphonie funeste, Coppola peut compter sur la présence d’acteurs forts en tronche. Du changeant Al Pacino, qui troque les masques avec aisance, mutant du fiston diplomate à l’apprenti parrain inflexible avec un naturel saisissant, à l’inflexible mais charmeur Marlon Brando, présenté comme la voix de la sagesse alors qu’il n’est autre que l’incarnation d’une faucheuse impitoyable, les hommes sont au cœur du film, plus importants même que les actions qui les caractérisent. C’est en cela que le parrain s’imprime dans les rétines, par sa capacité à raconter plusieurs destins sans en perdre un seul en cours de route. Quand le second couteau apprend à son futur boss comment cuisiner sa spécialité, et qu’il endosse à nouveau la casquette professorale quelques minutes plus tard, troquant les tomates pour un révolver ajusté aux mains novices de son élève, il devient aussi important pour l’histoire que les membres de la famille Corleone eux-mêmes.



C’est aussi à sa mise en scène inspirée, qui ne s’emballe jamais, Coppola étant un cinéaste de la maîtrise, que Le parrain doit sa juste réputation. Qu’il s’agisse de filmer la fulgurance d’un assassinat prenant place dans l’intimité d’un petit restaurant familial ou d’introduire le personnage central du film, lors d’une première scène qui assure d’entrée de jeu la qualité de ce qui va suivre, la caméra est d’une précision redoutable, peut-être trop rigoureuse par moment, mais l’efficacité de son placement n’est jamais à remettre en question, chaque scène est d’une lecture limpide.






Toutes ces qualités étant énoncées, il y a quelques petites choses qui m’ont tout de même un peu tracassé — toute proportion gardées hein, lâchez donc les pierres que vous venez de ramasser —dans ce premier Parrain.
L’absence, d’abord, d’un personnage féminin marquant. Le parrain est un film de bonhommes, certes, mais il est dommage que les femmes y aient une place si limitée. En tout et pour tout, trois jolies jeunes femmes (enfin 2 et demi) se partagent la bobine, et deux d’entre elles ont la chance d’énoncer plus de deux phrases en 3h de temps. D’un côté, l’attendrissante femme du futur parrain, qui a été bien gentille d’attendre que son promis s’amuse en Sicile avec une jeunette avant de devenir une roue de secours de luxe. De l’autre, la sœur Corleone, qui est certainement celle qui a le plus de présence à l’image et se cantonne à être une hystérique qui aime se prendre des roustes par son mari. Alors oui, Talia Shire est celle qu’il vous faut pour hurler à tue-tête, on est d’accord, mais quand même, il y avait plus subtil à faire, surtout quand on voit la qualité de la plume qui construit les personnages masculins.
Le côté très académique et un peu trop littéraire de l’ensemble ensuite. Finalement, le parrain, c’est un peu la mafia racontée pour la famille, une fresque attendrissante sur des pourris qui butent n’importe qui pour un peu d’oseille, mais qu’il faut croire quand ils vous disent que c’est pour subvenir aux besoins de leurs familles. Qu’on s’entende, la démarche est parfaitement légitime, on est dans une fiction et les personnages sont voulus marquants, mais je crois que je préfère le traitement d’un Scorsese à ce niveau là, qui n’hésite pas à faire de pourris mafieux des vrais salopards, et qui prend son plaisir à rendre plus acharnée la violence qui les anime.



Évitons tout de même de finir cette palabre sur cette note négative, parce que ce grand film mérite tous les éloges qu’il reçoit généralement. A l’image de ses dernières minutes inspirées, lors desquelles Pacino reprend le flambeau et devient le parrain de manière définitive —glaçant moment qui voit une porte qui se ferme le séparer de sa femme après qu’il lui ait menti sans sourciller—, c’est une œuvre particulièrement maîtrisée dans sa folle ambition qui inspire un immense respect. Et même si cette dernière n’est pas un coup de cœur pour moi, c’est tout simplement parce que malgré son défilé d’acteurs ultra solides et sa maîtrise formelle de chaque instant, son écriture un peu trop idéalisée est moins ma tasse de thé.



Je suis également resté un peu sur ma faim quant au choix de Coppola d’acter, par les interactions entre les différents boss, la guerre des familles plutôt que par l’action à proprement parler. Au niveau, notamment, des effusions de violence qui sont parfaitement mises en scène dans ce premier opus mais un peu trop ponctuelles à mon goût, même si c’est certainement ce qui leur confère cette puissance qui vous cloue au siège lorsqu’elles prennent d’assaut l’écran et s’impriment sur les rétines à tout jamais.
Critiques similaires
| Film: Parrain (Le) Note: 8/10 Auteur: John Lawrence |
Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Velvet |
Film: Parrain (Le) Note: 8,5/10 Auteur: moricenlive |
Film: Parrain (Le) Note: 9/10 Auteur: lvri |
Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Hannibal |
-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334
- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51
Re: [oso] Ma prose malade en 2015
Tu devrais apprécier plus le 2 je pense. Et puis Talia Shire a un perso qui devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure de la saga.
(oublie pas de filer tes propositions à Nulladies )
)
(oublie pas de filer tes propositions à Nulladies
-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50991
- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05
- Localisation: In the Matrix
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com



