
47 RONIN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Carl Erik Rinsch (2014) | 6.5/10
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Carl Erik Rinsch (2014) | 6.5/10
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++






Après visionnage de ce 47 Ronin généreux mais chaotique, je suis pris d’un affreux doute. M’aurait-on subtilisé mes rétines, kidnappé mon bon sens, fait oublier les Wu Xia Pian des maîtres ou l’acharnement critique dont est victime le film de Carl Erik Rinsch (Il n'y a que Mark ici qui lui donne la moyenne, sinon c'est la sentence du 3) est exagéré ? Il est de coutume de penser que les fous préfèrent s’imaginer sein d’esprit, j’opte donc pour la seconde solution, en lui apportant une douce nuance toutefois.



Nuance car pour sortir de 47 Ronin avec l’esprit enjoué, il convient de ne pas le juger sur son ensemble. Œuvre malade parce qu’elle a souffert de réécritures en série, elle est toutefois née d’un esprit passionné. Carl Erik Rinsch a du monde dans le caleçon, espérer accoucher d’un film de samouraï à la sauce japonaise en terres de l’oncle Sam tient du suicide. Casting 100% Japonais si l’on exclut Mr Utah, on ne peut moins fluent in ingliche, l’handicap de départ est déjà lourd. Alors quand le jeune cinéaste opte pour un bestiaire tout droit sorti des mythes fantastiques japonais, qu’il s’embourbe dans une fresque épique qui mériterait 3h pour être correctement développée, on se dit que le jeune homme a eu les yeux plus gros que ses focales.



S’engager dans un tel projet, entre les mains de producteurs hollywoodiens, pour un premier film, c’était demander une pelle pour creuser sa tombe. Et c’est bien dommage, parce que le résultat, malgré son incohérence, transpire d’une passion pour l’image évidente et d’un sens explosif de la mise en scène.



47 Ronin est une œuvre en mutation, dont certaines parties sont des exemples de percussion alors que d’autres sont dignes d’une série télé nocturne —comprendre qui meuble la grille de diffusion—. Son écriture est complètement manquée, aucun personnage n’émerge vraiment du lot, la romance entre Keanu et la charmeuse Kô Shibasaki ne fonctionne jamais, les méchants sont bien débiles et les ellipses narratives trop exagérées pour que l’ensemble trouve cohérence. Et pourtant, elle est habitée de moments en apesanteurs, témoins généreux d’une âme aux commandes en quête de l’image efficace. Tout le passage portuaire, glauque en diable, où Keanu joue de la tatane sur des tatamis non officiels, ou la partie où il s’aventure avec ses copains ronins au cœur d’une forêt que l’on croirait sortie de chez Miyazaki, pour affronter des moines voldemoriens vaporeux, fonctionne à plein tubes. Véritables moments épiques qui se hissent, visuellement parlant, aux sommets de ce qu’a pu délivrer le genre. Et même si l’empreinte numérique rappelle plus le ciné HK parfois fauché que les prouesses techniques de tutures transformables, elle a vraiment de la gueule. Quand à la polémique sur le tatoué de l’affiche, effectivement il vend du charisme sur papier, mais dans le film lorsqu’il parle, on a envie qu’il se taise immédiatement, ce qu’il fait très bien après ses 10 secondes d’apparition.






Loin de moi l’envie de réhabiliter le film, il est évident que dans sa globalité, il est relativement manqué, mais son ambition visuelle et son caractère trempé le rendent à mes yeux sympathique. Il porte la fougue d'un esprit idéaliste qui souhaitait éduquer Hollywood avec un Wu Xia Pian américain habité par l’esprit du soleil levant (un brin prétentieux, j'en conviens, mais c'est l'audace d'un premier film aussi). Mais à ce niveau de budget, la seule passion et un savoir–faire naissant ne peuvent surmonter la pression de studios qui souhaitent capitaliser leur investissement. En résulte un naufrage d’une tristesse absolue, puisqu’à l’occasion de ce bon film manqué, qui offre des séquences mémorables, un fort potentiel créatif vient de se brûler les ailes : on est surement pas prêt de revoir Carl Erik Rinsch de sitôt. D’autant plus dommage que le jeune homme doit avoir des bollocks en acier trempé, et ce n’est pas cette fin inespérée, anti film grand spectacle par excellence, qui me fera mentir.



Nuance car pour sortir de 47 Ronin avec l’esprit enjoué, il convient de ne pas le juger sur son ensemble. Œuvre malade parce qu’elle a souffert de réécritures en série, elle est toutefois née d’un esprit passionné. Carl Erik Rinsch a du monde dans le caleçon, espérer accoucher d’un film de samouraï à la sauce japonaise en terres de l’oncle Sam tient du suicide. Casting 100% Japonais si l’on exclut Mr Utah, on ne peut moins fluent in ingliche, l’handicap de départ est déjà lourd. Alors quand le jeune cinéaste opte pour un bestiaire tout droit sorti des mythes fantastiques japonais, qu’il s’embourbe dans une fresque épique qui mériterait 3h pour être correctement développée, on se dit que le jeune homme a eu les yeux plus gros que ses focales.



S’engager dans un tel projet, entre les mains de producteurs hollywoodiens, pour un premier film, c’était demander une pelle pour creuser sa tombe. Et c’est bien dommage, parce que le résultat, malgré son incohérence, transpire d’une passion pour l’image évidente et d’un sens explosif de la mise en scène.



47 Ronin est une œuvre en mutation, dont certaines parties sont des exemples de percussion alors que d’autres sont dignes d’une série télé nocturne —comprendre qui meuble la grille de diffusion—. Son écriture est complètement manquée, aucun personnage n’émerge vraiment du lot, la romance entre Keanu et la charmeuse Kô Shibasaki ne fonctionne jamais, les méchants sont bien débiles et les ellipses narratives trop exagérées pour que l’ensemble trouve cohérence. Et pourtant, elle est habitée de moments en apesanteurs, témoins généreux d’une âme aux commandes en quête de l’image efficace. Tout le passage portuaire, glauque en diable, où Keanu joue de la tatane sur des tatamis non officiels, ou la partie où il s’aventure avec ses copains ronins au cœur d’une forêt que l’on croirait sortie de chez Miyazaki, pour affronter des moines voldemoriens vaporeux, fonctionne à plein tubes. Véritables moments épiques qui se hissent, visuellement parlant, aux sommets de ce qu’a pu délivrer le genre. Et même si l’empreinte numérique rappelle plus le ciné HK parfois fauché que les prouesses techniques de tutures transformables, elle a vraiment de la gueule. Quand à la polémique sur le tatoué de l’affiche, effectivement il vend du charisme sur papier, mais dans le film lorsqu’il parle, on a envie qu’il se taise immédiatement, ce qu’il fait très bien après ses 10 secondes d’apparition.






Loin de moi l’envie de réhabiliter le film, il est évident que dans sa globalité, il est relativement manqué, mais son ambition visuelle et son caractère trempé le rendent à mes yeux sympathique. Il porte la fougue d'un esprit idéaliste qui souhaitait éduquer Hollywood avec un Wu Xia Pian américain habité par l’esprit du soleil levant (un brin prétentieux, j'en conviens, mais c'est l'audace d'un premier film aussi). Mais à ce niveau de budget, la seule passion et un savoir–faire naissant ne peuvent surmonter la pression de studios qui souhaitent capitaliser leur investissement. En résulte un naufrage d’une tristesse absolue, puisqu’à l’occasion de ce bon film manqué, qui offre des séquences mémorables, un fort potentiel créatif vient de se brûler les ailes : on est surement pas prêt de revoir Carl Erik Rinsch de sitôt. D’autant plus dommage que le jeune homme doit avoir des bollocks en acier trempé, et ce n’est pas cette fin inespérée, anti film grand spectacle par excellence, qui me fera mentir.




 ). Je ne me suis pas ennuyé, niveau mise en scène, la proposition ne manque pas de panache et comme tu le dis, l'intention globale est couillue. C'est un film parfait pour une deuxième partie de soirée en mode pénard même si effectivement la terre où il a été conçue lui a été peu propice ^^
). Je ne me suis pas ennuyé, niveau mise en scène, la proposition ne manque pas de panache et comme tu le dis, l'intention globale est couillue. C'est un film parfait pour une deuxième partie de soirée en mode pénard même si effectivement la terre où il a été conçue lui a été peu propice ^^


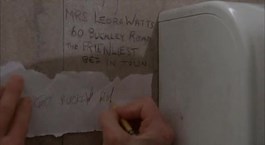











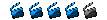



















 Merci pour la remarque, j'ai l'air moins con xD
Merci pour la remarque, j'ai l'air moins con xD






