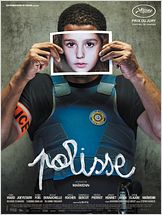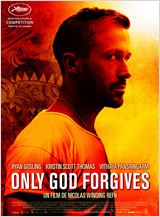Only God Forgives ( 2013 ) - 9/10
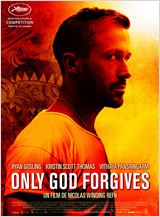
Au cinéma, tout est dans le ressenti. Tant pour le spectateur que pour le réalisateur. Après le succès retentissant de Drive, Nicolas Winding Refn, alors épris d’une colère existentielle qu’il n’explique pas lui-même, quitte les routes sinueuses de Los Angeles pour nous embarquer dans l’enfer de Bangkok. De retour, avec son compère Ryan Gosling, le réalisateur s’entête et renoue avec ses anciens démons, qui faisaient de lui un auteur tranchant pour les uns et repoussant pour les autres. Dans l’idée de rendre son récit mystique, par la symbolique d’un lieu mutique tel que la Thaïlande, Nicolas Winding Refn s’arrange pour détruire ce qu’il avait bâti avec Drive, quitte à perdre une renommée soudaine aux yeux de la critique et du public. Un film, c’est un jouet. On aime cela, on s’amuse avec, puis il s’use et on le casse par pur plaisir ou par volonté d’anéantissement. Et c’est avec audace, qu’Only God Forgives devient le nouveau jouet, le fardeau, le double venimeux de Drive. Le film, d’un duo en parfaite osmose, miroir de l’un pour l’autre, qui devient presque la quête initiatique de son auteur.
Il est d’autant plus intéressant de noter qu’Only God Forgives, au-delà d’être une œuvre influencée et plus riche qu’elle n’y parait, permet à Refn et Gosling de casser leur image, de brouiller cette réputation consensuelle et lisse qui trainait au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Ryan Gosling, parfait Golden Boy des années 2010, se prend corps et âmes au projet. Quittant son rôle du Driver charismatique à l’érotisme latent, il devient un frère fragile et renfermé, ayant la lourde tâche de venger la mort de son frère pour ne pas subir les foudres d’une mère sadique. Frère tué par un mystérieux policier. Derrière un récit inconscient mais sans forcément grandes conséquences, c’est l’esthétisme et la radicalité du voyage mental qui fera mouche. Only God Forgives renait avec l’onirisme sanglant et christique de Valhalla Rising où les silences seront rois, entrecoupés par des excès de violence épidermiques. Cette violence, n’est en aucun cas la même que celle de Quentin Tarantino.
Alors que l’américain aime s’en amuser tant graphiquement que narrativement, celle du danois est froide, malaisante et sans concession où les sonorités grandioses de Cliff Martinez fortifient la tension naissante. Vision de l’enfer et univers impitoyable, la ville de Bangkok, imprégnée de l’imagerie occidentale de Refn avec la pègre et la prostitution, est captée de façon fluorescente, psychédélique et perverse comme a pu le faire Gaspar Noe dans Enter the Void avec la ville tokyoïte. Only God Forgives ne fait qu’un avec son environnement, en cela sublimé par la lumière de Larry Smith, directeur photo d’Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Cette luminosité toujours aussi chatoyante chez Refn, les filtres colorés remplacent les dialogues et sont à eux seuls, des indicateurs d’émotions, comme chez David Lynch et les couloirs rougeâtres de Lost Highway. De Kubrick, Refn s’imprègne de son sens du cadre, de sa géométrie du plan et du montage proche de l’orfèvrerie maladive de Wes Anderson. C’est donc avec cette idée dans l’esprit, qu’Only God Forgives ne ressemble en rien à un Drive 2.0. Loin de là, le réalisateur Danois puise dans ses références les plus cinéphiles, telles Lynch ou Jodorowsky pour continuer dans la veine du cinéma de genre voire de la série B.
Qui dit cinéma de genre, dit schéma narratif connu. Mais qui dit Nicolas Winding Refn, dit personnalité forte. C’est donc dans cette voie-là, que Nicolas Winding continue de tracer son chemin pour se réapproprier les codes du genre, notamment celui de la vengeance, pour en faire un récit existentiel dont le traumatisme du complexe d’Œdipe est au centre du sujet, comme il pouvait l’être dans Santa Sangre de Jodorowsky. D’ailleurs autre parallèle entre les deux films, celui de l’utilisation des mains (terminaison du corps) servant d’éléments pour donner la mort puisque le personnage de Julian tua son père de ses propres mains. Moment sans doute déclencheur de la haine que lui porte sa mère (absurde scène du repas) et donc conséquence de son manque affectif et de son impuissance physique envers les femmes. Cinéma de l’homme, de la brutalité, ce n’est pas la première fois que le réalisateur ouvre la thématique de la fragilité masculine (voire de la castration), puisque cela prenait déjà part dans le Pusher 2.
Julian et le Driver, ont le même mutisme, la même violence mais pas la même adversaire. Ne sachant pas quoi faire entre son désir de vengeance et sa quête de rédemption, Julian perd pied entre réalité et rêverie cauchemardesque. Dans ce cas de figure, Refn prend son monde à contrecourant et fait d’un simple policier, la force du film, une justice divine. Dieu du cinéma qui vient découper l’imagerie du duo Refn/Gosling, ou simple inquisiteur fantasmagorique d’une justice impartiale et violente par le biais de la lame de son sabre sanguinolent, Vithaya Pansringarm est la clé de voute d’une intrigue tumultueuse. Ce justicier rend ses châtiments suivant les remords de ses victimes, ce qui dès lors, rend la violence graphique symbolique et non gratuite (séquence de torture). Comme nous le démontrera la dernière séquence, Refn s’en remettra à son « Dieu » pour donner sa sentence finale. Mais dans son amour presque inégalable pour son art et sa capacité graphique, puis dans sa guerre contre lui-même, Refn y dévoilera son personnage (voire lui-même) déjà condamné à une certaine forme de pénitence mais ayant pour conséquences de voir surgir une paix intérieure retrouvée après un déluge de colère viscéral. Film de genre, agonie mentale, Only God Forgives parait surtout être une œuvre thérapie pour un réalisateur en proie à ses pires démons. Etrangement fascinant.