The Master - Paul Thomas Anderson - 2012
Cinq ans après Threre will be Blood, Paul Thomas Anderson revient avec un nouveau choc des titans entre deux personnages hors normes qui vont se lier au travers d'une relation amour-haine source de création et de destruction. Freddie Quell, ancien combattant dans le Pacifique, est un homme perdu dans l'alcool (qu'il fabrique lui-même) et complètement inadapté à la vie d'après-guerre. Sa rencontre avec le fameux "Maître", Lancaster Dodd, leader charismatique de la Cause, va bouleverser son caractère d'homme rustre et indomptable.
Difficile de ne pas faire un parallèle avec le précédent film de PTA lorsque l'on découvre ce nouvel opus. A la différence majeure que The Master se concentre exclusivement sur ses personnages et fait pratiquement abstraction de toute toile de fond. La ruée vers l'or noir servait le propos mégalomane de Daniel Plainview dans There will be Blood, accroissant ainsi la fascination pour son personnage mais ici, le spectateur ne saura presque rien sur les fondements de la Cause et ses aspirations. Une"secte" naissante qui voit son gourou se nourrir de ses rencontres avec les brebis qu'il juge égarées. Ici, l'homme religieux (enfin, selon ses propres préceptes) soumet le marginal à son dictât, alors que dans There Will be Blood, c'était le marginal (Plainview était un capitaliste précurseur assoiffé de pouvoir) qui tenait sous sa coupe l'homme pieux.
Ces relations hypnotiques entre des hommes que tout oppose sont la marque de fabrique du cinéma de PTA, qui radicalise encore plus sa démarche et laissera nombre de spectateurs sur le carreau. Pris individuellement, The Master a tout pour dérouter. Replacé dans le contexte de l'oeuvre de son auteur, il trouve une résonance et une cohésion qui incite à la réflexion. On ne peut cependant pas tout excuser à ce film pour la simple raison qu'il sort de l'esprit hautement créatif d'un cinéaste sans équivalent dans la profession (et encore plus pour un jeune quadra). Pendant 1h15, on est captivé par les joutes verbales régulièrement enthousiasmantes entre les deux interprètes principaux. Mais il reste encore une heure de métrage au cours de laquelle PTA radote à plus ou moins forte dose (le rite/exercice consistant à enchaîner les allers/retours entre un mur et une fenêtre est barbant).
Paradoxalement, et alors que The Master se conclue de manière bien moins pessimiste que TWBB, c'est le besoin de liberté de Freddy Quell, qui se soustrait partiellement de l'influence de Lancaster Dodd dans la dernière partie du film, qui coïncide avec la baisse d'attention (voire l'ennui) éprouvée par l'audience. Il faut dire que les performances assez énormes de Joaquin Phoenix et de Philip Seymour Hoffman lors de leurs scènes communes ne sont pas étrangères à l'attrait pour cette histoire aussi fascinante que rebutante. On peut reprocher au premier quelques élans cabotins mais sa prestation force tout de même le respect. Amaigri, bourré de tics et communiquant de manière syncopée, il impressionne. Son partenaire de jeu est à l'avenant, transcendé par les convictions illusoires de son personnage. Le teint blafard d'Hoffman, qui vire au rouge écarlate lors de quelques accès de colère ou de discours enflammés au nom de la Cause, sert parfaitement le rôle. Amy Adams est également très bonne, inquiétante car ne laissant apparaître aucun doute au sujet de ses convictions.
Visuellement, PTA rend l'ordinaire extraordinaire. Son drame multiplie les cadrages audacieux et transforme des plans qui seraient d'une banalité confondante chez la concurrence en tableaux somptueux. On est régulièrement sans voix devant la beauté des images. Jonny Greenwood récidive à la musique pour un résultat toujours aussi atypique mais peut être moins inspiré que lors de leur précédente collaboration. Enfin, comment ne pas voir un brin d'autobiographie dans ce film qui traite de la soumission et de l'influence. PTA reprend encore un peu plus le flambeau abandonné par ses maîtres. On tient peut être ici son film le plus kubrickien (est-ce un mal ou un bien, chacun en jugera). Son prochain projet sera cependant décisif car The Master divise grandement, même parmi ses plus fidèles admirateurs. Le génie aujourd'hui reconnu aurait tôt fait de se muer en marginal reclus, comme ses personnages en quelque sorte...
Difficile de ne pas faire un parallèle avec le précédent film de PTA lorsque l'on découvre ce nouvel opus. A la différence majeure que The Master se concentre exclusivement sur ses personnages et fait pratiquement abstraction de toute toile de fond. La ruée vers l'or noir servait le propos mégalomane de Daniel Plainview dans There will be Blood, accroissant ainsi la fascination pour son personnage mais ici, le spectateur ne saura presque rien sur les fondements de la Cause et ses aspirations. Une"secte" naissante qui voit son gourou se nourrir de ses rencontres avec les brebis qu'il juge égarées. Ici, l'homme religieux (enfin, selon ses propres préceptes) soumet le marginal à son dictât, alors que dans There Will be Blood, c'était le marginal (Plainview était un capitaliste précurseur assoiffé de pouvoir) qui tenait sous sa coupe l'homme pieux.
Ces relations hypnotiques entre des hommes que tout oppose sont la marque de fabrique du cinéma de PTA, qui radicalise encore plus sa démarche et laissera nombre de spectateurs sur le carreau. Pris individuellement, The Master a tout pour dérouter. Replacé dans le contexte de l'oeuvre de son auteur, il trouve une résonance et une cohésion qui incite à la réflexion. On ne peut cependant pas tout excuser à ce film pour la simple raison qu'il sort de l'esprit hautement créatif d'un cinéaste sans équivalent dans la profession (et encore plus pour un jeune quadra). Pendant 1h15, on est captivé par les joutes verbales régulièrement enthousiasmantes entre les deux interprètes principaux. Mais il reste encore une heure de métrage au cours de laquelle PTA radote à plus ou moins forte dose (le rite/exercice consistant à enchaîner les allers/retours entre un mur et une fenêtre est barbant).
Paradoxalement, et alors que The Master se conclue de manière bien moins pessimiste que TWBB, c'est le besoin de liberté de Freddy Quell, qui se soustrait partiellement de l'influence de Lancaster Dodd dans la dernière partie du film, qui coïncide avec la baisse d'attention (voire l'ennui) éprouvée par l'audience. Il faut dire que les performances assez énormes de Joaquin Phoenix et de Philip Seymour Hoffman lors de leurs scènes communes ne sont pas étrangères à l'attrait pour cette histoire aussi fascinante que rebutante. On peut reprocher au premier quelques élans cabotins mais sa prestation force tout de même le respect. Amaigri, bourré de tics et communiquant de manière syncopée, il impressionne. Son partenaire de jeu est à l'avenant, transcendé par les convictions illusoires de son personnage. Le teint blafard d'Hoffman, qui vire au rouge écarlate lors de quelques accès de colère ou de discours enflammés au nom de la Cause, sert parfaitement le rôle. Amy Adams est également très bonne, inquiétante car ne laissant apparaître aucun doute au sujet de ses convictions.
Visuellement, PTA rend l'ordinaire extraordinaire. Son drame multiplie les cadrages audacieux et transforme des plans qui seraient d'une banalité confondante chez la concurrence en tableaux somptueux. On est régulièrement sans voix devant la beauté des images. Jonny Greenwood récidive à la musique pour un résultat toujours aussi atypique mais peut être moins inspiré que lors de leur précédente collaboration. Enfin, comment ne pas voir un brin d'autobiographie dans ce film qui traite de la soumission et de l'influence. PTA reprend encore un peu plus le flambeau abandonné par ses maîtres. On tient peut être ici son film le plus kubrickien (est-ce un mal ou un bien, chacun en jugera). Son prochain projet sera cependant décisif car The Master divise grandement, même parmi ses plus fidèles admirateurs. Le génie aujourd'hui reconnu aurait tôt fait de se muer en marginal reclus, comme ses personnages en quelque sorte...
8/10










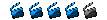

 ). En fait, il n'y a strictement rien à dire sur ce film. C'est le néant absolu. C'est moche. C'est même pas drôle. Un truc complètement con, voilà tout. En temps normal, le caractère inoffensif de l'entreprise me rendrait plus indulgent. Mais là, non. Comme j'ai vu Detachment ce mois ci, je vais être gentil et mettre 2.
). En fait, il n'y a strictement rien à dire sur ce film. C'est le néant absolu. C'est moche. C'est même pas drôle. Un truc complètement con, voilà tout. En temps normal, le caractère inoffensif de l'entreprise me rendrait plus indulgent. Mais là, non. Comme j'ai vu Detachment ce mois ci, je vais être gentil et mettre 2.








