
Anecdotes / Dépeches AFP
Modérateur: padri18
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Anecdote du jour: Histoire Vraie...
Comment appeler la police quand vous êtes vieux et que vous n'êtes plus très mobile...
Georges PHILLIPS, un homme d'un certain âge vivant à VANCOUVER au Canada allait se coucher quand sa femme lui dit qu'il avait laissé la lumière dans l'abri de jardin qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la chambre. Georges ouvrit la porte arrière pour éteindre, mais il vit qu'il y avait des personnes dans l'abri en train de voler du matériel.
Il appela la police qui lui demanda : "quelqu'un s'est-il introduit chez vous" ?
"il répondit : "non, mais des gens sont en train de me voler après s'être introduits dans ma cabane de jardin".
La police répondit : "toutes nos patrouilles sont occupées il faut vous enfermer et un officier passera dès qu'il sera libre".
Georges dit "O.K" puis il raccrocha, attendit 30 secondes et rappela la police.
"Bonjour, je viens de vous appeler pour des voleurs dans mon abri de jardin... Ne vous inquiétez plus à ce propos... je les ai tués" Puis il raccrocha.
Dans les cinq minutes, 6 voitures de police, une équipe de tireurs, un hélicoptère, deux camions de pompiers, une ambulance et le samu local se présentèrent devant son domicile et les voleurs furent pris en flagrant délit.
Un policier lui dit : "je croyais que vous les aviez tués..."
Georges répondit : "Je croyais que vous m'aviez dit que vous n'aviez personne de disponible ..."
Moralité : il ne faut pas Emmerder les Vieux.
Comment appeler la police quand vous êtes vieux et que vous n'êtes plus très mobile...
Georges PHILLIPS, un homme d'un certain âge vivant à VANCOUVER au Canada allait se coucher quand sa femme lui dit qu'il avait laissé la lumière dans l'abri de jardin qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la chambre. Georges ouvrit la porte arrière pour éteindre, mais il vit qu'il y avait des personnes dans l'abri en train de voler du matériel.
Il appela la police qui lui demanda : "quelqu'un s'est-il introduit chez vous" ?
"il répondit : "non, mais des gens sont en train de me voler après s'être introduits dans ma cabane de jardin".
La police répondit : "toutes nos patrouilles sont occupées il faut vous enfermer et un officier passera dès qu'il sera libre".
Georges dit "O.K" puis il raccrocha, attendit 30 secondes et rappela la police.
"Bonjour, je viens de vous appeler pour des voleurs dans mon abri de jardin... Ne vous inquiétez plus à ce propos... je les ai tués" Puis il raccrocha.
Dans les cinq minutes, 6 voitures de police, une équipe de tireurs, un hélicoptère, deux camions de pompiers, une ambulance et le samu local se présentèrent devant son domicile et les voleurs furent pris en flagrant délit.
Un policier lui dit : "je croyais que vous les aviez tués..."
Georges répondit : "Je croyais que vous m'aviez dit que vous n'aviez personne de disponible ..."
Moralité : il ne faut pas Emmerder les Vieux.
- zack_
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
 ça c'est une vérité !!!
ça c'est une vérité !!! 

cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
-

jean-michel - Godzilla
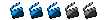
- Messages: 12763
- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04
- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
pas mieux !!!..... 
Je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt qu'aimé pour ce que je ne suis pas...
-

lucifred - Godzilla
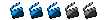
- Messages: 13235
- Inscription: Lun 07 Avr 2008, 16:22
- Localisation: Mustard City
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Mon père a fait le même coup une fois, et ça marche du tonnerre cette technique. 

Mes DVD a vendre 
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
helldude™ a écrit:bik et moi vivions déjà le grand amour avant l'épisode de l'éjaculation faciale
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
-

Riton - Hulk
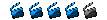
- Messages: 15046
- Inscription: Mar 29 Mai 2007, 09:55
- Localisation: Au CDR (Comité de Défense des Roux) puis après, At the McLaren's pub with Ted
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Georges PHILLIPS, un homme d'un certain âge vivant à VANCOUVER
et ton père s'appellerait-il pas Maurice?
- zack_
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Non, et tant mieux d'ailleurs 

Mes DVD a vendre 
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
helldude™ a écrit:bik et moi vivions déjà le grand amour avant l'épisode de l'éjaculation faciale
(\__/)
(='.'=)
(")_(")
-

Riton - Hulk
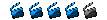
- Messages: 15046
- Inscription: Mar 29 Mai 2007, 09:55
- Localisation: Au CDR (Comité de Défense des Roux) puis après, At the McLaren's pub with Ted
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Déces d'un des musclés.
Admin: Déjà annoncé dans le topic RIP
oui, mais je l'avais posté en 1er ici, c pas grave
Admin: Déjà annoncé dans le topic RIP
oui, mais je l'avais posté en 1er ici, c pas grave

-

caducia - Hulk
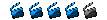
- Messages: 15247
- Inscription: Sam 09 Juin 2007, 12:57
- Localisation: on the red carpet
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
C'est papy qu'est parti le premier 
dunandan a écrit: Puis j'oubliais de dire que Logan me faisait penser à Burton avec sa méchanceté légendaire concernant certains films/réalisateurs/acteurs
-

Jeff Buckley - Spiderman
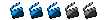
- Messages: 11413
- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 03:30
- Localisation: Boulogne-sur-Mer (62)
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
A l’occasion de la sortie de Mesrine en Grande-Bretagne, The Guardian a cherché à savoir pourquoi les gangsters de cinéma étaient en France plus “moraux” et plus “chics” qu’ailleurs. Analyse.
27.08.2009 | Joe Queenan | The Guardian
( courrier international)
Le film en deux parties sur Jacques Mesrine réalisé par Jean-François Richet sort cet été en Grande-Bretagne. Les deux volets ont été rebaptisés Mesrine: Killer Instinct et Mesrine: Public Enemy n° 1 ; le premier a été bien accueilli et le second sortira le 28 août. Le critique du Guardian, par exemple, explique : “A la fin, je ne pouvais croire que deux heures s’étaient écoulées”, tant le film l’a captivé. La presse britannique dans son ensemble salue par ailleurs l’interprétation de Vincent Cassel. Le Daily Telegraph écrit même que son interprétation est si impressionnante qu’elle rend “superflue tout séjour à Hollywood” pour muscler la carrière de l’acteur.
Si une scène devait résumer l’essence du film policier à la française, on la trouverait à peu près au milieu du classique de 1954 Touchez pas au grisbi, de Jacques Becker. Serrée de près par la police, en disgrâce auprès de ses semblables des bas-fonds parisiens moins recommandables encore, le vieux virtuose du braquage joué par Jean Gabin décide de se mettre quelque temps au vert. S’installant dans un pied-à-terre secret qui prend la forme d’un appartement étonnamment chic, ce fumeur compulsif revêt un élégant pyjama sorti de nulle part avant de s’assurer que René Dary, son complice des mauvais coups, est lui aussi à l’aise dans ses vêtements d’intérieur. La leçon de cette scène est limpide : aussi précaire que soit la situation, aussi incessante que soit la traque de la police, un homme ne doit jamais renoncer à son confort, à commencer par son pyjama.
Les enjeux de qualité de vie sont une des marques récurrentes du film policier français, qui parle autant de joie de vivre* que de joie de tuer*. Qui d’autre qu’un Français pourrait faire un film (Classe tous risques, réalisé par Claude Sautet en 1960) sur un malfrat qui cherche un foyer comme il faut pour ses gamins alors que toutes les polices sont à ses trousses ? Qui d’autre qu’un Français pourrait faire un film (Rien ne va plus, Claude Chabrol, 1997) sur une artiste de l’escroquerie, incarnée par Isabelle Huppert, qui cherche à s’émanciper de son escroc de père en s’engageant dans une relation amoureuse avec un escroc plus jeune et plus séduisant, qu’elle a bien l’intention de plumer ?
Les réalisateurs français ont toujours été obsédés par les malfrats, mais leurs films n’ont pas grand-chose à voir avec ceux qui se tournent aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Les films de gangsters américains sont palpitants, mais manquent souvent de profondeur ; les Britanniques, eux, mettent surtout en scène des petits voyous et manquent toujours de profondeur – ce qui explique que les cinéphiles anglophones trouvent souvent les gangsters cool, mais les voient rarement comme des exemples à suivre. Les Français, en revanche, aiment les gangsters philosophes et les films offrant une analyse de la société au sens large, comme si la société avait besoin de l’expertise des réalisateurs français.
Je ne dis pas que les films policiers français sont marqués par une authentique profondeur, mais c’est en tout cas ce qu’aiment à penser les réalisateurs français. Leurs films regorgent de répliques creuses du type “les temps changent, pas les hommes” – ou encore “l’homme naît innocent, mais ne le reste pas”. Le niveau a baissé depuis Voltaire, c’est certain. Le message classiquement délivré par un film policier français est que le plus minable des hors-la-loi est tenu par un code moral qui échappe à la compréhension du citoyen lambda respectueux de la loi – et qu’à leur manière les malfrats ont plus de principes que les policiers. C’est le thème de Mesrine (réalisé par Jean-François Richet, 2008), mais aussi du classique de 1937 de Julien Duvivier Pépé le Moko, d’A bout de souffle (1960) de Godard ou encore du très remarqué Du rififi chez les hommes de Jules Dassin, sorti en 1955.
La qualité principale du malfrat de cinéma : l’ennui
L’idée d’un code d’honneur dans la pègre est l’une de ces incongruités qui, depuis toujours, passent pour de la sagesse en France, où un fond d’anarchisme de pacotille cohabite bon an mal an avec des comportements profondément bourgeois à l’égard de toute chose. Dans les films français, les gangsters ont toujours un charme étrange, sont avant tout des gars épatants qui ont perdu le contrôle de leur personnalité quelque part en chemin.
Mais, comme le cinéma ne cesse de le démontrer, les films n’ont pas besoin d’être cohérents ni logiques pour être excellents. Surtout quand ils sont aussi beaux que Le Cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970), Le Samouraï (Jean-Pierre Melville, 1967) ou Pépé le Moko. Abstraction faite de leurs absurdités philosophiques, les excellents films policiers français sont remarquablement nombreux.
S’ils sont si bons, c’est parce que tout le monde veut en être : tous les réalisateurs – de François Truffaut à Claude Lelouch, en passant par Claude Sautet ou Claude Chabrol – se sont adonnés au genre au moins une fois, et les meilleurs films mettent en scène la fine fleur des acteurs français, de Jean Gabin à Jean-Paul Belmondo, en passant par Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant, Vincent Cassel, Yves Montand, Alain Delon, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, plus tout une ribambelle d’acteurs magnifiques mais méconnus hors de France. Vous en avez donc pour votre argent, et cela vaut le coup.
Il serait fâcheux de conclure cet exposé sans parler de l’existentialisme et de l’ennui. Ces deux indissociables pierres angulaires de la civilisation française moderne jouent un rôle clé dans le succès de la version hexagonale de ce genre cinématographique. Avant même la théorisation de l’existentialisme, au début des années 1940, et avant même que l’ennui ne soit inventé et breveté par Jean-Paul Sartre, en 1944, les malfrats français étaient déjà souvent en proie au tourment et à un ennui profond. C’est l’ennui qui précipite Pépé le Moko vers son destin, lorsqu’il abandonne stupidement l’enceinte protectrice de la casbah pour vivre son amour pour une Parisienne aisée et sophistiquée. C’est l’ennui qui conduit au désastre l’étincelant mais effacé Delon, aussi bien dans Le Cercle rouge que dans Le Samouraï. L’ennui, encore, qui laisse Belmondo mort sur le pavé parisien à la fin d’A bout de souffle. Vivre chaque jour comme si c’était le dernier, mais le faire sans enthousiasme, tel est le cocktail de presque tous les films français que j’ai vus. Le seul film policier français dont je me souvienne dans lequel tout le monde semble déborder d’énergie est La Balance, récompensé par une avalanche de césars en 1983. Mais La Balance a été réalisé par Bob Swain – un Américain.
27.08.2009 | Joe Queenan | The Guardian
( courrier international)
Le film en deux parties sur Jacques Mesrine réalisé par Jean-François Richet sort cet été en Grande-Bretagne. Les deux volets ont été rebaptisés Mesrine: Killer Instinct et Mesrine: Public Enemy n° 1 ; le premier a été bien accueilli et le second sortira le 28 août. Le critique du Guardian, par exemple, explique : “A la fin, je ne pouvais croire que deux heures s’étaient écoulées”, tant le film l’a captivé. La presse britannique dans son ensemble salue par ailleurs l’interprétation de Vincent Cassel. Le Daily Telegraph écrit même que son interprétation est si impressionnante qu’elle rend “superflue tout séjour à Hollywood” pour muscler la carrière de l’acteur.
Si une scène devait résumer l’essence du film policier à la française, on la trouverait à peu près au milieu du classique de 1954 Touchez pas au grisbi, de Jacques Becker. Serrée de près par la police, en disgrâce auprès de ses semblables des bas-fonds parisiens moins recommandables encore, le vieux virtuose du braquage joué par Jean Gabin décide de se mettre quelque temps au vert. S’installant dans un pied-à-terre secret qui prend la forme d’un appartement étonnamment chic, ce fumeur compulsif revêt un élégant pyjama sorti de nulle part avant de s’assurer que René Dary, son complice des mauvais coups, est lui aussi à l’aise dans ses vêtements d’intérieur. La leçon de cette scène est limpide : aussi précaire que soit la situation, aussi incessante que soit la traque de la police, un homme ne doit jamais renoncer à son confort, à commencer par son pyjama.
Les enjeux de qualité de vie sont une des marques récurrentes du film policier français, qui parle autant de joie de vivre* que de joie de tuer*. Qui d’autre qu’un Français pourrait faire un film (Classe tous risques, réalisé par Claude Sautet en 1960) sur un malfrat qui cherche un foyer comme il faut pour ses gamins alors que toutes les polices sont à ses trousses ? Qui d’autre qu’un Français pourrait faire un film (Rien ne va plus, Claude Chabrol, 1997) sur une artiste de l’escroquerie, incarnée par Isabelle Huppert, qui cherche à s’émanciper de son escroc de père en s’engageant dans une relation amoureuse avec un escroc plus jeune et plus séduisant, qu’elle a bien l’intention de plumer ?
Les réalisateurs français ont toujours été obsédés par les malfrats, mais leurs films n’ont pas grand-chose à voir avec ceux qui se tournent aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Les films de gangsters américains sont palpitants, mais manquent souvent de profondeur ; les Britanniques, eux, mettent surtout en scène des petits voyous et manquent toujours de profondeur – ce qui explique que les cinéphiles anglophones trouvent souvent les gangsters cool, mais les voient rarement comme des exemples à suivre. Les Français, en revanche, aiment les gangsters philosophes et les films offrant une analyse de la société au sens large, comme si la société avait besoin de l’expertise des réalisateurs français.
Je ne dis pas que les films policiers français sont marqués par une authentique profondeur, mais c’est en tout cas ce qu’aiment à penser les réalisateurs français. Leurs films regorgent de répliques creuses du type “les temps changent, pas les hommes” – ou encore “l’homme naît innocent, mais ne le reste pas”. Le niveau a baissé depuis Voltaire, c’est certain. Le message classiquement délivré par un film policier français est que le plus minable des hors-la-loi est tenu par un code moral qui échappe à la compréhension du citoyen lambda respectueux de la loi – et qu’à leur manière les malfrats ont plus de principes que les policiers. C’est le thème de Mesrine (réalisé par Jean-François Richet, 2008), mais aussi du classique de 1937 de Julien Duvivier Pépé le Moko, d’A bout de souffle (1960) de Godard ou encore du très remarqué Du rififi chez les hommes de Jules Dassin, sorti en 1955.
La qualité principale du malfrat de cinéma : l’ennui
L’idée d’un code d’honneur dans la pègre est l’une de ces incongruités qui, depuis toujours, passent pour de la sagesse en France, où un fond d’anarchisme de pacotille cohabite bon an mal an avec des comportements profondément bourgeois à l’égard de toute chose. Dans les films français, les gangsters ont toujours un charme étrange, sont avant tout des gars épatants qui ont perdu le contrôle de leur personnalité quelque part en chemin.
Mais, comme le cinéma ne cesse de le démontrer, les films n’ont pas besoin d’être cohérents ni logiques pour être excellents. Surtout quand ils sont aussi beaux que Le Cercle rouge (Jean-Pierre Melville, 1970), Le Samouraï (Jean-Pierre Melville, 1967) ou Pépé le Moko. Abstraction faite de leurs absurdités philosophiques, les excellents films policiers français sont remarquablement nombreux.
S’ils sont si bons, c’est parce que tout le monde veut en être : tous les réalisateurs – de François Truffaut à Claude Lelouch, en passant par Claude Sautet ou Claude Chabrol – se sont adonnés au genre au moins une fois, et les meilleurs films mettent en scène la fine fleur des acteurs français, de Jean Gabin à Jean-Paul Belmondo, en passant par Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant, Vincent Cassel, Yves Montand, Alain Delon, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, plus tout une ribambelle d’acteurs magnifiques mais méconnus hors de France. Vous en avez donc pour votre argent, et cela vaut le coup.
Il serait fâcheux de conclure cet exposé sans parler de l’existentialisme et de l’ennui. Ces deux indissociables pierres angulaires de la civilisation française moderne jouent un rôle clé dans le succès de la version hexagonale de ce genre cinématographique. Avant même la théorisation de l’existentialisme, au début des années 1940, et avant même que l’ennui ne soit inventé et breveté par Jean-Paul Sartre, en 1944, les malfrats français étaient déjà souvent en proie au tourment et à un ennui profond. C’est l’ennui qui précipite Pépé le Moko vers son destin, lorsqu’il abandonne stupidement l’enceinte protectrice de la casbah pour vivre son amour pour une Parisienne aisée et sophistiquée. C’est l’ennui qui conduit au désastre l’étincelant mais effacé Delon, aussi bien dans Le Cercle rouge que dans Le Samouraï. L’ennui, encore, qui laisse Belmondo mort sur le pavé parisien à la fin d’A bout de souffle. Vivre chaque jour comme si c’était le dernier, mais le faire sans enthousiasme, tel est le cocktail de presque tous les films français que j’ai vus. Le seul film policier français dont je me souvienne dans lequel tout le monde semble déborder d’énergie est La Balance, récompensé par une avalanche de césars en 1983. Mais La Balance a été réalisé par Bob Swain – un Américain.
cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
-

jean-michel - Godzilla
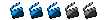
- Messages: 12763
- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04
- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
J'ai voulu le mettre dans le topic du film mais y en a même pas eu de créé 
- zack_
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Pourquoi Transparence International propose la nomination d'un procureur "indépendant" de l'exécutif ?
Supprimer le juge d'instruction, comme le préconise le rapport Léger, est défendable sur certains points. Parfois juge et procureur font double emploi puisqu'ils ont tous les deux le pouvoir d'instruire des affaires. Néanmoins, dans les affaires de grande corruption, le procureur sera soumis à l'autorité du ministre de la justice, par conséquent il hésitera à mener une enquête et à s'exposer.
Si les magistrats n'étaient pas indépendants du pouvoir politique, toute une série de grandes affaires ne seraient jamais sorties. C'est la raison pour laquelle si l'on supprime le juge d'instruction il faut absolument que le procureur recouvre son indépendance.
Selon vous, quelles sont les affaires récentes qui n'auraient jamais été instruites sans l'indépendance des juges d'instruction ?
L'affaire ELF a été extrêmement gênante pour le pouvoir, et elle l'est encore. Elle a révélé des réseaux de corruption français avec des Etats africains. L'affaire Clearstream est également dérangeante. Dans celle du juge Borel [assassiné en mars 1995 à Djibouti alors qu'il était détaché par la France auprès des autorités djiboutiennes], il est évident que l'Etat a menti...
Pourquoi cette réforme arrive aujourd'hui ?
Des personnes à la tête de l'Etat veulent avoir les coudées franches pour agir comme elles le veulent.
Pensez-vous que votre revendication d'un procureur indépendant a des chances d'aboutir ?
La Cour européenne de justice a estimé que le procureur français n'était pas un magistrat en raison de ses liens avec le pouvoir. Adopter le projet tel quel fera passer la France pour un pays à moitié démocratique, c'est très gênant pour le gouvernement.
mais où va ton??? système mafioso d'état??
Supprimer le juge d'instruction, comme le préconise le rapport Léger, est défendable sur certains points. Parfois juge et procureur font double emploi puisqu'ils ont tous les deux le pouvoir d'instruire des affaires. Néanmoins, dans les affaires de grande corruption, le procureur sera soumis à l'autorité du ministre de la justice, par conséquent il hésitera à mener une enquête et à s'exposer.
Si les magistrats n'étaient pas indépendants du pouvoir politique, toute une série de grandes affaires ne seraient jamais sorties. C'est la raison pour laquelle si l'on supprime le juge d'instruction il faut absolument que le procureur recouvre son indépendance.
Selon vous, quelles sont les affaires récentes qui n'auraient jamais été instruites sans l'indépendance des juges d'instruction ?
L'affaire ELF a été extrêmement gênante pour le pouvoir, et elle l'est encore. Elle a révélé des réseaux de corruption français avec des Etats africains. L'affaire Clearstream est également dérangeante. Dans celle du juge Borel [assassiné en mars 1995 à Djibouti alors qu'il était détaché par la France auprès des autorités djiboutiennes], il est évident que l'Etat a menti...
Pourquoi cette réforme arrive aujourd'hui ?
Des personnes à la tête de l'Etat veulent avoir les coudées franches pour agir comme elles le veulent.
Pensez-vous que votre revendication d'un procureur indépendant a des chances d'aboutir ?
La Cour européenne de justice a estimé que le procureur français n'était pas un magistrat en raison de ses liens avec le pouvoir. Adopter le projet tel quel fera passer la France pour un pays à moitié démocratique, c'est très gênant pour le gouvernement.
mais où va ton??? système mafioso d'état??
cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
hypersubjectiviste : le beau filmique intime.
TOP100
-

jean-michel - Godzilla
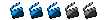
- Messages: 12763
- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04
- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin
Re: Anecdotes/ Dépeches AFP
Un piéton est mort ce lundi en fin d'après-midi après avoir été percuté par un tramway dans le sixième arrondissement de Lyon, près des Charpennes
Un homme de 57 ans a été heurté par un tramway vers 17h40 alors qu'il traversait la chaussée à l'intersection de l'avenue Thiers et de la rue des Emeraudes à la limite entre Lyon et Villeurbanne.
L'homme est décédé quelques minutes après le choc.
Cet accident a provoqué de fortes perturbations et l'interruption temporaire de la circulation de la ligne 1 du tramway.
Source : Progrès
Un homme de 57 ans a été heurté par un tramway vers 17h40 alors qu'il traversait la chaussée à l'intersection de l'avenue Thiers et de la rue des Emeraudes à la limite entre Lyon et Villeurbanne.
L'homme est décédé quelques minutes après le choc.
Cet accident a provoqué de fortes perturbations et l'interruption temporaire de la circulation de la ligne 1 du tramway.
Source : Progrès

-

Timerfuller1 - Rambo

- Messages: 865
- Inscription: Jeu 26 Juil 2007, 22:14
- Localisation: Bron (69)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Founded by Zack_
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah
Traduction par phpBB-fr.com





