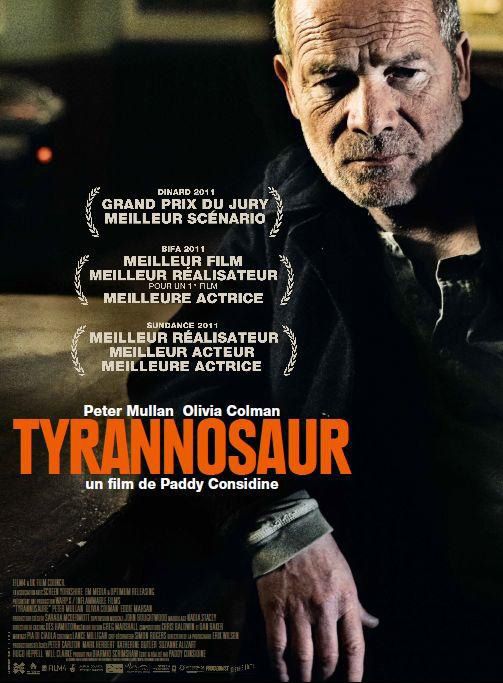Le cercle des poètes disparates
Lorsqu’un poème est écrit en prose ou en vers libre, il perd instantanément la faculté d’immédiate séduction qu’avait son prédécesseur en vers : la rime, le rythme, musique et cadence de la forme dont la perfection impressionne et suscite l’admiration : pour la beauté, pour la maitrise.
Dénué de ces contraintes, le poème devient mystère : pourquoi tel enchainement de mot serait-il subitement poésie ? Quelle valeur attribuer à ces termes ? A ces sonorités, ces répétitions ? Une attente nait chez le lecteur, - non loin de l’angoisse pour certains - : que me dit-on ? Que dois-je voir ? Qu’est-ce qui pourrait m’échapper et relevait pourtant de l’art ?
Cette question semble à l’origine même de l’écriture de Paterson, et, quand on y songe, préoccupe Jarmusch depuis ses débuts : traquer les traces poétique dans l’insolite du quotidien, que Perec nommait si bien l’infraordinaire.
C’est donc aux antipodes absolus d’Only lovers letf alive que se situe ce nouveau chapitre de sa filmographie. Le récit, organisé par journées sensiblement identiques d’une semaine de labeur, suit la routine de Paterson, chauffeur de bus dans une ville de seconde zone qui avait tout pour être qualifiée d’anonyme. En véritable ethnologue, Jarmusch décline tous les éléments de cette ville où se succèdent la brique et les friches industrielles : conversations des passagers du bus, préoccupations de ses collègues ou de l’épouse en femme d’intérieur, jusqu’au barman, sorte de gardien de musée : tous ont à cœur de défendre leur ville, et notamment ses illustres natifs, l’occasion pour le cinéaste du name dropping un peu vain dont il est coutumier.
Nul événement, donc, et presqu’aucun élément perturbateur : l’écriture des poèmes, au contraire, exacerbe l’absence de drame puisqu’elle se focalise, à l’image de celle de William Carlos Williams, cité à l’envi, sur la description des éléments les plus inertes et banals.
C’est là l’une des étonnantes mauvaises surprises du film : les séances d’écriture et l’esthétique qui les accompagne. Le texte à l’écran n’est déjà pas du meilleur effet, mais les fondus enchainés et les plans d’eau viennent encore alourdir la charge, et desservent beaucoup la légèreté assumée des vers en question.
C’est d’autant plus étonnant qu’en matière de poésie, la forme du film lui-même est travaillée avec une grande pertinence. Tout ce qui fait la singularité bien connue de Jarmusch s’articule exactement comme un poème. C’est, tout d’abord, le principe des rimes internes et de la musicalité qui structure ces éléments apparemment anodins. On ne reviendra pas sur le fait qu’Adam Driver joue un bus driver du nom de Paterson dans la ville du même nom. Le motif des « twins » par exemple, évoqué comme un rêve de Laura au premier matin, se retrouve ainsi dans un nombre incalculable de scènes : enfants, vielles dames, amis, tous semblent vivre sous ce régime particulier ; de la même manière, la « boule de feu » crainte pour l’accident de bus revient dans trois bouches différentes, et les « water falls » occupent une petite fille rencontrée « au hasard » comme l’épouse le soir même. De ce fait, les coïncidences ne sont plus de mise, et Jarmusch souligne avec plaisir, comme il le faisait déjà dans Ghost Dog, les harmonies et les échos entre les conversations et les situations : aucune rencontre n’est due au hasard, et l’on s’en étonne à peine.
Mais au-delà de cette écriture, c’est l’insolite qui prend encore davantage la charge poétique, avant tout incarné par le personnage de Golshifteh Farahani : son obsession pour le graphisme, son désir de réussite, ses lubies illuminent autant qu’elles inquiètent avec tendresse. La distance de Paterson sur ce grain de folie semble à l’unisson de celle du scénariste, tout comme l’amour éperdu qu’il lui voue. L’étrangeté n’est pas ici une fin en soi – comme elle a pu l’être par moments chez Jarmusch : c’est un levier vers la contemplation, une attention accrue qui est celle de la plume du poète, et de l’attention de son lecteur. Il en découle, au prix d’une certaine lenteur, quelques modestes miracles. Et une envie renouvelée de se lever le matin suivant.