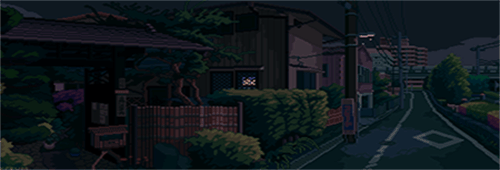I had a dream.
A la sortie de ce quatrième volet, on aurait pu imaginer une brutale prise de conscience. Une réunion au sommet, entre les pontes du l’entertainment, qui auraient repris point par point tout ce que ce film a de raté pour repartir sur des bases saines.
On aurait pu imaginer une sorte de nouveau dogme appliqué aux blockbusters, qui préciserait que revenir des décennies après sur une franchise qui fit la gloire de son époque, c’est probablement une mauvaise idée.
Que les marmottes en CGI, c’est laid.
Que les falaises et la jungle en CGI, aussi.
Que le principe du « toujours plus » a ses limites, qu’on nomme le grotesque : trois chutes du Niagara successives, par exemple. Une bombe atomique et un frigo, par exemple. Un combat à l’épée entre deux jeeps. Une transformation en Tarzan. Etc., etc., etc.
Que le jeu sur la nouvelle génération, en plus d’occasionner une pâle copie, gêne fortement, d’autant qu’il fut déjà exploité avec talent dans La Dernière Croisade. Shia LaBeouf qui se peigne en toutes circonstances est aussi crédible sur sa Harley que Johnny face à un verre de Perrier, et les scènes de ménage entre les sexagénaires certes moins embarrassantes que le mariage final, mais tout de même bien dispensables.
Que l’idée de laisser intervenir Georges Lucas, qui après avoir souillé Star Wars vient essuyer ses mains grasses sur cette franchise, aurait dû être évitée comme la peste.
C’est la fête du slip : on mélange Eldorado et Roswell, canal parapsychique et crâne aux vertus proche de l’anneau, on fait remonter l’archéologie aux aliens et on finit comme un mauvais épisode de Stargate
On se serait flagellé un moment, on aurait juré qu’on ne s’y laisserait plus reprendre, et on aurait bossé des scénars originaux.
Mais non. Jurassic World et Terminator Genysis sont là pour le prouver : la dilution par le numérique paie. La nostalgie des parents et l’absence de goût de leur progéniture suffit au système pour se pérenniser. Alors pourquoi se priver ?
Reste à savoir quelle leçon aura tiré papy Spielberg de cette expérience, qui prouve tout de même avec la belle séquence d’ouverture qu’il sait tout à fait mettre en scène. S’il rempile comme prévu en 2018, il aura le choix entre cette recette et une autre, un brin plus séduisante, vintage et nostalgique, qui commence à pointer depuis Mad Max Fury Road et Le Réveil de la Force… que cette dernière soit avec lui.