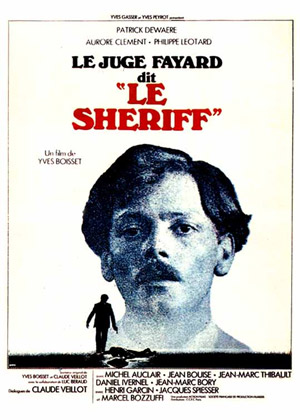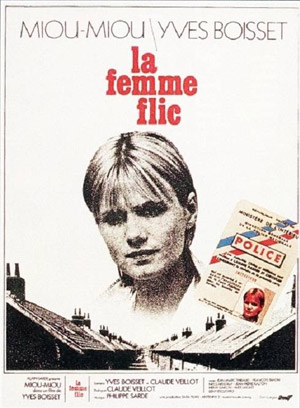•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
WAKE IN FRIGHTTed Kotcheff | 1971|
8.5/10•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« La descente infernaleOutre ses ambiances suffocantes, son casting 5 étoiles et son efficacité de chaque instant, si Wake in Fright déclenche régulièrement louanges dans la bouche de ses nombreux fans c’est avant tout pour son réalisme morbide et sa capacité à ne pas trop en faire en prenant de court le vil coyote qui s’attendait à un énième survival à base de salopards et d'une gentille victime peu fortunée.
Si Ted Kotcheff signe incontestablement un véritable film de survie dans l’outback australien, c’est sans opposer aucun camp, en se contentant de filmer la rencontre entre des rednecks bruts de décoffrage et un jeune homme cultivé pris entre deux feux, son travail, sa vie rangée et ses doutes, son envie de changement. Ce qui est intéressant, c’est qu'il n’est jamais question de forcer la main au pauvre bougre, dans le sens où l’instituteur n’est jamais forcé à faire quoique ce soit. On s’attend pourtant, à un moment ou un autre, à ce qu'il s'en prenne plein la tête, qu’il se fasse entourlouper, mais ce n’est jamais le cas, bien au contraire. Aussi marginal que soit leur mode de vie, les habitants de Yabba sont finalement hospitaliers et « bienveillants ». Le flic qui accueille John dans sa ville lui paye des verres, le conduit à une table où les steaks sont servis généreusement, les deux grosses brutes qu’il rencontre à l’occasion d’un dîner romantico-déviant lui offrent un fusil alors qu’on s’attend à ce qu’ils lui distribuent des tartes, même le chauffeur de son dernier trajet lui offre la virée en lui rendant son moyen de paiement. Que demande le peuple ?
Personne n’est donc à blâmer pour les vacances un peu particulières du pauvre John, lui qui aurait pu se retrouver à Sydney pour faire des papouilles à sa femme s’il ne s’était pas laissé tenter par les espoirs de gain du casino local. Pour moi, c’est vraiment cette facette de Wake in Fright qui en fait sa singularité, son côté survival glauque uniquement rendu possible par le mental fébrile de son protagoniste. Un prof par forcément passionné par son métier, qui s’est pourtant endetté pour le pratiquer et qui officie dans un trou paumé qui ne lui sied guerre. Son physique de surfeur australien le rend sympathique à l’image, mais il ne peut feindre cette dépression latente qui s’exprime au fond de son âme et qui fait surface lorsqu’il se laisse happer par le bush australien dans ce qu’il a de plus destructeur, entre sa 32ème et 42ème bière. Cette descente infernale dans les tréfonds de sa propre conscience, celle qui le fait vomir lorsqu’il s’apprête à tromper sa dulcine, initiée par l’adrénaline du jeu et capitalisée par une descente de liquide qui frôle l’insolence, le dévore avec virulence.
Si la sauce prend aussi bien, c’est également parce que Ted Kotcheff gère sa temporalité comme personne, de manière si subtile qu’il est difficile de trouver point de repère : on est perdu, comme peut l’être son personnage. Quelques jours ou un mois, les errances de l’instituteur font l’effet d’un arrêt sur image dans sa vie bien rangée. La fin va dans ce sens, bouclant l’écart temporel en le ramenant à son point de départ, lavé, rasé, avec le sourire, en tête les superbes décors naturels (gros boulot à ce niveau là, Ted Kotcheff filme l'Autralie avec panache sans cherche à la glorifier) qu’il a traversés et, de manière moins glorieuse, les rencontres et écarts de conduite qui lui ont certainement permis de grandir encore un peu. La seule question qui reste en suspend à la fin du film, c’est à quelle sauce il va se faire dévorer par cette jolie demoiselle qu’il a délaissée à Sydney. Pas certain qu’une excuse à base de bonnes binouzes, de copains envahissants ou de tirs à vue sur des kangourous intrépides (une séquence un peu à part, malsaine, en tout cas mémorable) lui permettent de sauver les meubles.
Pauvre John…