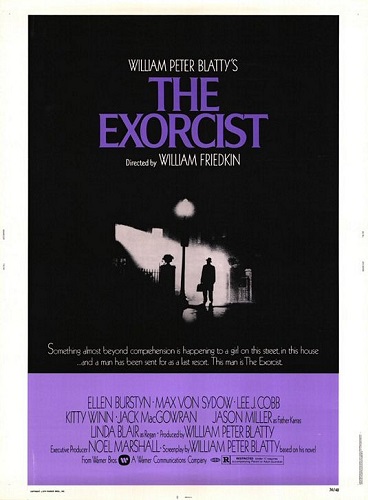S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Denis Villeneuve, que l'on aime ou non son travail, c'est bien sa capacité à gérer sa carrière de telle sorte qu'il ne reproduit jamais le même film, tout en conservant un fil rouge thématique au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière. Après un film comme
Incendies, qui l'a révélé au monde entier, le bonhomme aurait très bien pu, comme nombre de ses confrères auparavant, choisir la voie de la facilité et diriger quelques grosses productions pour devenir un yes-man parmi tant d'autres. Pourtant, au lieu de cela, il a depuis dirigé deux films qui ne se ressemblent en rien, qui font appel à des influences totalement différentes, et qui pourtant s'avèrent être, chacun à leur façon, des questionnements sur l'identité humaine.
L'identité est de nouveau au cœur de son dernier film, le bien-nommé
Sicario, que beaucoup ont considéré dès les premières images comme un ersatz de
Traffic et qui se révèle finalement être plutôt un parfait complément au
Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow, dans le sens où les deux œuvres évoquent des guerres aussi idéologiques que morales (la lutte contre le terrorisme pour l'une, le combat contre les cartels de drogue pour l'autre), dans lesquelles les États-Unis s'enlisent pour faire croire jusqu'au bout qu'elles détiennent le contrôle absolu. Identité, contrôle, morale et violence sont ainsi les maîtres mots de
Sicario, métrage qui part de l'idée la plus classique qui soit (la découverte d'un milieu dangereux à travers les yeux d'un personnage représentant les questionnements du spectateur) pour démontrer les limites d'un système tout en mettant à mal la moralité du public au passage. Il serait malvenu de spoiler en ces lignes la finalité de l'intrigue du film, toujours est-il qu'elle met parfaitement en lumière ce que veut dénoncer Villeneuve, à savoir cette illusion du combat moral qui sert finalement à une minorité de posséder toujours plus de contrôle (contrôle qui est, lui aussi, une illusion), le tout sous les yeux d'une héroïne persuadée depuis le début de persévérer dans un combat manichéen entre le bien et le mal.
Pessimiste mais réaliste,
Sicario, à travers un personnage féminin fort qui n'hésite pas à prendre position tout en étant consciente de sa force minoritaire, possède finalement la même force évocatrice visuelle que le film précédemment cité de Bigelow. Les deux héroïnes, perdant chacune ce qui les définit en tant qu'humain, deviennent les pantins d'un plan soi-disant fait pour améliorer les choses et qui ne servent finalement qu'un dessein autrement plus égoïste. A l'image de la froide photographie de Roger Deakins (qui fait lui-même engloutir les personnages par le décor désertique), les personnages de
Sicario sont déshumanisés à l'extrême (le personnage de Benicio Del Toro en tête, malgré un puissant charisme). Certains critiqueront le fait d'y voir un film où l'empathie a difficilement sa place (hormis le duo Blunt-Kaluuya), mais c'est pourtant bien la force de l’œuvre globale de Villeneuve, qui sublime cette même froideur par une mise en scène implacable (la virée à Juárez, un très grand moment de tension) et une composition musicale (signée Jóhann Jóhannsson) à faire froid dans le dos. Pas de doute : s'il y a bien quelqu'un qui saura représenter à nouveau la froideur de l'univers de
Blade Runner sans renier sa puissance thématique, c'est bien Denis Villeneuve.













































 ( j'ai meme perso encore moins de reserve , totalement conquis , emballer et impressioner a tout les niveau , quel putain de film nom de dieu , il va rester )
( j'ai meme perso encore moins de reserve , totalement conquis , emballer et impressioner a tout les niveau , quel putain de film nom de dieu , il va rester )