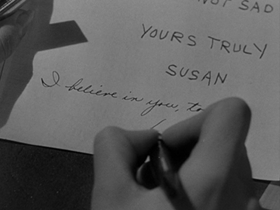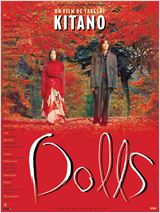
Dolls, Takeshi Kitano (2002)
Dolls, véritable tournant de Takeshi Kitano ? Oui, si on le compare à sa (première et véritablement réussie) trilogie introspective représentée par Kids return, Hana-bi, et L'été de Kikujiro). Mise en abîme d'un spectacle de Bunraku qui transpose trois histoires d'amour éternel malgré la pression sociale, on change en effet de sujet et d'angle : au lieu de prendre des losers comme points de départ, il commence avec des personnages voués à la réussite mais qui échouent en persistant contre leur instinct. Mais en même temps, l'extrême mélancolie qui s'empare des images, soutenue par un défilement de ces dernières étiré à l'extrême (parfois un peu trop, c'est mon bémol) et des visages figés par une tristesse sourde, nous indique qu'il ne s'agit que d'une variante subtile du style cinématographique du réalisateur, qui nous partage une fois encore l'irrésistible incommunicabilité de ses personnages.



Dans le fond, ça nous raconte peu de choses et c'est résumé en une phrase dans le spectacle introductif du kabuki. A côté de l'amour, honneur, gloire, et richesse ne sont que poussière. Les trois histoires qui se déroulent ensuite n'en sont qu'une variante : un employé qui sous la pression de ses parents et de son patron, doit lâcher sa copine pour se marier à la fille de ce dernier ; un vieux yakuza qui se rappelle le prix qu'il a payé pour sa réussite sociale ; le fan d'une star de la jeunesse qui décide de se défigurer pour que cette dernière, également accidentée, puisse supporter son regard nu.



Pour que ces trois histoires fonctionnent, comme d'habitude avec Kitano, il faut se laisser happer par la force des images. Elles ont d'abord cet aspect brut, sec, étouffant. Double distance entre les personnages : entre-eux et eux entre nous. Une fenêtre vers la société japonaise qui ne laisse pas vivre ses individus et les force à la réussite, qui ainsi se retrouvent tout seuls. Mais progressivement, ces images ont cette force rare de vertu poétique et thérapeutique. Il n'y a pas plus minimaliste que Kitano, mais le montage inclue des respirations par les regards mélancoliques pris d'un bref attendrissement, ou par des jeux qui viennent ouvrir la porte du réel pour y inclure de la fantaisie, et surtout par la quiétude d'un environnement saisonnier fleurissant et changeant, qui accompagne la plupart de des personnages, en rythme avec la musique de l'ex-compositeur de Kitano qui une fois de plus se met en diapason avec les images que nous offre ce dernier en lui rajoutant une fine couche d'émotions.



Ces images virent parfois au sublime, et ressemblent à des traits de pinceaux sur une peinture dont l'ensemble offre une vue saisissante. Pour nous parler de mort, une simple feuille automnale suffit pour l'évoquer. Ou pour présenter ces êtres déchirés, un ange renvoyant à l'enfance ici, ou un papillon abîmé là-bas, s'en font les porte-parole. Et comment oublier ces deux êtres reliés par cette ficelle rouge, qui ont tout quitté pour être ensemble, présentés comme les mendiants enchaînés, agissant comme des ombres d'eux-mêmes et semblant être guidés par une main invisible ? Tout un symbole de l'amour éternel qui supporte tout. Un film d'une qualité un peu en deça de la trilogie présentée plus haut, mais quand même une belle réussite à fleur de peau. Dommage que cette inspiration sera arrêtée nette avec Takeshi's.



Dans le fond, ça nous raconte peu de choses et c'est résumé en une phrase dans le spectacle introductif du kabuki. A côté de l'amour, honneur, gloire, et richesse ne sont que poussière. Les trois histoires qui se déroulent ensuite n'en sont qu'une variante : un employé qui sous la pression de ses parents et de son patron, doit lâcher sa copine pour se marier à la fille de ce dernier ; un vieux yakuza qui se rappelle le prix qu'il a payé pour sa réussite sociale ; le fan d'une star de la jeunesse qui décide de se défigurer pour que cette dernière, également accidentée, puisse supporter son regard nu.



Pour que ces trois histoires fonctionnent, comme d'habitude avec Kitano, il faut se laisser happer par la force des images. Elles ont d'abord cet aspect brut, sec, étouffant. Double distance entre les personnages : entre-eux et eux entre nous. Une fenêtre vers la société japonaise qui ne laisse pas vivre ses individus et les force à la réussite, qui ainsi se retrouvent tout seuls. Mais progressivement, ces images ont cette force rare de vertu poétique et thérapeutique. Il n'y a pas plus minimaliste que Kitano, mais le montage inclue des respirations par les regards mélancoliques pris d'un bref attendrissement, ou par des jeux qui viennent ouvrir la porte du réel pour y inclure de la fantaisie, et surtout par la quiétude d'un environnement saisonnier fleurissant et changeant, qui accompagne la plupart de des personnages, en rythme avec la musique de l'ex-compositeur de Kitano qui une fois de plus se met en diapason avec les images que nous offre ce dernier en lui rajoutant une fine couche d'émotions.



Ces images virent parfois au sublime, et ressemblent à des traits de pinceaux sur une peinture dont l'ensemble offre une vue saisissante. Pour nous parler de mort, une simple feuille automnale suffit pour l'évoquer. Ou pour présenter ces êtres déchirés, un ange renvoyant à l'enfance ici, ou un papillon abîmé là-bas, s'en font les porte-parole. Et comment oublier ces deux êtres reliés par cette ficelle rouge, qui ont tout quitté pour être ensemble, présentés comme les mendiants enchaînés, agissant comme des ombres d'eux-mêmes et semblant être guidés par une main invisible ? Tout un symbole de l'amour éternel qui supporte tout. Un film d'une qualité un peu en deça de la trilogie présentée plus haut, mais quand même une belle réussite à fleur de peau. Dommage que cette inspiration sera arrêtée nette avec Takeshi's.



Une sublime mise en abîme de l'amour éternel via un spectacle de marionnettes, très mélancolique et poétique, dotée d'un rythme étiré à l'extrême. Implicitement un portrait cinglant de la société japonaise et de ses impératifs de réussite.


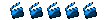



 (bon par contre va falloir que je me le rechope en Albanie ^^). Le pire c'est que je pourrais me faire une critique de tête car je sais exactement quoi dire, mais voilà ce n'est pas dans mes principes.
(bon par contre va falloir que je me le rechope en Albanie ^^). Le pire c'est que je pourrais me faire une critique de tête car je sais exactement quoi dire, mais voilà ce n'est pas dans mes principes.




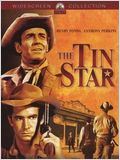


















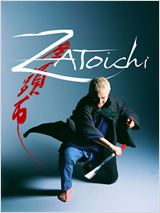
/Zatoichi-kitano1.png)
/Zatoichi-kitano2.png)
/Zatoichi-kitano3.png)
/Zatoichi-kitano4.png)
/Zatoichi-kitano5.png)
/Zatoichi-kitano6.png)
/Zatoichi-kitano7.png)
/Zatoichi-kitano8.png)
/Zatoichi-kitano9.png)
/Zatoichi-kitano10.png)
/Zatoichi-kitano11.png)
/Zatoichi-kitano12.png)